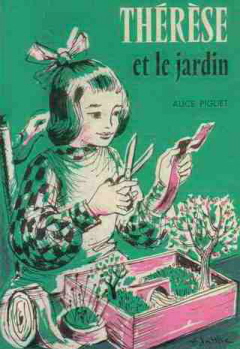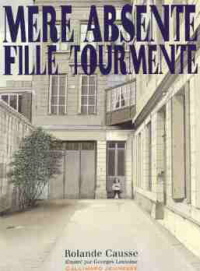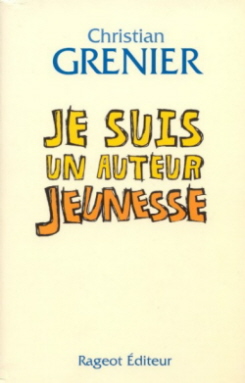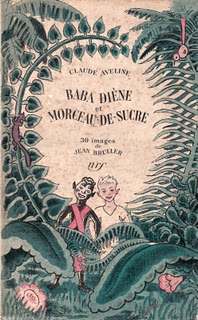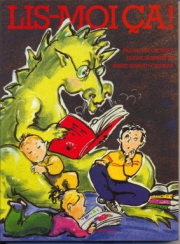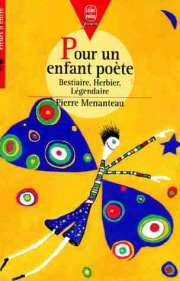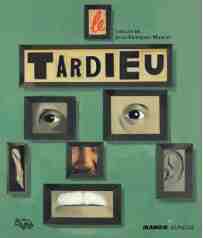Le CRILJ qui s’intéresse aux mouvements de traduction essaie depuis toujours de promouvoir le livre pour la jeunesse français à l’étranger. Il est toutefois difficile de faire un recensement, sur deux ans, des ouvrages traduits du français vers l’étranger.
Par contre, une étude relative aux ouvrages étrangers traduits en France a pu être effectuée en prenant comme base « Les livres du mois » de La Bibliographie de la France. S’agissant des livres français traduits à l’étranger, peuvent être utilisés, d’une part, avec plusieurs années de retard, l‘Index Translationum de l’Unesco et, d’autre part, les renseignements fournis pour l’édition de l‘AZ des auteurs et illustrateurs francophones pour la jeunesse édité par le CRILJ en 1991 et remis à jour en 1994.
Prendre en compte les statistiques est une façon concrète de poser le problème. J’ai donc simplement repris les parutions de l’année 1995, avec une possibilité de comparaison pour les années 1982 et 1991/92 pour lesquels le CRILJ avait mené une étude lors d’un colloque relatif aux problèmes économiques et culturels dans l’édition de la littérature de jeunesse.
La nouveauté qui ressort de cette confrontation est la part de la création française par rapport aux années antérieures et les nombreux échanges que l’on a sur ce sujet montrent qu’il y a une vraie richesse de la création française.
En 1982, on dénombrait environ 54% de livres traduits dont 90% de livres anglo-saxons. En 1992, le chiffre était de 36% et de 30% en 1995, avec encore une propondérance de l’origine anglo-saxonne (81% de l’ensemble des livres traduits). Notons qu’il n’est pas simple de déterminer le pays d’origine des ouvrages de langue anglaise car les traductions ou les adaptations de livres américians ou canadiens portent le plus souvent la simple mention « traduit de l’anglais ». L’ensemble des autres pays représentaient, en 1992, 19% – ce qui est très peu.
En 1995, les traductions se ventilent entre 40% d’albums, 25% de romans, 24% de documentaires alors qu’en 1982 la répartition était sensiblement à parts égales : 34%, 31%, 27%. Il faut, je crois, noter à part les parutions « Walt Disney » qui représentent chaque année environ 10%.
Mais on trouve aussi des choses étonnantes : Shakespeare traduit du tchèque, Perrault, Madame Leprince de Beaumont, Andersen traduits et adaptés de l’américain, Heidi traduit et adapté du danois, tout autant de pratiques qui nous renvoient aux épineuses questions de marché et de co-édition internationale.
Comme indiqué plus haut, la part des ouvrages d’origine « Walt Disney » est importante. En 1995, sur environ 1800 nouveautés parus, on relève 78 livres dits « classiques » et 55 ouvrages « Walt Disney ».
Que ce soit avec les petits albums sans nom d’auteur et d’illustrateur (160 titres répertoriés), qui se vendent très facilement, ou avec les albums de grand format signés par leurs auteurs et illustrateurs, il est difficile – à moins d’avoir l’ouvrage en main – d’en connaitre la provenance exacte entre Grande Bretagne et Etats-Unis. Parfois même, l’auteur ou l’illustrateur étant mentionné, le pays d’origine diffère.
Il est indiqué 35 livres traduits de l’allemand. En y regardant de près, on s’aperçoit que 25 de ces livres ont été publiés directement en français par les éditions Nord-Sud basées en Suisse alémanique.
En fait très peu de livres viennent d’Allemagne, un peu plus d’Espagne et d’Italie, essentiellement des petits albums. On relève aussi, assez souvent, des traductions « à l’unité » : un livre de Pologne, deux livres de la République Tchèque dont une réédition, un Baba Yaga venu de Russie, ce qui n’est pas vraiment une nouveauté.
En fait, très peu d’auteurs contemporains sont traduits. Lorsqu’il y a quelques années nous avons affectué une recherche pour des collègues du Mans qui souhaitaient établir des relations entre leurs classes de quatrième et les douze pays de la communauté européenne en édudiant en commun un auteur traduit dans chacun des pays, il nous a été impossible de trouver cet auteur parmi les contemporains.
L’Index translationim édité par l’Unesco est sur CD-rom en listing alphabétique. Mais les auteurs ne sont pas répertoriés en tant qu’auteurs écrivant pour la jeunesse. Nous envisageons au CRILJ de nous mettre à l’ouvrage. Nous aurons ainsi, dans le domaine d’intervention qui est le notre, en complément de notre AZ des auteurs et illustrateurs, une vision plus satisfaisante des échanges littéraires à travers le monde.
( texte paru dans le n° 48/49 – avril 1993 – du bulletin du CRILJ )
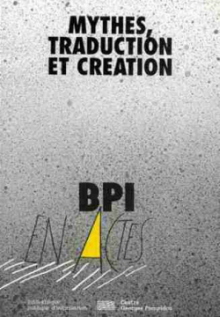
Quittant les éditions Stock quand Hachette rachète la maison, Monique Hennequin entre à l’Association nationale pour le livre français à l’étranger (Ministère des Affaires étrangères) où elle est l’adjointe de Lise Lebel. Elle publie chez Seghers en 1969 un Dictionnaire des écrivains pour la jeunesse de langue francaise, non signé, pour la section francaise de l’Union internationale des livres pour la jeunesse. Travaillant ensuite à mi-temps au Comité permanent du livre français à l’étranger (Ministère de la Culture), elle assure à compter de 1980 le secrétariat général du CRILJ. Déclarant volontiers ne pas être une militante, Monique Hennequin fut, pendant trente années, l’indispensable cheville ouvrière de l’association.