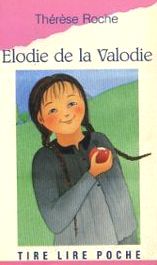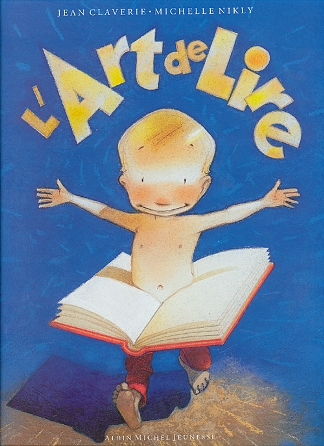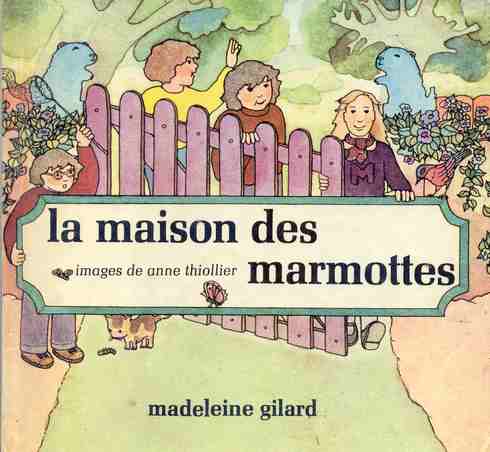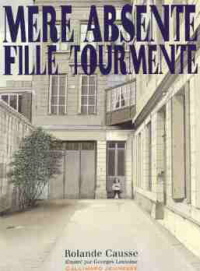La littérature enfantine était en France, aux alentours des années 60, en pleine léthargie et l’arrivée en force des médias audio-visuels et notamment de la télévision ne manquait pas d’inquiéter bon nombre d’éditeurs et d’éducateurs sur le devenir du livre pour la jeunesse et de la lecture.
C’est alors que quelques novateurs très marqués par l’art contemporain et le graphisme publicitaire vont introduire dans l’album pour enfants de nouvelles formes d’expression et faire appel à de grands créateurs.
Le premier, Robert Delpire, sortira Les larmes de crocodile avec André François, C’est le bouquet d’Alain Le Foll ; il fera connaître en France Max et les maximonstres de Sendak. Son apport : une rigueur professionnelle sans concession qui fait appel à toutes les ressources des techniques d’expression et d’impression, une confiance absolue dans l’image et ses pouvoirs.
Dans un autre registre, les éditions Tisné, Le Sénevé, Le Cerf ont à cette époque commencé, elles aussi, à s’intéresser à l’image. Mais ce sont deux autres grandes figures de l’édition française qui vont transformer ces essais et donner au livre pour enfants un nouvel essor en développant des politiques éditoriales conséquentes, et des analyses sur l’image dans ses rapports à l’enfant.
François Ruy-Vidal, enseignant d’origine, va poursuivre de 1964 à 1982, d’abord avec Harlin Quist puis chez Grasset, Delarge et aux éditions de l’Amitié, au rythme de dix livres par an. Il se présente comme un « concepteur », ce qui exprime bien tous les nouveaux rapports qu’il veut établir entre l’éditeur et les artistes. Ruy-Vidal, comme Delessert, défend l’idée du livre pour enfants aux images fortes qui doivent inciter le lecteur à réagir et à se poser des questions, du livre pour enfants créatif, libéré des tabous, qui puisse, selon les lecteurs, se lire à plusieurs niveaux.
Jean Fabre, directeur des éditions scolaires L’Ecole va mettre entre les mains des enfants, à partir des années 1965, à côté du livre didactique et uniformisant, des ouvrages qui apportent à l’enfant du plaisir et une forme d’expérience, qui incitent à une lecture aléatoire et divertissante. Son premier effort portera sur l’album, la recherche de bons conteurs d’images ; il fait appel à des artistes étrangers ou résidant à l’étranger (Maurice Sendak, Arnold Lobel, Tomi Ungerer) et révèle des illustrateurs français (Philippe Dumas, Michel Gay). Le choix des créateurs, le souci d’une structure efficace de diffusion, la volonté de toucher un large public constituent très vite pour cette maison un gage de réussite.
Il fallait beaucoup de témérité pour attaquer sur ce terrain de l’image : mais c’est peut-être ce choix qui a entraîné une réhabilitation du livre de jeunesse aussi bien dans l’esprit des lecteurs et des professionnels que dans celui des utilisateurs parents, enfants et médiateurs.
Il faut bien comprendre de même qu’en ouvrant cet espace aux meilleurs créateurs du monde entier, les éditeurs ont offert à l’enfant d’aujourd’hui, dès son plus jeune âge une véritable confrontation interculturelle qui favorise leur imaginaire, leur éveil esthétique, le familiarise avec d’autres formes d’expression, du beau, de l’homme, et de la vie. Que ce soit le plus vieux média du monde, le livre, qui ait amorcé ce tournant, alors que les autres médias de l’image ont tant de mal à le prendre, constitue sans aucun doute une chance pour ce rapport culturel et pour l’enfant lui-même.
Cette lignée de rénovateurs explique bien des choix et bien des voies qui vont marquer pour longtemps la production du livre pour enfants dans notre pays. A l’époque, les initiatives en faveur du livre de jeunesse sont peu nombreuses voire inexistantes. C’est dans ce contexte que s’ouvre la période dont je vais vous parler. Cette communication sur les grandes tendances de la littérature de jeunesse au cours de ces quinze dernières années doit beaucoup aux informations du groupe de critiques du Centre de Recherche et d’Information sur la Littérature de Jeunesse (CRILJ).
Le paysage de l’édition française pour la jeunesse depuis 1970
. Les éditeurs
De grands éditeurs scolaires – en dehors de l‘Ecole qui devient l’Ecole des Loisirs – comme Hachette, Hatier, Magnard vont eux aussi être sensibles, dans la littérature qu’ils produisent parallèlement pour les enfants, à l’impact du graphisme, mais aussi aux activités d’éveil de plus en plus pratiqués à l’école. D’autres grands éditeurs vont créer des départements jeunesse : celui qui domine ces quinze dernières années par l’abondance et la qualité de sa production est le département jeunesse de Gallimard fondé en 1972 par Pierre Marchand et Jean-Olivier Héron, département qui deviendra très vite le lieu de rencontre des grands auteurs « maison » : Joseph Kessel, Albert Cohen, François-Marie Le Clézio, Michel Tournier, Claude Roy et des meilleurs illustrateurs du moment (Etienne Delessert, Nicole Claveloux, Jean Claverie, Claude Lapointe, Georges Lemoine, Henri Galeron, etc), d’abord dans les collections « 1000 Soleils », « Enfantimages », « Folio Junior », et depuis 1980, dans les collections « Folio Benjamin », « Folio Cadet », « Découverte Cadet ». D’autres éditeurs comme le Centurion, Albin Michel, Le Seuil, se lanceront aussi dans la littérature de jeunesse.
Mais le phénomène qui a aussi beaucoup marqué les années 1970 est l’arrivée de petits éditeurs sur le marché tels La Noria, Léon Faure, La Marelle, d’Au, Le Sourire qui mord, Ipomée, Syros, qui ont renouvelé profondément les pratiques éditoriales et l’approche thématique de certains sujets. Avec des auteurs, des illustrateurs, souvent militants, pédagogues, ils ont voulu créer des images différentes en accord avec leur sensibilité, leur projet idéologique ou culturel ; ils se sont attachés dans la plus grande liberté à sortir des livres de transgression ou d’agression, à prendre en compte les enfants tels qu’ils sont plutôt que comme la société adulte se les représente.
Ils ont cherché des solutions originales, souvent artisanales, aux contraintes de la conception et de la fabrication. Mais ils ont été freinés dans leurs réalisations par des problèmes d’ordre économique ou de distribution. De ce fait, plusieurs de ces maisons d’édition n’ont eu qu’une vie éphémère.
Aujourd’hui, on compte en France sur 687 maisons, 87 éditeurs qui publient des livres pour la jeunesse : dans la plupart des cas, le secteur jeunesse n’est qu’un département de production à côté de la littérature générale ou des livres scolaires ; une dizaine d’éditeurs seulement ne font que du livre de jeunesse et trois maisons d’édition ont un double secteur livres et presse pour la jeunesse important. Cinq maisons d’édition font à elles seules 65% du chiffre d’affaire « Jeunesse » : Hachette, Gallimard, Les Presses de la Cité, Nathan, Flammarion.
. L’évolution du marché de l’édition pour la Jeunesse
En un peu plus de quinze ans en France, le nombre de titres pour enfants publiés à l’année a été multiplié par 3,4 (1448 en 1965 – 4926 en 1983), et le nombre d’exemplaires mis en vente par 2,12 (31 millions d’exemplaires en 1965 – 66 millions d’exemplaires en 1983). Actuellement le livre de jeunesse dépasse le livre scolaire en nombre de titres et en nombre d’exemplaires mais non en chiffre d’affaires.
Cette expansion, dans l’ensemble assez remarquable, ne doit pas cacher certaines zones d’ombre et des contrastes :
– cette progression ne s’est pas poursuivie d’une façon continue : s’il y a croissance accélérée de 1970 à 1979, depuis les chiffres fluctuent d’une année à l’autre et connaîtraient même une certaine stagnation malgré de légers progrès ces deux dernières années ;
– dans le domaine des nouveautés, on note un recul de la catégorie « albums » et à l’inverse une assez nette augmentation de la catégorie « livres », ce qui est sans doute la conséquence de l’essor foudroyant du livre de poche jeunesse et du documentaire ;
– le nombre des réimpressions représente environ 60% de la production annuelle totale, ce qui peut être interprété comme un pourcentage considérable ou comme un signe de succès et de la pérennité de certaines œuvres. Il aurait tendance à augmenter dans la catégorie albums et à rester stationnaire dans la catégorie livre ;
– les conditions de distribution et de mise en place constituent encore bien des obstacles à la percée du livre pour la jeunesse en France : hormis les grandes surfaces qui représentent 15% des circuits de distribution, mais dont les produits livres sont souvent de médiocre qualité, les libraires assurent 45% de la vente jeunesse. Mais, sur 25 000 points de vente en France, il n’y en a que 2 000 pour la jeunesse ; et sur ce nombre on compte seulement 3 à 400 libraires ayant un rayon jeune très diversifié et 40 à 50 spécialisés jeunesse. Et, comme malgré certains efforts des pouvoirs publics, le réseau de bibliothèques est très inégalement implanté, le livre pour enfants n’est pas présent partout. Il y a donc pour les jeunes, un problème d’accès au livre. Ces déficiences sont compensées en partie par de nombreuses initiatives locales en faveur de la lecture mais en partie seulement selon les départements, ce qui a pour conséquence de renforcer les inégalités culturelles : ce sont les enfants appartenant aux milieux culturels privilégiés qui sont les plus gros consommateurs de livres ; ce sont les enfants appartenant aux milieux les plus défavorisés qui ont le moins de chance de rencontrer le livre et surtout les meilleurs œuvres de la production.
Les tendances marquantes de la production
Les albums, on l’a noté, ont opéré une véritable révolution graphique et culturelle, ce qui a modifié le paysage du livre d’images mais aussi des publics auxquels ils s’adressent maintenant. Les premiers bénéficiaires ont été bien sûr les jeunes enfants : cette tranche d’âge a bénéficié ainsi d’une floraison exceptionnelle de talents nouveaux tout en voyant son patrimoine se consolider et s’élargir avec l’extension du catalogue du Père Castor et l’arrivée de nouveaux éditeurs dans ce créneau. Mais les albums débordent aujourd’hui ce public : certaines œuvres illustrées de format albums s’adressent à d’autres catégories de la jeunesse (par exemple Thomas et l’infini de Michel Déon, illustré par Etienne Delessert aux éditions Gallimard). On peut donc parler d’une mutation éditoriale importante dans l’habitude des producteurs et des lecteurs.
Mais le deuxième phénomène qui a modifié la physionomie de l’édition française pour la jeunesse durant cette période est l’essor foudroyant du livre de poche. Une première expérience tentée par Madame Rageot en 1971 resta sans lendemain. C’est Jean Fabre qui depuis 1975 a repris l’idée avec « Renard Poche » et « Lutin Poche ». Deux ans plus tard, Gallimard lance sa fameuse collection « Folio Junior » qui comporte maintenant trois cents titres dont un tiers « d’œuvres maison », un tiers de reprises d’albums publiés par des confrères français, un tiers d’inédits français ou étrangers : de grands textes admirablement relayés par une mise en page et des illustrations d’époque ou signées des meilleurs artistes contemporains ; Gallimard s’intéresse aussi à l’image en poche avec « Folio Benjamin ». Magnard avec « Tire Lire Poche », Bordas avec « Aux quatre coins du temps », Hachette avec « le Livre de poche jeunesse », Nathan avec « Arc en poche », Casterman avec « l’Ami de poche », « Croque Livres », l’Atelier du Père Castor avec « Castor poche » se lancent à leur tour dans l’aventure. On compte en tout une vingtaine de collections de poche qui couvrent de petits livres d’images provenant ou non de réductions d’albums, des contes, légendes et romans pour moins de 8 ans, 8-12 ans, plus de 12 ans, des anthologies de poésie, des documentaires. Depuis cette percée du livre de poche, les jeunes et notamment les écoliers, ont à leur disposition, dans un conditionnement agréable et bon marché, les grands textes d’hier et d’aujourd’hui, français et étrangers. Mais la création littéraire dans ce secteur marque un peu le pas.
La catégorie des documentaires pour la jeunesse est en pleine ébullition : ces livres représentent près de 50% des productions pour la jeunesse et ils ont tendance à proliférer dans le plus grand désordre, d’autant que la bataille du documentaire fait rage actuellement entre les éditeurs. Dans cette catégorie, il y a eu et il y a toujours beaucoup de faux documentaires aux sujets trop globalisants ou trop émiettés, aux images accompagnées de textes insignifiants ; il y a encore beaucoup de traductions et de coproductions qui relaient parfois, dans des adaptations mal transcrites, des informations mal adaptées ou non datées. Mais on observe aussi une part croissante d’œuvres françaises originales. Actuellement, la production française aligne trente collections publiées par quinze éditeurs, qui relèvent vraiment de l’information scientifique et technique. Certains thèmes sont surexploités : la nature, les animaux ; d’autres sont insuffisamment abordés : la chimie, la physique, la biologie, les objets, les techniques. Mais, fait étrange selon l’enquête du CRILJ de 1982, les enfants préfèrent pour s’informer sur le plan scientifique et technique : 1) regarder la télévision, 2) aller dans les musées, 3) consulter un livre. Il y a certainement à rechercher une meilleure adéquation entre les besoins des lecteurs, la demande des scientifiques et les offres des éditeurs.
Dans la catégorie romans, contes et légendes, la situation est plus contrastée et plus inquiétante. Il existe quatre vingt collections bien étoffées et bien réparties pour lecteurs débutants, bons lecteurs, lecteurs chevronnés. Le développement de certaines d’entre elles en format de poche les rendent plus accessibles. Mais on constate aussi que :
– certaines valeurs sûres ne font plus autant recette sauf quand cette lecture est imposée par l’école ou par la famille. Certaines œuvres échappent bien sûr à ce désintérêt (Alphonse Daudet, Antoine de Saint Exupéry, Jules Renard, Mark Twain) ;
– le roman social pour adolescents qui a été très en vogue après 1968 n’inspire plus aujourd’hui ni les éditeurs ni les lecteurs ;
– les livres d’humour et d’aventures si recherchés par les 8-12 ans font quelque peu défaut ;
– un genre en vogue depuis peu : les livres avec jeux de rôles et les interactions où le lecteur construit sa propre histoire mais où le livre reste maître du jeu (collection « Un livre dont vous êtes le héros », Ed. Gallimard) ;
– les traductions dans le domaine des œuvres littéraires l’emportent largement sur les œuvres d’expression française. La production française qui avait aligné durant les années 1970-1980 un certain nombre de grands auteurs (Coué, Pelot, Solet, Garel, Massepain) semble avoir du mal à assurer la relève ; pourtant aux dires de certains éditeurs, de jeunes auteurs commencent à faire leur percée et à connaître le succès ;
– comme sur le plan des tirages annuels, la production paraît étalée, la situation n’est pas alarmante mais le renouvellement des œuvres de fiction doit préoccuper tous ceux qui s’intéressent à la littérature de jeunesse.
On peut ajouter un mot sur la Bande Dessinée. La B.D. a fait, en France, après mai 1968, un saut décisif : cantonnée jusqu’alors dans le monde des enfants, elle a conquis subitement et rapidement en deux ans le monde des adultes. De nouveaux créateurs, pas toujours chevronnés, se sont mis à raconter leurs phantasmes. Gros succès temporaires puis usure du genre. On revient aujourd’hui aux qualités du scénario et du graphisme. Mais le tirage global annuel s’en est ressenti (baisse de 30% en cinq ans) ; le nombre des réimpressions l’emporte maintenant sur les nouveautés ; et le tirage moyen par titre est tombé en cinq ans de 27 000 à 14 000, ce qui pose problème quand on connaît le coût des investissements dans ce genre de production. On note toutefois une remontée de ce tirage moyen en 1984.
On ne peut clore ce chapitre sur la production sans évoquer l’image de marque du livre français pour la jeunesse à l’étranger. Cette image a profondément changé en quinze ans. D’abord un certain nombre d’auteurs et d’illustrateurs de notre pays ont atteint une notoriété internationale : une preuve toute récente en est le grand prix attribué cette année et pour la première fois, par la Biennale Internationale de l’Illustration de Bratislava, à un français, Frédéric Clément. Ensuite les éditeurs français ont acquis maintenant un savoir-faire qui les place en concurrence avec les producteurs étrangers les plus compétitifs : ils ont appris à manipuler les mécanismes complexes de la co-édition, à calculer pour certains leurs ratios économiques sur une exploitation internationale, à implanter pour d’autres des agents ou des filiales à l’étranger, voire, ce qui est plus rare, à vendre, comme les packagers anglo-saxons, leurs projets clé en main de conception et de fabrication. C’est pourquoi on peut espérer dans les années à venir un rayonnement plus grand de la production française mais aussi un développement de la création dans notre pays.
Un environnement culturel favorable à la lecture
Ce retour en force de la littérature de jeunesse dans notre pays n’a été possible que parce que l’environnement culturel s’y est prêté. Certes cet essor est d’abord le fruit de l’innovation des éditeurs et des créateurs. Mais que serait-il advenu de ces efforts, auraient-ils même été engagés si les milieux éducatifs et culturels n’avaient pas favorisé et soutenu cette action ?
L’école a reconsidéré, depuis quinze ans, dans son discours et dans ses pratiques, sinon toujours dans les moyens, la place du livre pour enfants. Des groupements comme le Groupe Français d’Education Nouvelle (GFEN), les groupes Freinet, l’Association Française pour la lecture (AFL) ont beaucoup fait pour l’éveil à la lecture, le plaisir de lire, l’expression de l’enfant. Les enseignants eux-mêmes ont bénéficié, non sans difficultés, de possibilités de formation à la littérature de jeunesse. Le développement des Bibliothèques Centres Documentaires (BCD) dans le premier degré, des Centres de Documentation et d’Information (CDI) dans le second degré, contribuent maintenant à faciliter l’accès de l’enfant aux livres, à l’inciter à l’utiliser pour son plaisir ou pour son travail scolaire. Les Projets d’Action Educative (PAE) introduisent des activités sur la lecture et des intervenants extérieurs (éditeurs, auteurs, illustrateurs) au sein même de l’école et contribuent à motiver les élèves pour la lecture. Cet aspect du problème a déjà été développé par ailleurs.
Des institutions, comme les bibliothèques, les centres culturels ont beaucoup investi pour créer ce climat d’intérêt autour de la lecture en développant non seulement toutes les procédures traditionnelles comme l’heure du conte mais aussi toutes les ressources nouvelles qu’apporte une animation bien comprise dans ce domaine.
Des associations comme « La Joie par les Livres », avec ses groupes de critiques, ses matériaux d’information, son action au niveau international et national, comme « Loisirs Jeunes » avec ses diplômes annuels et en particulier le prix graphique du Livre pour enfants créé en 1972, des vitrines comme la Bibliothèque des Enfants du Centre Pompidou, des organisations comme les Francs et Franches Camarades, Culture et Bibliothèques pour Tous, contribuent à faire connaître et soutenir les meilleures réalisations en faveur du livre et de la lecture.
Mais plus originale encore est sans doute l’action du Centre de Recherche et d’Information du Livre de Jeunesse (CRILJ), créé en 1974, qui réunit en son sein, au niveau national et régional, des représentants de toutes les professions intéressées au problème du livre pour enfants (éditeurs, auteurs, illustrateurs, libraires, critiques, chercheurs, enseignants, bibliothécaires, animateurs culturels). Son existence et ses nombreuses initiatives favorisent des confrontations interdisciplinaires et interprofessionnelles à divers échelons et des actions communes sur le terrain grâce à ses vingt cinq sections régionales : circulation de malles de livres, débats, journées d’études, stages, interventions dans les écoles, animation, fête du livre. Le CRILJ ouvre aussi ses portes aux livres d’enfants dans des lieux ou des secteurs où jusqu’à présent il n’avait pas sa place : salons, professions médicales…
On ne compte plus aujourd’hui en France les manifestations sur le livre et la lecture (colloques, semaines de la lecture, journées de formation, expositions, cycles de conteurs…).
Parmi les événements les plus significatifs de ces dernières années, on peut relever :
– sur les nouvelles pratiques de la lecture, les rapports entre culture orale et écrite : le colloque international du CRILJ « Le livre dans la vie quotidienne de l’enfant » en 1979.
– sur la création : le colloque national du CRILJ en 1982.
– sur les illustrateurs : les expositions : « L’enfant et les images » organisée par le Musée des Arts Décoratifs en 1973, « la littérature en couleurs » organisée par la SPME en 1984, « Images à la page » organisée par le Centre Pompidou en 1985, mais aussi les expositions des illustrateurs pour enfants aux Salons du Livre et au Salons des Illustrateurs à Paris.
– sur l’information scientifique et technique : les colloques nationaux de Strasbourg, de Paris, de Toulouse, de Marly mais aussi la mise en place d’un observatoire du livre et de la presse scientifique et technique pour les enfants avec le concours des pouvoirs publics, de musées, des associations spécialisées et des scientifiques eux-mêmes ; l’expérience pilote de recherche sur ordinateur des livres scientifiques et techniques menée avec des enfants par le CRILJ.
– sur l’enfant et la poésie : un colloque national en avril 1986 organisé par le CRILJ.
– en faveur de certaines catégories particulières d’enfants (enfants handicapés, enfants du Quart-Monde, enfants de travailleurs migrants) : de nombreuses initiatives d’associations des ouvrages originaux (ouvrages bilingues, ouvrages pour mal-voyants) des bibliographies thématiques, des rencontres spécialisées.
Au-delà de cette énumération un peu sèche, il faut bien voir que nous assistons en France à un renouveau d’intérêt et à un redéploiement des actions en faveur de la lecture à tous les niveaux. Cette vogue touche les professionnels, la recherche, les milieux éducatifs et culturels et beaucoup de bénévoles. On regrettera toutefois que cette vitalité de la littérature de jeunesse ne soit pas suffisamment prise en compte par les autres médias : la grande presse et la télévision ne lui consacrent que peu de place. Il reste encore à toucher efficacement les premiers intéressés : les parents et les enfants eux-mêmes car avant d’amener l’enfant à la lecture, il convient d’amener le livre à l’enfant.
Cette prise de conscience globale, ce concours de toutes les forces vives dans cette bataille de la lecture peuvent à terme changer le rapport de forces entre les médias mais aussi contribuer au développement culturel de l’enfant et du citoyen.
« La lecture, disait Jacques Rigaud lors du colloque de 1979, apparaît comme quelque chose de paradoxal. Il n’y a pas en effet d’activité plus individuelle parfois même plus solitaire et qui en même temps soit davantage subordonnée à un environnement, à une vie collective, à un rapport social. Les nouvelles approches de la lecture sont étroitement liées à un contexte culturel d’innovation, de changement, de prise de responsabilités par les communautés ». Je crois que nous en faisons tous en ce moment l’expérience.
Conférence donnée à Padoue en octobre 1985 au colloque franco-italien sur Lecture et Temps Libre pour la Jeunesse, dans le cadre des manifestations du 10ième Prix Européen de littérature pour la jeunesse.
( texte paru dans le n° 27 – janvier 1986 – du bulletin du CRILJ )

S’intéressant particulièrement à la presse pour l’enfance et la jeunesse, Eudes de la Potterie fonde, en 1946, au sein des éditions Fleurus, un centre de documentation où il rassemble, quarante années durant, la totalité des publications périodiques francophones pour la jeunesse, un fort échantillonnage de publications étrangères et une très riche documentation sur le sujet. Cette collection est désormais, par convention, déposée à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulème. Actif au sein du Bureau International Catholique de l’Enfance, président de 1963 à 1974 de l’ADBS (Association des professionnels de l’information et de la documentation), Eudes de la Potterie siégea, dès 1949, à la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence. Homme de dialogue, il fut un administrateur du CRILJ aux contributions toujours parfaitement documentées.