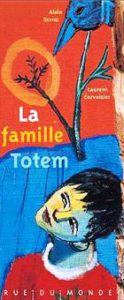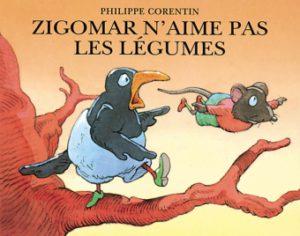..
L’ouvrage que signe Christian Bruel, L’aventure politique du livre jeunesse (La fabrique, 2022), aura rassemblé, au-delà même des professionnels de la profession, un lectorat conséquent. Ne s’en étonneront que ceux qui estiment (encore) que la littérature jeunesse est une littérature neutre et que politique est un grand méchant mot. Le quatrième de couverture – que nous reproduisons ci-après – annonce d’emblée que quelques vérités vont être rétablies et il invite sans ambages à réactiver l’esprit de résistance dont la littérature pour la jeunesse de notre époque a, elle aussi, plus que jamais besoin. (A.D.)
« Si elle se donne souvent comme paisible et consensuelle, l’offre de lecture adressée aux enfants et aux jeunes est toujours politique, qu’elle conforte l’ordre des choses ou qu’elle lui résiste. En partageant nombre de ses lectures jubilatoires, admiratives ou circonspectes, Christian Bruel souligne tant la fécondité luxuriante d’une production créative à la marge, que l’inlassable travail des idéologies s’agissant de la famille, de l’école, du genre, de la sexualité, de l’économie, des discriminations, de l’esthétique, de la compétition, de l’écologie et de l’avenir. Entre le relevé commenté des frilosités sociales, des évitements manifestes et des conformismes rentables, se glissent des propositions pour une autre formation littéraire des destinataires… et aussi une mère célibataire épanouie, une mare collectivisée par ses canards, des enfants solidaires résistant à « ceux qui décident », un chien libertaire se disant conservateur, l’indispensable travail du texte et ses articulations nouvelles avec les images, quelques masculinités moins hégémoniques, des filles rebelles plus nombreuses, et de possibles mondes entrevus. »
.
Grandes questions (1)
Cet essai, très attendu dans le champ de la littérature jeunesse, plaira à celles et ceux qui accordent aux lectures juvéniles d’autres fonctions qu’une vague distraction (même s’il est beaucoup question de jubilation dans ces pages). Si le créateur visionnaire d’Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon (2), Christian Bruel, y défend « bec et ongles » les productions pour la jeunesse, celles qui émerveillent et qui informent, il en attend d’autres fonctions : qu’elles dévoilent le présent, qu’elles révoltent et qu’elles projettent les enfants et les adolescents dans l’imagination d’un « futur désirable ». Qu’elles « arment leur volonté d’agir ». Contre les pratiques éditoriales infantilisantes et lénifiantes (découpage en tranches d’âges, représentations sociales tronquées et stéréotypées, manque d’inventivité dans les formes et contrôle des thèmes), l’essayiste se prononce en faveur d’objets culturels polysémiques nécessitant une « qualification scripturale littéraire et idéologique » acquise dès le plus jeune âge, à la croisée de la famille, de l’école, de la bibliothèque, du centre de loisirs, du club ou de l’association, dans le droit fil de l’éducation populaire. Il se dégage de ces pages des convictions « chevillées au corps » qu’une longue expérience dans le champ de la littérature de jeunesse a permis de roder : deux fois éditeur (3), Christian Bruel est toujours auteur, formateur, membre du conseil d’administration de l’Agence quand les livres relient, vice-président du Centre de promotion du livre de jeunesse, partenaire de nombreux acteurs du livre et de la lecture et de leurs événements. Sur plusieurs fronts, un œil sur la production et la réception, l’autre sur l’état du monde, il ne se préoccupe pas de « faire le départ entre ce qui serait littéraire et ce qui ne le serait pas » mais considère la lecture (toutes ses formes) comme un mode de partage des facultés de repenser le monde (il a d’ailleurs publié, avec Katy Couprie, « un genre » d’utopie sociale (4)). Pour lui, les livres doivent, très tôt, contribuer à l’éducation de « sujets politiques, créatifs, plus enclins à infléchir la demande qu’à consommer l’offre, des sujets se mêlant de ce dont on tend à les écarter. » D’où sa sympathie pour ces microclimats de lecture où des professionnels de la culture et de l’éducation, des parents, des citoyens tiennent à bout de bras des espaces de rencontres et d’échanges autour des livres et des magazines. Se méfiant comme de la peste d’une culture qui ferait l’économie des rapports sociaux de production, il porte le fer contre les discours analgésiques en faveur d’une culture universelle : « Comment vouloir partager la culture quand l’humanité ne jouit pas des mêmes droits et que les richesses, fruits du travail du plus grand nombre, sont confisquées par une extrême minorité ? ». S’il privilégie les albums (fictions, documentaires) c’est que la coprésence sur un même support de deux langages (le texte et l’image) offre des opportunités infinies à l’interprétation, la « négociation publique de sens », pour reprendre l’expression de Jérome Bruner (5).
 Il faut l’entendre lire l’histoire la plus innocente, Poule rousse par exemple, pour comprendre à quel point la lecture peut être créative pour peu qu’on s’intéresse aux « inflexions conjointes du texte et des images », aux « capillarités », aux « entrelacs » – tout un vocabulaire révélateur de la jouissance de l’exégète. Dès l’introduction, le ton est donné : ce livre n’est pas un énième plaidoyer en faveur des « bons livres », une suite de prescriptions éclairées, mais un manifeste en faveur des manières de lire et des raisons d’agir : « Voir, et voir comme voient les myopes jusque dans les pores des choses », écrivait Flaubert (6). Aux lecteurs et aux lectrices de faire « leur miel » non pas à partir d’une sélection éclairée (production restreinte) mais « avec l’offre telle qu’elle se présente » et telle qu’elle est contrainte : « L’hyperconcentration des médias et des entreprises culturelles entre les mains de quelques milliardaires notoirement philanthropes ayant fait fortune dans le bâtiment, le luxe, les armes et la téléphonie non seulement participe d’un nivellement des imaginaires et des savoirs mais asservit le bien public qu’est l’information et fragilise la démocratie en permettant toutes les accointances et les opérations concertées entre les pouvoirs en place et les oligarchies de fait ». Si les formes privées de la lecture sont protégées, c’est du côté des interactions sociales et de leur réinvestissement que se place majoritairement cet essai : « Un futur désirable ne saurait être imaginé sans la contribution au commun, volontaire et à sa mesure, de chaque génération. Et ce dès le chemin. »
Il faut l’entendre lire l’histoire la plus innocente, Poule rousse par exemple, pour comprendre à quel point la lecture peut être créative pour peu qu’on s’intéresse aux « inflexions conjointes du texte et des images », aux « capillarités », aux « entrelacs » – tout un vocabulaire révélateur de la jouissance de l’exégète. Dès l’introduction, le ton est donné : ce livre n’est pas un énième plaidoyer en faveur des « bons livres », une suite de prescriptions éclairées, mais un manifeste en faveur des manières de lire et des raisons d’agir : « Voir, et voir comme voient les myopes jusque dans les pores des choses », écrivait Flaubert (6). Aux lecteurs et aux lectrices de faire « leur miel » non pas à partir d’une sélection éclairée (production restreinte) mais « avec l’offre telle qu’elle se présente » et telle qu’elle est contrainte : « L’hyperconcentration des médias et des entreprises culturelles entre les mains de quelques milliardaires notoirement philanthropes ayant fait fortune dans le bâtiment, le luxe, les armes et la téléphonie non seulement participe d’un nivellement des imaginaires et des savoirs mais asservit le bien public qu’est l’information et fragilise la démocratie en permettant toutes les accointances et les opérations concertées entre les pouvoirs en place et les oligarchies de fait ». Si les formes privées de la lecture sont protégées, c’est du côté des interactions sociales et de leur réinvestissement que se place majoritairement cet essai : « Un futur désirable ne saurait être imaginé sans la contribution au commun, volontaire et à sa mesure, de chaque génération. Et ce dès le chemin. »
Dès l’introduction, dense et offensive, l’auteur lève de sacrés lièvres sans les porter en triomphe : pour que les « jeunes lectures durent toujours », elles doivent étayer toutes les façons de grandir (7) et narrativiser toutes les expériences. Le compte est loin d’être bon même si des pas ont été franchis : on n’en est plus (ou presque) à la transmission verticale ni à la persuasion brutale (le statut de l’enfant a changé), on ne croit plus au grand soir et aux lendemains qui chantent (mais à des luttes créatives, respectueuses des équilibres humains et physiques). Ce qui reste à faire est cependant colossal : l’augmentation du nombre de lecteurs ne se fera pas sur le modèle de la pratique « d’une minorité qui, tout à la fois, grâce à elle, domine, s’identifie, et se distingue » mais en faisant en sorte « que s’inventent de nouveaux lecteurs et de nouveaux écrits » (8). C’est cette politique de lecture qui se cherche à travers cette aventure du livre jeunesse et qui anime le combat de Christian Bruel dans le champ de l’édition, de la création, de la formation et du débat politique.
Des hauts et des bas (9)
Le ton de cet ouvrage est tout en variations : l’inflexibilité côtoie l’ouverture, l’analyse est bordée d’emballements, la logique fraye avec les digressions. L’auteur est non seulement un lecteur érudit mais un brillant orateur habitué à passer en un éclair de l’analogie à l’ellipse, de la fascination au rejet, de la gravité à l’ironie. De là des associations qui rompent la démonstration, des phrases laissées en suspens réservées aux lecteurs avertis, des sauts à travers les époques, des irritations, des enthousiasmes, des doutes et quelques nuances à la radicalité. Le vocabulaire témoigne de la diversité des champs disciplinaires convoqués (linguistique, littérature, politique, psychanalyse, psychologie, sociologie) : des termes surannés (benoîtement, nonobstant) aux expressions latines (ad patres), des locutions (Au diable !) aux jurons (Morbleu !), du répertoire technique de l’imprimerie aux convictions idéologiques, l’orateur n’est jamais loin de l’écrivain : « provere, docere, flectere » (prouver, charmer, fléchir). Dans l’espoir de faire connaître « les lignes de force de l’ensemble de la production », un nombre important de livres sont présentés (10) qui renseignent sur les hauts et les bas d’un répertoire tant romanesque que documentaire, poétique que théâtral ou encore journalistique. La culture de l’auteur sur ce sujet est ébouriffante, peut-être intimidante pour un lecteur néophyte plongé dans un dédale de références plus ou moins actuelles. Ce livre est incarné et sa lecture demande un effort mais c’est en surmontant la difficulté qu’on atteint les étoiles, pour paraphraser ici Alberto Manguel (11). La construction de l’ouvrage, tout en tuilage, apporte toutefois de l’aide (12). Le lecteur cahoté peut être repris plus loin par le développement d’un sujet esquissé en amont, souvent sous un autre angle et, pour les domaines moins développés, faute de place, l’auteur renvoie à des travaux plus documentés (pour le théâtre ou la chasse par exemple). On peut, sans dommage pour la compréhension, sauter quelques présentations de livres, y revenir plus tard et, si comme c’est parfois le cas, des titres ne sont plus édités, se rendre en bibliothèque : l’un des atouts de cet ouvrage, et ce n’est pas le moindre, c’est de mettre en valeur les réseaux de lecture publique et leur dynamisme persistant malgré la réduction constante des crédits de fonctionnement et des temps de formation.
Précautions d’usage (13)
Président du groupe jeunesse du Syndicat national de l’édition (élu en 1992, réélu en 1995), Christian Bruel a eu à défendre l’imprimé (ses coûts de production, sa présence dans le tissu social) et le statut des auteurs et autrices, leur liberté d’expression. Filtres, freins, faux-semblants, tout concourt à protéger les jeunes lecteurs des sujets qui divisent. A côté des dispositifs officiels de surveillance (loi du 16 juillet 1949 encadrant les productions pour la jeunesse) et des obstacles structurels (hyperconcentration des médias, raréfaction des points de vente), les pressions de la vox populi sont, de loin, les plus efficaces. Bien documenté, tout le passage sur la censure est aussi inquiétant qu’édifiant. Des groupes s’organisent autour des maisons d’édition (sensivity readers) pour faire retirer d’un catalogue un auteur à la biographie trouble ou bien un livre au contenu inconvenant « au risque de faire peu de cas du contexte, de l’humour, du second degré, ou des discours rapportés, et tout simplement des gouffres séparant ce qui est dit et montré dans une création de ce qui, dans la vraie vie, pourrait être revendiqué ou encouragé par les artistes. » Les droits d’achat et de vente à l’étranger privilégient certains modèles sociaux en occultent d’autres empêchant le jeune public de « roder son rapport au monde » d’en questionner les évidences comme les opacités : « Il nous faudrait admettre le trouble, cette nécessaire condition du sens et l’évidence double qu’il n’y a pas une mais des lectures et qu’une lecture garantie sans risque n’a pas de sens. » (14) Ayant lui-même dû batailler (et bataillant encore) contre les censeurs lorsqu’il était éditeur, Christian Bruel sait de quoi il parle et pourquoi il défend ardemment les livres qui nourrissent la réflexion sur les sujets les plus intimes (le corps, le genre) comme les plus collectifs (l’autorité, la compétition, la production et le partage des richesses, la défense du bien commun). Il rend hommage aux documentaires qui, contre vents et marées, informent respectueusement les enfants sur des questions auxquelles les jeunes lecteurs ont déjà commencé à répondre depuis le plus jeune âge : « Avant d’être lu par personne, le livre non littéraire a toujours déjà été lu par tous, et c’est cette lecture préalable qui en assure sa ferme existence » (15). Ses analyses, associées à des exemples, sont le plus souvent implacables. S’il reconnaît des avancées chez les éditeurs les plus classiques et des maladresses du côté de l’avant-garde, il déplore le manque de subversion d’une édition que sa bonne santé économique pourrait conduire à davantage d’audaces (tant sur le fond que sur la forme). Un chapitre échappe aux regrets : celui qui évoque la presse « rebelle », son souffle, ses chaos, ses enchantements et ses déboires.
Premières nouvelles (16)
Il était un temps (fin du XIXème siècle) où l’on n’y allait pas avec le dos de la cuillère. Les choses étaient dites sans ménagement et les enfants envisagés selon leur genre et leur condition sociale (Tu seras ouvrière, 1887 / Petit Pierre sera socialiste, 1913). A côté d’une presse confessionnelle qui cherchait à récupérer « les âmes » que l’école laïque lui avait retirées et d’une presse commerciale peu scrupuleuse, vivait une presse socialiste bien déterminée à former les futurs révolutionnaires : « C’est sur l’esprit des enfants que nous devons prendre notre revanche, et la révolution, nous devons la préparer avec des gamins de 7 ans« , « Changer quoi ? TOUT. » (17) Christian Bruel se régale de passer en revue les héros de cette presse antimilitariste, pro-syndicale et internationaliste : pas des « rejetons princiers » vivant des « aventures au-delà des mers » comme dans la presse bon marché, mais des jeunes, ouvriers ou paysans, évoluant à l’atelier ou dans les champs et s’exprimant dans une langue populaire et truculente. Il se réjouit de montrer combien, parmi les intentions clairement affichées (alors qu’elles sont aujourd’hui diluées), figurait la volonté de mobiliser la jeunesse autour des questions de justice sociale, de féminisme, d’antiracisme, de solidarité. Pas question d’information « objective », il fallait choisir son camp, ni de fiction distractive, dissipatrice de la force contestataire. On sent le penchant de l’auteur pour cette entreprise émancipatrice même s’il en pointe les naïvetés et les caricatures, les formes plus ou moins dissimulées d’embrigadement. Avançant dans le temps, il montre comment le souffle de cette presse a cherché à perdurer ou à renaître, notamment après mai 68. L’exemple de Virgule est éclairant à ce sujet. Héritier de Francs-Jeux, ce magazine a tenté, à travers ses nombreuses rubriques, d’interagir avec les lecteurs et les lectrices à propos de sujets d’actualité plutôt brûlants : l’antisémitisme, les châtiments corporels, le chômage, la guerre d’Algérie, l’Islam, le racisme, le sexisme, etc). À la place de rédacteur en chef, drôle et parfois féroce, se trouvait Pierre-Elie Ferrier (autrement connu sous le nom de Pef), qui sera remercié quand le journal sera vendu aux éditions Nathan.
 « La complète disparition des publications jeunesse sur papier un tant soit peu engagées a bien sûr à voir avec les difficultés générales de la presse mais surtout avec l’évidente réticence d’une large part du tissu social à considérer les enfants et les jeunes comme étant les destinataires légitimes de productions originales s’agissant du social et du politique. » À aussi à voir avec notre propre négligence ou lâcheté : combien sommes-nous à avoir soutenu Virgule mais aussi Griffon succédant à Trousse-Livres ? (18) Chacun dans notre bulle nous protégeons nos « boutiques » chancelantes, engloutis que nous sommes par les demandes de subventions quand notre plus grande richesse est dans l’intelligence collective, l’alliance.
« La complète disparition des publications jeunesse sur papier un tant soit peu engagées a bien sûr à voir avec les difficultés générales de la presse mais surtout avec l’évidente réticence d’une large part du tissu social à considérer les enfants et les jeunes comme étant les destinataires légitimes de productions originales s’agissant du social et du politique. » À aussi à voir avec notre propre négligence ou lâcheté : combien sommes-nous à avoir soutenu Virgule mais aussi Griffon succédant à Trousse-Livres ? (18) Chacun dans notre bulle nous protégeons nos « boutiques » chancelantes, engloutis que nous sommes par les demandes de subventions quand notre plus grande richesse est dans l’intelligence collective, l’alliance.
Quand il évoque la presse jeunesse actuelle, Christian Bruel montre sa bonne santé (290 publications lues par 9 millions de personnes âgées de 1 à 18 ans). Plus stable que le livre grâce à la permanence de ses rubriques, plus souple car plus réactive à l’actualité, elle a perdu en engagement social et politique mais gagné en respectabilité auprès des parents dont les opinions et les croyances sont préservées : à côté de fictions plaisantes, de jeux et de blagues, des dossiers bien ficelés offrent aux enfants et aux adolescents des « gisements de références pérennes » à la neutralité rassurante même lorsqu’ils abordent des sujets clivants (politique, religion, sexualité). L’auteur s’interroge sur cette dérive documentaire ou scolaire qui éloigne les nouveaux périodiques du temps où la presse jeunesse « était une voix avant d’être un écho » et pose la question de la lecture comme source d’émancipation quand l’information se borne, par exemple, à présenter le fonctionnement institutionnel s’interdisant « tout abord critique du dispositif, de son histoire, des phénomènes sociaux, des mécanismes de la domination, de la confiscation du pouvoir délégué, de ce qui fonde les rapports de force et les positions personnelles. » Raison pour laquelle, il ne manque pas tout au long de ce livre, de louer l’engagement d’acteurs divers dans les associations, les bibliothèques, à l’école, dans les centres de loisirs, les villages et les villes. Il a veillé à n’oublier personne et la dispersion des noms tout au long des pages rend bien compte de l’émiettement des forces sur le terrain. Les BCD mais aussi les Villes-lecture (19) avaient cette ambition d’inscrire l’éducation des enfants au cœur des rapports sociaux (leurs tensions) mais les programmes scolaires de 2002, pourtant audacieux, ont préféré se concentrer sur la possibilité des livres de réunir les enfants de toutes conditions à travers une culture commune : « L’aspiration à l’universalité neutre de l’enseignement public épousait enfin une production dont l’expansion continue se faisait au prix d’un calibrage anhistorique et apolitique ». Pour qu’un autre monde soit possible, ce livre demande autre chose à la littérature qu’une réconciliation des imaginaires.
Pour un autre merveilleux (20)
L’aventure politique du livre jeunesse est un livre qui secoue les consciences, recense les forces en présence, récapitule les luttes passées et réactive l’esprit de résistance. Le développement de la lecture (et de l’écriture) est au cœur de communautés agissantes où chacun/chacune y gagne en « estime de soi, en intelligence sensible et sociale du proche et du lointain ». Il faut des formateurs, incarnés, positionnés, interlocuteurs d’une jeunesse ni idéalisée, ni stigmatisée mais prise dans la diversité de ses conditions d’existence et de ses ambitions. Il faut des aides à la création (à travers des bourses ou des conservatoires) pour élargir l’origine sociale des auteurs : « Il ne s’agit pas de revenir à de vieilles lunes ouvriéristes, mais seulement de contrarier l’idéologie tenace du don et d’ouvrir au plus grand nombre la chance, le pouvoir et la responsabilité d’émouvoir et de renseigner l’immense reste du monde. » Ce livre, au beau titre, nous invite à la plus passionnante des aventures : l’exploration de nos utopies, de leurs failles invisibles à leurs promesses oubliées. Aujourd’hui, comme à d’autres époques, pour des raisons qu’aiguise la situation climatique, la littérature et la presse sont des armes pour comprendre et agir, ici et maintenant. Ce qui reste à inventer « excède les possibles déjà repérés, écrit Jean-Luc Nancy et implique d’ « ouvrir des chantiers sur les lieux-même du désarroi et de l’impuissance. » (21) On peut considérer le livre de Christian Bruel comme une pierre apportée à cette construction qui, pour se concrétiser n’aura jamais autant eu besoin d’imaginaire et de détermination, d’auteurs et d’éditeurs, de lecteurs : « Beaucoup d’auteurs et d’autrices, en admettant qu’ils et elles le veuillent, hésitent à oser les lignes de force d’une projection temporelle prenant à bras-le-corps un futur perfectible et accessible. Il s’agit d’aborder l’inconnu, de trouver une forme éloignée de la prophétie et suffisamment assurée d’elle-même. Cet inconnu-là demeure étrangement inquiétant tant sa cohérence et sa crédibilité rendent indispensable le dévoilement des matrices économiques et idéelles présentes et à venir. S’arrêter en chemin, préférer les utopies inverses, les utopies du pire, les dérives totalitaires, les reconstructions post-apocalyptiques chaotiques et les luttes localisées pour la survie de l’espèce humaine, est doublement tentant. L’adrénaline y gagne ce que perd la prospective politique à ce refus d’obstacle et le lectorat, tenu dès la petite enfance à l’écart de tout creuset ayant l’impossible comme but, se trouve conforté dans un impensable de rapports sociaux et humains autrement exaltants. » C’est à cet enthousiasme, subjectif et collectif, que nous convie ce livre aussi lucide que courageux.
par Yvanne Chenouf
.
1. La grande question, Wolf Erlbruch, Être, 2003 (réédité par Thierry Magnier en 2012)
2. Christian Bruel, Anne Bozellec, Anne Galland, Le Sourire qui mord, 1976 (réédité par Thierry Magnier en 2014)
3. Le Sourire qui mord, de 1975 à 1995, puis Être éditions, de 1997 à 2012
4. D’ici là, un genre d’utopie, Christian Bruel, Katy Couprie, Thierry Magnier, 2016
5. Pourquoi nous racontons-nous des histoires ?, Jérome Bruner, Retz, 2010
6. Correspondance, La Pléiade, 1980, I, 29
7. Voir « L’imaginef des Savanturiers », contribution de l’auteur à la conception d’un espace pour la jeunesse à la Bibliothèque de France : Actes de Lecture n° 37 mars 1992 (https://www.lecture.org/revues_livres/actes_lectures/AL/AL37/AL37P56.pdf)
8. « Pouvoir, savoir et promotion collective », Jean Foucambert, Les Actes de Lecture n° 22, juin 1988 http://www.lecture.org/revues_livres/actes_lectures/AL/AL22/AL22P59.pdf
9. Des hauts et des bas, Nicole Claveloux, Le Sourire qui Mord, 1988
10. Plus de 300 titres de titres de livres et près de 100 titres de presse jeunesse.
11. Pinocchio & Robinson, Alberto Manguel, trad. Christine Le Bœuf et Charlotte Melançon, L’escampette, 2005
12. La similitude de certains sous-titres (en italiques) avec les titres de livres (en italiques mais décalés) gêne de même que les intertitres isolés en fin de page quand le paragraphe commence page suivante.
13. Précautions d’usage, Charles Brutini, Philippe Weisbecker, Être, 1998
14. « Quand la politique s’en mêle », Revue des livres pour enfants n° 114, décembre 2016,.
15. L’Espace littéraire, Gallimard, 1995, p. 258
16. Premières nouvelles, Christian Bruel, PEF, éd. Le Sourire qui mord, 1989
17. Jeune Camarade (avril 1925), Antirouille (années 1970).
18. Voir les articles produits à ce sujet sur www.afl.org
19. La revue Trousse-Livres a été créé en 1976 par Manuelle Damamme
20. Manifeste pour un autre merveilleux, collectif dont faisait partie Christian Bruel ; texte paru en 1976 dans les colonnes de Libération.
21. Que faire ?, Jean-Luc Nancy, Galilée, 2016
.
Yvanne Chenouf, enseignante et chercheuse, a travaillé à l’Institut national de la recherche pédagogique dans l’équipe de Jean Foucambert ; elle fut présidente de l’Association française pour la lecture (AFL) ; conférencière infatigable, adepte des « lectures expertes », elle a publié de nombreux articles et ouvrages personnels et collectifs à propos de lecture et de livres pour la jeunesse dont Lire Claude Ponti encore et encore (Etre, 2006), et Aux petits enfants les grands livres (AFL, 2007) ; elle est à l’origine d’une collection de films réalisés par Jean-Christophe Ribot qui donnent à voir des élèves de tout niveau aux prises avec des ouvrages signés Rascal et Stéphane Girel, François Place, Claude Ponti, Philippe Corentin, Jacques Roubaud. Quoique désormais en retraite, Yvanne Chenouf répond toujours volontiers aux sollicitations qui lui sont faites, encore et encore.
Gtand merci à Yvanne Chenouf pour nous avoir confié son texte.
.
.