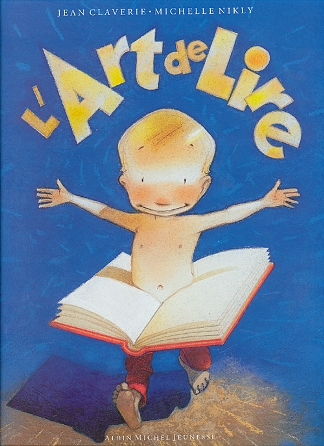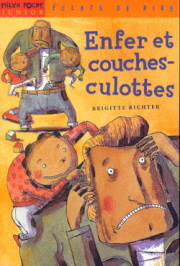Si la chape de silence écrasant le livre de jeunesse, entrefêlée depuis quelques années par quelques téméraires, naïfs, désintéressés et impécunieux (critiques, associations et gens du livre) semble se fendre aujourd’hui, la fissure reste modeste et peut, d’un jour à l’autre, se refermer.
Le Colloque de Saint-Etienne l’a encore élargie de quelques millimètres, mais à quel prix !
Trop de choses à dire en deux jours et un soir. Certains en bégayaient, d’autres parlaient trop vite ou cédaient à la rhétorique par pudeur universitaire et beaucoup n’ont rien pu dire.
Ce qui aura été mis à jour, la partie émergée, c’est la caresse voluptueuse, mais la caresse qui reste fugitive et fait souffrir d’en rester là. C’est pourtant toujours ça de pris !
Comme à vous, que j’ai entrevu et avec qui je crois partager la même passion, il me reste bien des choses à dire. D’abord, en premier lieu, que d’autres gens de l’image auraient pu intervenir à ma place.
Ensuite, je tenterai, en faisant court, de répondre à Georges Jean, ce que j’ai mal fait par inexpérience : il ne fallait pas lâcher le crachoir.
1) Y a-t-il une finalité Jeunesse ? Certes, Georges Jean, on crée pour soi et pour tout le monde. Souvent l’illustrateur doit tuer le père, l’auteur du livre aimé pendant l’enfance. Pour moi ce fut Samivel et son Joueur de flûte qu’un vent contraire a privé de l’auteur/profanateur avec lequel je comptais m’acoquiner : François Ruy-Vidal. C’est la façon qu’ont les illustrateurs de « guérir de leur enfance » en en conservant précieusement la cicatrice, la mémoire car le rapport à soi-même, petit, ne se gomme jamais. Avec les armes que sont cultures et savoir-faire, on court après d’autres livres qu’on aurait pu aimer autrefois en ayant bien à l’esprit que l’enfance d’aujourd’hui est différente. Serait-ce là le bon usage du narcissisme auquel vous faisiez allusion ?
Créer pour tout le monde ! Oui, mais comme vous le dites, sans penser aux tranches d’âge, aux données psychologiques qui feraient « polir » un produit marketing, sans penser non plus aux « problématiques » que condamnait Bruel et qui tiennent lieu de concepts éditoriaux à bon marché – le sexe, la mort, l’argent – méritent, en effet, mieux que de servir d’étiquettes. Ils doivent s’introduire, j’oserais dire subrepticement, poétiquement dans le livre, autorisant ainsi une lecture complexe mais pas nécessairement compliquée. Littérature et image débordent donc le public jeune. A ce propos beaucoup d’illustrateurs, dans la recherche de complicité (et non d’admiration) en jouant de clins d’yeux, d’empilement de métaphores, pensent aussi au plaisir/travail de l’adulte porteur d’un enfant sur les genoux ou simplement lecteur pour soi. Malheureusement ce sont encore les petits qui sentent, les grands n’ayant appris à « lire » que les images prémâchées de la pub, de modes d’emploi, de l’érotisme, autant dire de rien lire du tout. Il y a pourtant quelques adultes attardés !
Vous posiez aussi la question de la revitalisation de la création. Certes, grâce à Quist, Ruy-Vidal puis Marchand, Colline Poirée et certains autres, il y a eu du nouveau. Normalement je devrais ici glisser ici une longue liste d’illustrateurs que j’aime mais faute de place… Il faut cependant aussi ne pas oublier le rôle qu’a joué l’étranger dans ce réveil de la création hexagonale : pour l’image on cite souvent Sendak, presque trop souvent car on en oublie d’autres au moins aussi importants : Mercer Mayer, les Dillon, Edelman, la mère nourricière des années 1970. Les Français ont souvent trouvé chez eux l’exemple de l’audace, de la liberté formelle mais surtout conceptuelle, le tremplin qui les a détournés (bien ou mal ?) de l’Art, celui de l’expression purement personnelle. Mais j’ai aussi fait allusion à la nécessité de retrouver notre Histoire qui n’est pas elle aussi étrangère à bien des recherches actuelles. La légitimité se fait aussi par les traces révélées (jazz, photo, cinéma) et la création y gagne infiniment. On verrait ainsi que la préoccupation fondamentale de l’illustration, soit le rapport créatif image/texte, a été abordé de façon surprenante par nombre d’oubliés.
2) Quand au rôle du créateur, je dirais, avec bien d’autres dessinateurs, qu’il se situe encore dans sa relation au texte. Que ce dernier soit ancien ou contemporain et quelle que soit sa forme littéraire, conte, légende, nouvelle, roman, récit… l’image se doit de lui apporter une « valeur » qui peut aller jusqu’à l’appropriation complète, le détournement, la perversion. « Tremblez, auteurs, devant l’irrespect ! ». L’image remplit alors l’une de ses missions majeures : débrider, provoque l’imaginaire du lecteur qui, sentant une distance, une liberté conquise osera prendre la sienne. C’est le pendant du désir de lire qui se mue en désir d’écrire auquel vous faisiez allusion en vous référant à Barthes. Nous refusons donc le rôle d’ornemaniste et revendiquons un statut d’ « auteur entre les lignes » jouant sur les ancrages, les sens flottants, les relais, les non-dits, au risque du pléonasme, monstre tapi qui nous guette en permanence, nous qui venons presque toujours « après ». La plupart des illustrateurs se veulent donc metteurs en scène, réalisateurs, accessoiristes, éclairagistes, décorateurs aussi… Bref un peu mégalos (ceci compensant la modestie de nos gains : il est vrai qu’on nous rabâche que c’est un sacerdoce).
3) A la question de la « Culture de masse des médias » à laquelle elle est si fâcheusement associée, l’image, dont le devoir est, redisons-le, de lancer l’imaginaire, est presque impuissante. Passées les premières années au cours desquelles elle est langage privilégié, elle devient produit qui fait subir et qui doit faire subir en un clin d’œil. Ceci explique aussi son incapacité à véhiculer autre chose que les lieux communs d’une culture au sens anthropologique du terme à laquelle vous avez fait allusion. Tout le système éducatif a donc un rôle à jouer et, effectivement, seul l’apprentissage du plaisir de la durée, de la relecture peut nous sortir de cet appauvrissement. Il ne s’agit pas tant d’enseigner une quelconque sémiologie mais de tenter de maintenir ce plaisir dans l’intimité d’une image qui aura alors à évoluer, s’enrichir pour nourrir. Si cela ne se fait pas, elle (l’image) continuera d’être, un moment, l’objet des longues fouilles et des analyses amusées du petit, puis de devenir un accessoire, une béquille du texte pour enfin glisser vers sa triste mission d’abrutissoir des masses. Tout continuera de se passer comme si, de catapulte des rêves et de la connaissance du monde puis, d’accompagnatrice du texte pour un bout de chemin, elle se suicidait pour laisser à ce dernier champ libre, lui qui ne retiendra sous ses charmes que quelques élus.
Qu’on ne s’y trompe pas, je ne dis nullement que l’image est perdue pour l’adulte : il y a un certain cinéma, une certaine BD, le peinture, la photo, mais ceux-ci sont encore plus élitaires. C’est pourquoi, Pierre Marchand, je maintiens que si l’album décline c’est très grave car c’était, c’est encore, le juste premier pas dans l’image. Ce serait plutôt l’usage qu’on fait d’elle après que me plonge dans l’incertitude. On dit du texte court, la nouvelle par exemple, qu’il est un genre difficile ; je crois que celui de l’album est encore plus difficile car il doit jouer, fifty-fifty avec l’image, un savant assaut d’escrime ou plus exactement un ballet. J’en appelle donc aux éditeurs pour qu’ils maintiennent, par-delà les crises de tous acabits, ce genre littéraire (au sens large) proprement fondamental. C’est curieusement l’un de ceux qui le connaissent et le pratiquent le mieux qui doute naïvement, à moins que ce ne soit qu’une provocation roublarde.
4) Pour ce qui est des mécanismes de la création reconnaissons qu’ils démarrent, s’appuient sur la double envie d’exprimer (ce qui relie l’illustrateur plus ou moins à l’Art) et de communiquer (ce qui nous fait tendre vers un second pôle que faute de mieux, j’appellerais l’artisanat). Ces mécanismes sont donc à la fois obscurs et simples.
Citons pêle-mêle. Pour l’obscur : le goût des symboles, le café, le tabac, des pratiques d’auto-conditionnement psychologiques voisines de celles du comédien sujet au trac qui n’excluent pas la superstition, le passage sommeil/veille, une culture souvent brouillonne rarement de type universitaire, le hasard suscité ou récupéré. Pour le simple : le professionnalisme, la volonté de faire mieux, le goût des signes, d’une rhétorique particulière (acceptée ou transgressée), pas l’appât du gain, le rapport au document ou la volonté de s’en passer, la mémoire visuelle, le plaisir des accords de tons, celui de l’organisation de l’espace, des agencements image/image, image/texte, celui de la typographie, celui du découpage, etc.
Au risque de faire long par écrit ce que je n’ai pas fait oralement et ce que je regrette, je voudrais revenir sur les quelques revendications qui font l’accord de la plupart des illustrateurs : en tout premier lieu notre volonté de nous inscrire dans une dynamique culturelle et économique et notre refus de l’assistanat et d’une forme quelconque de salariat (ce qu’un passage de l’intervention de Roland Garel aurait pu, à tort, laisser entendre). Par contre nous voulons travailler en profondeur, ne plus « torcher » des livres pour vivre et n’acceptons pas davantage ce propos fallacieux qui consiste à nous encourager dans notre vocation sacerdotale en imposant à la plupart d’entre nous un autre métier en parallèle. C’est au XIXème siècle que l’Art était sacré et l’Artiste maudit.
Ensuite, pour ceux qui commencent, il serait intéressant qu’ils puissent montrer leur travail autrement qu’à Bologne entre deux stands, ou à la va-vite chez un éditeur qui le plus souvent confie le soin de « voir » les dossiers à un cerbère incompétent. Il faudrait que les illustrateurs (et pourquoi pas les auteurs) débutants, aient, comme les plasticiens ont une aide à la première exposition, une aide au premier livre : ce pourrait être une collection expérimentale financée en partie par les éditeurs « réunis », en partie par le Ministère de la Culture, ou celui de l’Education. Collection pas nécessairement luxueuse mais accessible au plus grand nombre.
Il conviendrait aussi de permettre, outre le temps de la recherche sur les travaux en cours (ce qui est un problème temps/argent qui pourrait peut-être trouver une amorce de solution dans la réduction des gâchis à la distribution (voir l’intervention de Christiane Clerc) à des professionnels, l’expérimentation sur d’autres médias, vidéo, micro-informatique, inaccessibles aux particuliers. Je crois avoir expliqué en quoi le livre aurait à y gagner.
Enfin, il serait bon de mettre à la portée des gens du livre et du public intéressé, les moyens d’une culture spécifique : je pense en particulier à l’histoire de l’illustration (travail largement amorcé en pays anglo-saxons).
Il n’appartient pas aux illustrateurs de dire comment tout cela pourrait prendre forme, mais il n’est pas douteux que de nombreuses institutions, associations comme le CRILJ, éditeurs, Etat… et les illustrateurs eux-mêmes pourraient participer. L’idéal serait que l’image manuelle, tabulaire et médiatisée, en un mot l’illustration, soit aussi saisie dans son caractère multi-médias : publicité, presse, édition et pourquoi pas audio-visuel.
Je conclurai, très subjectivement, en chuchotant que sa préférence va quand même à cet objet parallépipédique, d’épaisseur variable où courent plein de signes noirs.
( texte paru dans le n° 19 – 15 mars 1983 – du bulletin du CRILJ )
Né à Beaune (Côte-d’Or) en 1946, Jean Claverie fait ses études à l’École nationale des Beaux-Arts de Lyon puis à l’École des Arts décoratifs de Genève. Il travaille pour la publicité puis se spécialise dans le domaine du livre pour la jeunesse. Premier album en 1977 : L’enjôleur de Hameln, aux éditions Nord-Sud. Autres titres, parmi les mieux connus : Que ma joie demeure (Gallimard, 1982), Musée blues (Gallimard, 1986), Little Lou (Gallimard, 1990). L’art des bises (Albin Michel, 1993), Le Théorème de Mamadou (Le Seuil, 2002). Jean Claverie enseigne à l’École Nationale des Beaux-Arts de Lyon et à l’École Émile Cohl. Il rencontre régulièrement ses jeunes lecteurs et, musicien au sein du quartet de blues Little Lou tour, il se produit volontiers lors de concerts pas uniquement pédagogiques. Nombreux prix et expositions personnelles dont, en 2006, une vaste rétrospective au Centre de l’illustration de Moulins. Les trois cents participants du colloque Littérature pour la jeunesse : la création en France organisé par le CRILJ, à Saint-Etienne, en 1983, se souviennent encore de son cri désormais historique : « Apprenez à connaître les gens de l’image ! »