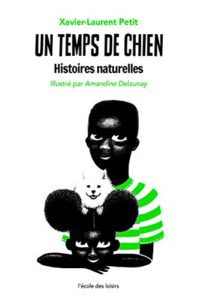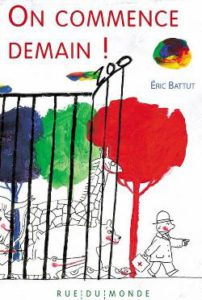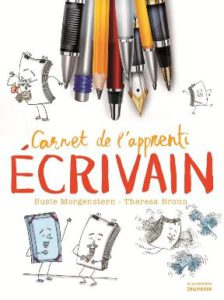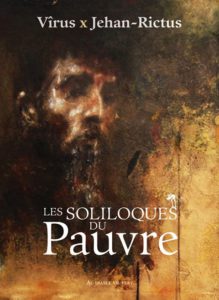.
La campagne de soutien à la librairie indépendante Vivons livres ! imaginée par l’école des loisirs, c’est en ce mois de septembre 2020. A votre disposition, dans les librairies, d’une part, un joli livre dans lequel soixante auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices de la maison rendent hommage aux libraires en mots et en dessins et dans lequel on ne s’étonnera pas de trouver notamment des contributions de Claude Ponti, Anne Herbauts, Flore Vesco, Anaïs Vaugelade, Kitty Crowther, Grégoire Solorareff, Jean-François Chabas ou Susie Morgenstern, et, d’autre part, une série de six affiches mettant en scène un malicieux écureuil dessiné par Olivier Tallec.
« Dans la période de grandes difficultés sanitaires et d’incertitudes économiques totalement inédite que nous traversons, répondre aux besoins profonds de culture et de lecture est essentiel. Face aux mutations et aux incertitudes de notre société, notre conviction d’éditeur indépendant, mais aussi de libraire, est que notre rôle est d’aider chacun à mieux comprendre, par la lecture, les enjeux actuels, de contribuer à développer l’esprit critique, mais aussi de montrer le beau car le monde du langage reste le meilleur » (Louis Delas, directeur général de l’école des loisirs).
Voici quatre textes extraits du recueil, avec l’autorisation de leurs auteurs et celle de l’éditeur.
.
.
Cinquante ans de voyages
Ma maison regorge de livres. J’en fais parfois des tas, par taille, des constructions improbables.
C’est une foule bienveillante et qui, toujours, m’interpelle. Lorsque j’ai déménagé récemment, du Loiret vers la côte belge, le très aimable transporteur a ri en voyant autant de caisses alignées, incrédule, cinquante ans de voyages entre les lignes. Et pourtant, en ce confinement, ce qui me manque le plus, c’est de ne pas pouvoir entrer dans une (vraie) librairie pour en trouver au moins un autre.
Mes ami·e·s libraires le savent : en principe, je ne sors jamais sans un livre, car sinon j’ai l’impression d’un acte manqué. Je peux explorer longtemps : il y a forcément un recueil ou un roman qui va m’étonner, me faire un clin d’œil ou provoquer un battement de cœur entre deux pages. J’aime ouvrir un livre, en lire seulement un soupçon de mots, quelques bribes, puis, si ça me plaît, l’emporter comme un secret, puis filer au café pour m’en nourrir tout de suite. Sans librairie, je me sentirais souvent lettre morte. C’est mon addiction.
Dans chaque ville où j’ai vécu, j’ai aussi trouvé la ou le libraire qui finit par si bien connaître vos chemins qu’il vous y précède et, les yeux pétillants, vous sort d’une pile, en un geste de magicienne ou de prestidigitateur, ce petit rectangle inconnu qui va ensemencer dans l’heure votre imaginaire. Ma maison regorge de livres, mais un autre m’attend, bien caché, flamboyant sur une étagère, ou dans la main qui se tend. Comme il se doit, mon déconfinement commencera en tournant une nouvelle page.
(Carl Norac)
.
Libraireté chérie
Je me demande souvent pourquoi j’achète autant de livres. Deux, trois par semaine. Et parfois plus. Bien plus, en tout cas, que je ne peux en lire.
Il faudrait peut-être que je vois un psy…
Mais finalement, ce ne sera pas nécessaire. Le 17 mars dernier, à midi tapant, j’ai la réponse à ma question : si j’ai stocké tous ces livres comme un animal engrange des provisions pour l’hiver, c’était bien sûr pour résister au confinement. Pour tenir jusqu’à la fin (en espérant qu’elle arrive un jour). C’était une question de vie ou de mort, car lorsqu’on souffre, comme moi et pas mal d’autres, d’une addiction sévère aux bouquins et aux librairies, comment survivre à six, huit ou dix semaines de manque ?
Bien sûr, j’ai une liseuse. Mais ce n’est un pseudo-livre sans âme, ni encre, ni papier, de la glaciale électronique, un substitut tout juste bon à se soulager du poids des livres le temps d’un voyage. Mais qui oserait encore parler de voyage en ces temps où nous nous claquemurons ?
Pendant des mois et des années, j’ai donc fait des réserves de livres sans savoir pourquoi. Rien de plus, au final, qu’un réflexe animal dicté par la peur du manque et la trouille vertigineuse de n’avoir plus rien à lire. C’est l’instinct qui parlait en moi, l’instinct du lecteur ou, plutôt, du liseur.
Ce n’est pas tout à fait la même chose.
Le lecteur est assez plan-plan, il aime son confort, revient à ses auteurs et ne fait confiance qu’à sa librairie chérie. Le liseur est d’une trempe plus aventureuse. Où qu’il se trouve, il explore, butine et papillonne. À l’image des marins, le liseur a une librairie dans chaque ville. Disons qu’il est plusieurs fois fidèle aux nombreuses librairies qu’il a croisées au cours de sa vie et qu’il n’hésitera jamais à pousser la porte d’une belle inconnue pour en humer le parfum et lancer un coup d’œil avide en direction de ses tables et rayonnages chargés de livres.
Ce que le liseur aime plus que tout, c’est fouiner, fureter, fouiller, farfouiller et s’interroger : qu’est-ce que je vais bien dénicher aujourd’hui ?
Car tout bon liseur a un devoir à respecter : ne pas ressortir les mains vides.
Question de la libraire :
– Vous souhaitez un renseignement ?
– Non, non… merci. Je flâne.
Déjà explorateur, un bon liseur se double d’un flâneur. Voilà qu’une couverture attire son attention. Livre inconnu. Titre inconnu. Auteur inconnu. Et l’impression soudaine que ce livre-là a été écrit pour lui. L’attirance est réciproque : manifestement, ce livre n’attend qu’une chose : que le lecteur s’en saisisse. Après tout, les librairies sont là pour ça, non ?… Pour rencontrer des histoires et les mille façons de les raconter.
Le liseur s’empare du livre, en caresse la couverture, le retourne, le feuillette… Saisit quelques phrases piochées au hasard… Coup d’œil vers la libraire occupée avec un client. Attente. Nouveau feuilletage… Ah ! La voilà disponible.
– Celui-là, vous pouvez m’en parler ? Vous l’avez lu ?…
Sourire complice de la libraire.
– Celui-là ? Voilà quinze jours que je le conseille à mes clients et aucun ne me l’a encore jeté à la figure !
Mais qui est-il donc, « celui-là » ?
Mille réponses possibles. Bien entendu, votre « celui-là » ne sera pas le mien.
En ce qui me concerne, ce pourrait être… Tour d’horizon, Kathleen Jamie, par exemple. Un bouquin au physique plutôt ingrat : couverture verdâtre et titre blanchâtre.
Mais dès les premières phrases, embarquement garanti : cap sur les Hébrides et quelques îlots atlantiques à peu près inaccessibles, peuplés d’oiseaux de mer et semés d’ermitages abandonnés. Coup de foudre. Voilà le liseur transporté, dans tous les sens du terme, par l’écriture savoureuse d’une auteure écossaise dont il ne connaissait pas même l’existence une seconde plus tôt.
Sans en être tout à fait sûr, je crois bien avoir débusqué ce livre à Montbard, dans l’une de mes librairies bien-aimées : À fleur de mots.
Dans une vie antérieure, Véronique, la libraire, travaillait à l’ONF. Je fais partie des dinosaures qui ont fait du latin du collège jusqu’au lycée : vous me pardonnerez d’étaler les maigres restes de ces lointaines études. « Livre » et « librairie » viennent tous deux du latin liber qui signifie tout à la fois l’écorce d’un arbre et le livre. En français, le mot « liber » désigne toujours une partie de l’écorce des arbres qui « a longtemps servi de support à l’écriture », m’apprend le vénérable dictionnaire de l’Académie française.
Et voilà ! Le tour est joué ! « Ma » libraire est tout naturellement passée des arbres aux livres et du liber à la librairie, suivie en cela par son mari, lui aussi ancien garde forestier qui, à peine à la retraite, s’est aussitôt réinventé une nouvelle vie de libraire.
À fleur de mots n’est pas ma seule bien-aimée. Loin de là… Il y a aussi cette librairie BD de Dijon, nichée au fond d’un passage introuvable et dont le libraire semble avoir tout lu depuis la création du monde, ou encore la minuscule librairie française de Bucarest, qui résiste vaille que vaille à l’invasion des tours de verre, et puis encore celle de Royan… Et celle de La Chaise-Dieu… Et celle de Dole… Et celle de… et tant d’autres !
À quoi tient donc l’attirance pour telle ou telle librairie ?
Comme tous les charmes, celui-ci reste inexplicable. C’est affaire de passion, de liseurs et de libraires. Le résultat d’une alchimie secrète entre un lieu, une façon d’accueillir, un goût de lire, un certain ordre, ou un certain désordre, un agencement de l’espace, une façon de mettre les livres en valeur…
La fusion reste imprévisible et mystérieuse. L’amour ne se décrète pas.
Pour ma part, j’ai un faible pour les librairies légèrement « bordéliques », voire un peu plus. Si l’on n’y trouve pas le livre que l’on cherche, on finit toujours par dégotter celui qu’on ne cherchait pas, ce qui est encore mieux ! D’ailleurs, c’est bien simple, je ne cherche aucun livre particulier en entrant dans une librairie.
Je reçois depuis hier quelques mails de librairies annonçant qu’elles ouvrent un service drive. C’est mieux que rien, mais il y manquera le principal : le plaisir de fouiller et d’explorer.
Alors vivement la fin (du confinement) !
Et ce jour-là, c’est promis, même masqués, gantés, et ivres de gel hydroalcoolique, nous autres, lectrices, lecteurs, liserons, liseronnes, liseuses et liseurs, nous retrouverons « nos » librairies.
Et notre libraireté chérie.
(Xavier-Laurent Petit)
Pousser la porte
J’avais douze ans. Tous les jours, sur le chemin de l’école, je passais devant une librairie. Et tous les jours, je m’attardais quelques minutes devant la vitrine remplie de livres dont les titres m’intriguaient : Alice et le Fantôme, Le grand combat, Mon bel oranger ou Le premier cercle, et d’autres que j’ai oubliés. Je brûlais de l’envie de pousser la porte et de fouiner parmi tous ces livres, mais je n’avais pas un sou vaillant. Alors, je décidai de grappiller la moindre pièce de monnaie qui me restait des commissions… j’accumulai le plus de pièces que je pus, jusqu’à obtenir une somme rondelette à mes yeux. Maintenant, je pouvais pousser la porte de la librairie.
La libraire était maigre, âgée et avait un air pincé qui m’intimida. Je me glissai entre les rayons, aussi discrètement que possible, pour passer inaperçu. J’étais le seul » client « . Je tremblais en saisissant les livres. Tous me tentaient, même ceux auxquels je ne comprenais rien. Tous les livres sentaient bon. Je finis par me décider pour un petit livre mince, le moins cher, un petit poche, Le nègre du Narcisse de Joseph Conrad, et j’allai vers la caisse en serrant les fesses.
Je tendis le petit livre à la libraire. Elle le prit, le retourna, regarda sur une liste qu’elle avait près d’elle et m’annonça une somme. Je sortis la poignée de pièces de monnaie de ma poche et la déposai sur le banc de caisse. Du bout de l’index, elle sépara les différents centimes, fit le total et me dit : » Il n’y a pas assez, mon garçon. « Je sentis un grand frisson me traverser. J’avais presque envie de pleurer. La libraire repoussa toutes les pièces de monnaie vers moi et marmonna : « Aujourd’hui, je te fais cadeau du livre. Pour cette fois. » Et elle eut un tout petit sourire malicieux. Serrant mon bien contre la poitrine, je sortis de la librairie en vitesse, craignant que la libraire ne se ravise.
Je possède encore ce livre, il est au fond d’un carton.
(Francesco Pittau)
.
Libre air
Je connais L’Oiseau lire depuis sa sortie de l’œuf à Évreux, en 1993.
L’Oiseau lire m’a prise sous son aile, je lui ai donné à picorer mes images et je lui ai piqué quelques plumes pour écrire mes textes.
J’y ai exposé au long de toutes ces années les originaux de chaque nouvel album en rencontrant un public curieux, fidèle et enthousiaste.
À L’Oiseau lire, je trouve un libre air, un air de liberté indispensable à mes poumons, une aire libre où s’épanouissent par centaines des livres à dévorer des yeux et du cœur… Tout un éventail de mondes à rencontrer, à connaître, à déguster.
Dans les trésors choisis par Annie et Gwen, le livre à offrir qui tombe pile, les surprises et les émotions cachées là, au cœur des pages, et que ces passeurs me font découvrir.
Les vitrines à thèmes avec les changements de couleurs appréciés : on passe du jaune soyeux au bleu rêve, au blanc banquise…
L’attention portée aux « beaux livres », ceux qui nous font grandir, respirer plus large, espérer, en poésie, en albums, en bandes dessinées, en romans…
Les auteurs et les illustrateurs rencontrés, et tout ce travail régulièrement entrepris auprès des scolaires, les prix littéraires. Et ce salon du livre annuel qui me fait jubiler !
L’Oiseau lire ne peut pas disparaître, ma vie à Évreux serait remise en question : je sais bien que, sans le travail des libraires jeunesse, une bonne partie de mes albums passerait inaperçue.
Je crois que la mue de 2019 est pleine de promesses, L’Oiseau lire se construit un nouveau nid, je rêve aux couleurs ravivées de ce nouveau plumage et j’attends la réouverture prochaine. Bonjour Célia !
(Martine Bourre)