Récemment, une jeune institutrice bien intentionnée m’a invité dans sa classe après avoir commencé la lecture d’un de mes romans publié, en poche, chez un petit éditeur. Brandissant un exemplaire sorti de son sac, elle m’a révélé en désignant les feuilles agrafées posées sur chacune des vingt-cinq tables : « J’ai dû le photocopier, nous n’avons aucun budget pour l’achat des livres. »
Rien d’exceptionnel, ce n’est pas la première fois que je me trouve confronté à ce problème. J’explique à l’enseignante que cette pratique coûteuse (et interdite) contribue à tuer le livre. Coûteuse ? Les écoles ont un budget pour l’achat de papier, de photocopieuses – sans parler de leur maintenance et des toners. Le coût réel de la photocopie d’un roman de 200 pages dépasse largement 4,80 euros … sans compter que l’objet final ressemble bien peu à un livre !
Comme l’enseignante s’excusait d’avoir minoré mes bénéfices, je lui ai expliqué que je touchais … 0,22 euros par ouvrage. « Ce n’est donc pas si grave, me répondit-elle, je vous ai fait perdre cinq euros cinquante. »
Hélas, c’est plus compliqué et c’est plus grave. Un ouvrage est rentabilisé par l’éditeur à partir de 2 ou 3 000 exemplaires vendus. Imaginons qu’une centaine d’enseignants fasse acheter à leur classe 25 exemplaires d’un ouvrage. L’éditeur rentre dans ses frais (et je touche 2500 fois 0,22 euros, c’est-à-dire 550 euros à la fin de l’année). Mais si les cent enseignants agissent comme mon institutice, l’éditeur ne vendra que 100 exemplaires dans l’année – ne croyez pas que ce soit si rare, hélas ! – et il devra bientôt mettre la clé sous la porte, outre le fait que je toucherai alors dans l’année 22 euros pour avoir écrit un roman qui m’aura demandé des semaines voire des mois de travail.
La morale de cet incident en apparence mineur ? Certaines pratiques contribuent à tuer la création et le livre. On pense souvent que les auteurs vivent de l’air du temps, à l’image de cet éditeur (je préfère taire son nom) qui, en 1975, m’a jeté, face à mes prétentions : « Incroyable ! Non seulement je prends le risque financier de vous publier, non seulement vous allez avoir votre nom sur un livre, mais en plus vous voulez être payé ? » Bizarre : les enseignants, les éditeurs et leur personnel sont payés, mais le créateur, lui, devrait travailler gratis. C’est un peu comme si les gérants de supermarché jugeaient normal que les producteurs de tomates ne touchent rien. Après tout, c’est si agréable, le jardinage.
Dans le même ordre d’idée, Google a mis tout en place pour la numérisation future de tout ce qui a été déjà publié, en France comme ailleurs. Vous doutez ? Eh bien tapez simplement « Google livres » sur votre moteur de recherche, suivi du nom de n’importe quel écrivain vivant, moi si vous voulez, et vous constaterez que ses titres sont déjà tous répertoriés avec éditeur, nombre de page, résumé, extraits. Sympathique, n’est-ce pas ? L’accès futur serait gratuit – et tant pis pour les droits d’auteur – ce serait presque défendable, mais il n’y a que de naïfs internautes utopistes pour le croire. Google n’est pas une société à but non lucratif.
La vérité est que tout a un coût, même lorsque l’on croit (ou que l’on juge) que ce devrait être gratuit. Que les élèves ne paient pas le livre que l’enseignant souhaite leur faire livre, d’accord. Mais la fabrication de cet ouvrage, de l’écriture à la vente en librairie, a un coût. Décider qui doit payer – la collectivité, l’utilisateur – est un autre débat.
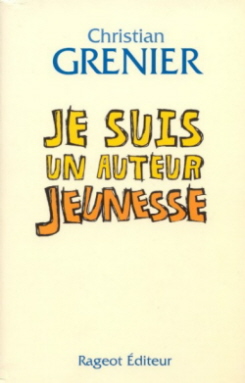
Né en 1945 à Paris, Christian Grenier sera professeur de lettres parce que ses parents, acteurs, ne souhaitent pas qu’il suive la même voie qu’eux. Le prix de l’ORTF qu’il obtient en 1972 pour son troisième roman, La Machination publié par GP, l’incite à écrire pour la jeunesse : textes de science-fiction, romans historiques, fantastiques, intimistes, policiers. Il travaille un temps dans l’édition comme lecteur et correcteur, rewriter, journaliste, directeur de collection, scénariste de bandes dessinées et de dessins animés pour la télévision (Les mondes Engloutis, Rahan). Quatre essais à propos de science-fiction dont, en 2003, La Science-fiction à l’usage de ceux qui ne l’aiment pas (Le Sorbier). Cofondateur de la Charte des auteurs et illutrateurs en 1975. Traduit en une quinzaine de langues, rencontrant très souvent ses lecteurs, il vit depuis 1990 dans le Périgord.