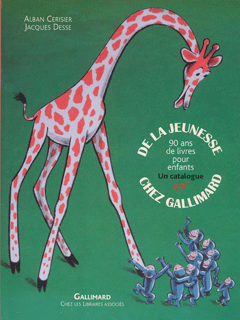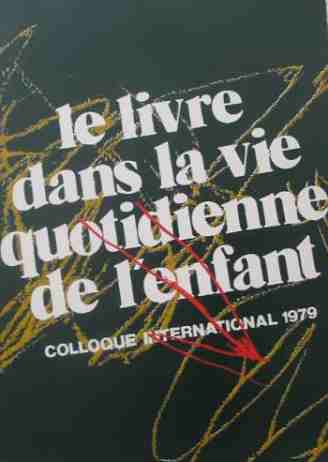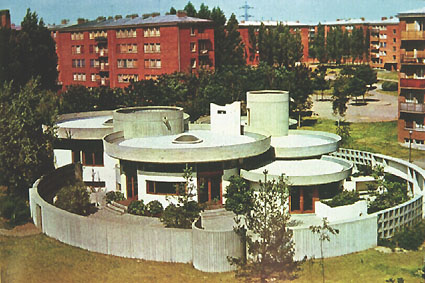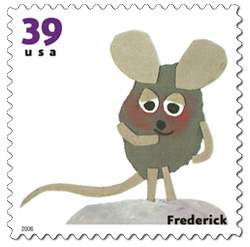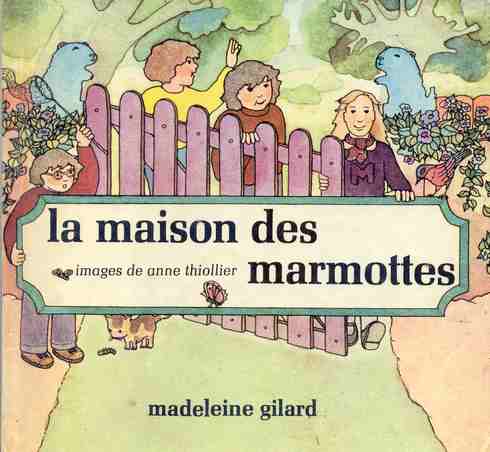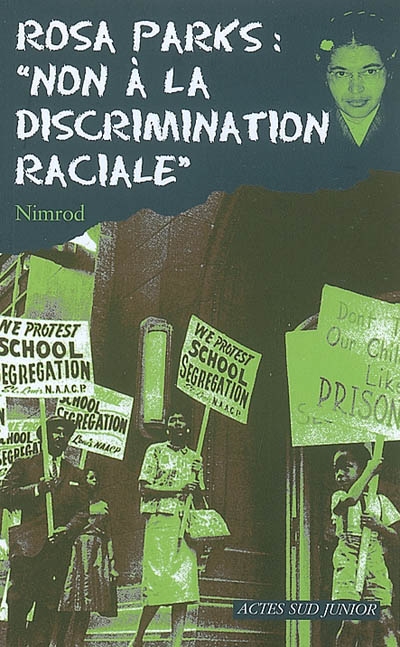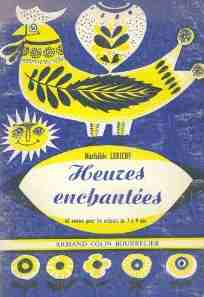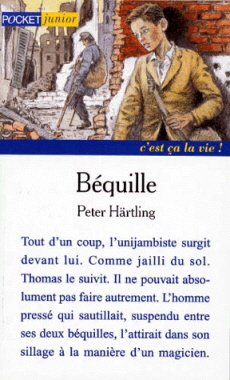La création poétique ne doit pas être confondue avec la diffusion de la poésie. On voit bien comment faciliter la diffusion, la préparer, la planifier ; par contre, la création est toujours « imprévisible et anarchique ». Au sein de la littérature enfantine, la création poétique occupe une place très originale, dans la mesure où la spécificité de la poésie conduit à rejeter l’idée d’une poésie « pour » les enfants : la vraie poésie est indivisible, simplement, les responsables de la diffusion (éditeurs ou pédagogues) choisissent des textes poétiques qui leurs semblent convenir aux enfants, ce qui est très différent.
Malgré le grand intérêt de certaines anthologies et de certains ouvrages de pédagogie, ils n’appartiennent pas à la création poétique proprement dite ; ils ne seront signalés ici que pour mémoire.
Les livres de création
On peut affirmer sans paradoxe qu’une bonne part de la création poétique contemporaine de qualité se trouve actuellement dans les livres à destination des enfants qui ont été un lieu d’expériences originales.
Les « commandes poétiques »
Par l’intermédiaire de certaines collections destinées aux enfants, quelques éditeurs ont joué ces dernières années un rôle considérable d’incitation à la création par de véritables commandes à des poètes contemporains. Il ne s’est pas agi de racler des « fonds de tiroirs », mais de publier des textes inédits, originaux, spécialement écrits ou réunis par l’auteur en un recueil individuel destiné aux enfants. C’est ainsi que des poètes importants comme Marc Alyn, Luc Derimont, Alain Bosquet, Lucienne Desnoues, Frédéric Kiesel, Eugène Guillevic, Daniel Lander, Bernard Lorraine, Pierrre Menanteau, Jean-Luc Moreau, Catherine Paysan, Gisèle Prassinos, Jean-Claude Renard, etc. ont publié des recueils à l’intention des enfants, parfois avec un plus grand succès que leurs recueils « pour adultes ».
Un deuxième type d’ouvrages apporte une aide directe à la création : il s’agit de recueils collectifs, de véritables anthologies spécialement conçues autour d’un thème pour une collection, mais ne regroupant, encore une fois, que des poèmes inédits, originaux, qui n’auraient jamais pu être publiés sans ce type d’ouvrages : il s’agit bien d’une « commande ». Là encore, la poésie vivante est directement concernée. Tel ouvrage de ce genre peut réunir une soixantaine de poètes contemporains, les plus connus permettant, par leur présence, la publication de poèmes d’auteurs moins connus. On trouve ainsi de jeunes « débutants », avec des poètes contemporains parmi les plus importants –du moins aux yeux du directeur de la collection qui, par son libre choix, « agit » de façon modeste mais réelle sur la création, en suscitant, par exemple, des textes de Jean Cassou, Jean-François Chabrun, André Chedid, Georges-Emmanuel Clancier, Luc Decaunes, Marc Delouze, Jean Desmeuzes, Charles Dobzinski, Luc Estang, Pierre Ferran, Pierre Gamarra, Georges Godeau, Jacqueline Held, Edmond Humeau, Jean l’Anselme, Jean Lescure, Jean Mogin, Jean Orizet, Pierre Sabatier, etc. Un joli palmarès ! Parmi tous les écrivains sollicités, certains n’auraient jamais pensé pouvoir proposer leurs textes à des enfants. Tous semblent avoir été très heureux de l’accueil fait à leurs poèmes.
Ces livres de poèmes, en général non illustrés, qui donnent donc la primauté au texte, s’adressent à des enfants à partir de 7-8 ans. La poésie qui est ainsi proposée est sans concession, elle n’est pas bêtifiante : elle n’aborde certes pas tous les thèmes (par exemple ni l’amour, ni la révolte), mais elle aborde des thèmes profonds, voire métaphysiques (la mort par exemple, traitée avec délicatesse) en des formes dont la diversité correspond à celle de la création poétique contemporaine.
Mais ces livres refusent, par une saine contrainte, tout snobisme, tout « truc » à la mode, pour une raison très simple : le public visé, celui des enfants, est un « vrai-public » – peut-être le seul « vrai public » aujourd’hui en matière de poésie.
En effet, il existe toute une frange snobinarde parmi les poètes qui n’écrivent que pour certains critiques ou directement pour la glose universitaire, visant avant tout l’utilisation du dernier « truc » à la mode, le scandale, l’hermétisme confus, l’imitation de ce qui « se fait », toute une sauce pour moyens de masse et tralala langagier qui en impose aux naïfs. Nous sommes alors loin du « plaisir poétique » dont parlait André Spire.
Rien de tel avec l’enfant : on ne peut pas le tromper ainsi. Sa « naïveté n’est pas du même ordre. La poésie qui s’adresse à l’enfant doit le prendre tout entier, car il ignore, a priori, le nom de l’auteur, sa renommée, son prestige, sa surface dans les journaux. Le poème doit être vraiment un texte qui le saisit, l’enchante, ou l’amuse, ou l’émeut, etc. : il faut vraiment que le poème agisse sur lui.
« Essayer » un poème avec des enfants, c’est un excellent moyen de remettre quelques valeurs à leur vraie place.
Des adultes sont aussi devenus lecteurs de tels ouvrages de poésie où ils trouvent (ou ils retrouvent) la poésie telle qu’ils peuvent la souhaiter, loin du n’importe quoi à la mode.
Bien entendu, de tels recueils personnels ou collectifs de poèmes inédits spécialement demandés à des écrivains n’ont pas tous la même valeur. Il y a des degrés dans la réussite. Mais un éditeur sérieux veille à ne pas infléchir la trajectoire d’un auteur, à ne pas lui demander de se trahir soi-même. Tout éditeur vise simplement à faire partager ses goûts. La pluralité des éditeurs est donc nécessaire en ce domaine pour garantir la pluralité des styles, le public restant juge.
Le rôle des pouvoirs publics dans cette incitation directe à la création poétique en direction des enfants a été faible jusqu’ici. Personnellement, j’estime qu’il doit le rester. L’Etat n’a pas pour mission, même par l’intermédiaire d’une commission, d’orienter la création poétique à l’intention des enfants. La diffusion, c’est autre chose.
Par contre, le rôle de l’école, des bibliothèques, des librairies, a été important pour faire connaître ces livres de création et insister sur leur originalité en servant de médiateurs. De même, le rôle de certains compositeurs de chansons pour les enfants, comme James Ollivier, Max Rongier, Christiane Oriol, Jacques Douai, etc. Mais nous touchons ici plus à la diffusion qu’à la création –encore que la mise en chanson oblige parfois l’écrivain et le musicien à un dialogue qui modifie le texte. Quant au rôle de la Grande Presse, il a été ponctuel et insuffisant. Bien des journaux sont encore prisonniers d’un certain mépris à l’égard de livres qui s’adressent en priorité aux enfants, il leur est difficile d’admettre qu’un renouveau poétique se trouve dans ces livres-là.
Ces livres de création poétique originale doivent pourtant obtenir un succès commercial permettant à l’éditeur de poursuivre sa politique de « commandes » –donc d’incitation à la création. Mais ces ouvrages sont particulièrement sensibles au « piratage » : les enseignants, les bibliothécaires, etc. doivent savoir que si la reproduction par photocopie est très pratique, elle est nuisible à la création future, car elle pénalise l’éditeur, le poète –et les auteurs à venir. Il n’est cependant pas souhaitable de taxer spécialement les machines à reproduire pour compenser ce manque à gagner : l’expérience montre qu’une commission s’arrogerait le droit de décider des subventions à distribuer.
En tout cas, on peut estimer que la poésie vivante se trouve aujourd’hui davantage dans ces livres à destination des enfants que dans de prétentieuses plaquettes qui ne sont que de « vains bibelots d’inanité sonore ».
Les jeux de langage
Par ailleurs dans la grande nébuleuse des livres « pour » les enfants, on assiste depuis longtemps à une floraison d’ouvrages tournant autour des « jeux de langage ». Leur pauvreté poétique est en général consternante et ces abécédaires d’un nouveau genre n’ont rien à voir avec la poésie –ni l’enfance : on bêtifie, on répète, on tourne en rond, c’est conventionnel, plat, sans invention. Il faut être exigent et dénoncer de telles sottises qui n’entrent pas dans la création vivante. Ba, be, bi, bo, bu constituent sans doute une étape dans l’apprentissage de la lecture, mais il est exagéré de présenter cette ritournelle comme un poème.
Certes, il peut exister des ouvrages de qualité consacrés aux jeux de langage : mais on est alors plus proche de la pédagogie que de la poésie. On voit bien d’où vient la confusion : la poésie se fait « avec des mots » comme disait Mallarmé, le langage est sa matière première. Mais la poésie entend par le langage dire plus que le langage, atteindre un « surréalisme » pour les uns, toucher l’âme pour les autres, en aucun cas elle ne peut se contenter d’en rester au niveau des sonorités. Or, ces ouvrages sont pléthoriques. Il faut les remettre à leur humble place.
La poésie étrangère
On le sait : la traduction de la poésie est impossible… et indispensable. Il existe actuellement aussi bien de déplorables traductions dans les livres pour enfants que de remarquables réussites. Quelques ouvrages sont bilingues et, à ce titre, intéressants a priori (mais il faut y regarder de très près). Il est évident que la véritable traduction est re-création, et elle ne peut être faite que par un poète français. Les règles de jeu sont très difficiles, mais connues ; après les remarquables études d’Etkind sur l’art de la traduction-recréation, il est impardonnable de proposer aux enfants de lamantables mot-à-mot avec des « contresens poétiques ». Les éditeurs devraient être plus attentifs à la qualité de ce genre d’ouvrage.
Les anthologies
Depuis La poèmeraie d’Armand Got (1928), mais surtout depuis 1950, nous avons assisté à un renouveau considérable d’anthologies poétiques rassamblant des textes modernes, à l’intention des enfants.
Comme elles regroupent presque exclusivement des poèmes pré-existants publiés par ailleurs, ces anthologies n’entrent pas dans le cadre de la création vivante –donc de ce colloque– mais elles apportent une aide indirecte à la création en développant le plaisir et la connaissance de la poésie, en modelant les goûts : un poète aussi important que Jean Tardieu fut très surpris quand il constata l’accueil fait par des enfants à ses textes extraits de Monsieur Monsieur aux résonnances philosophiques, voire métaphysiques.
Sans les étudier ici, il faut rappeler, face au snobisme dépréciateur de pseudo-élites, la très grande importance des anthologies dans la survie et la transmission du patrimoine poétique d’une part, dans la connaissance de la poésie contemporaine d’autre part : le bagage poétique des enfants à l’école élémentaire est aujourd’hui bien plus important que celui des adultes ; le paysage poétique de l’école a considérablement changé, c’est celui de la poésie de notre temps (ou d’une grande partie de la poésie de notre temps).
Les anthologies de poèmes déjà publiées par ailleurs en des recueils personnels, proposent aujourd’hui une poésie vivante. Mais elles ne participent pas directement à la création. Leur influence mériterait pourtant une étude attentive.
Les ouvrages pédagogiques
De nombreux ouvrages pédagogiques consacrés à la poésie ont été publiés ces dernières années. C’est une démarche nouvelle, et paradoxale dans la mesure où la création poétique échappe évidemment à toute recette.
Mais il est vrai que la poésie est un art – donc qu’on y trouve des techniques pouvant être enseignées (des « trucs » diront les pessimistes).
La plupart de ces livres destinés à des pédagogues se répètent (certains copient les précédents) et proposent surtout des jeux de langage. Plusieurs ne sont, au fond, que des « exercices de vocabulaire et d’élocution » un peu modernisé. Les meilleurs expliquent qu’il s’agit d’un esprit et non de recettes pour devenir poète en quelques leçons.
Malgré bien des réserves sur l’originalité et la valeur de la plupart de ces livres (souvent publiés par des éditeurs de « classiques ») ils correspondent à une volonté essentielle et assez nouvelle pour être soulignée : mener les enfants à s’exprimer, par un de ces textes mystérieux qu’on appelle « poème », ce qu’ils ont en eux de plus profond (et qu’ils ne savaient peut-être pas avoir en eux). Il s’agit d’amener l’enfant à faire une expérience de la création. Ambition difficile à réaliser, mais importante et qui devrait être un aspect fondamental de toute pédagogie.
L’école ne vise pas à former des « professionnels », mais des « auteurs ». La valeur esthétique des poèmes écrits par des enfants ou par des adolescents est le plus souvent très faible, mais leur valeur psychologique est considérable, tout comme l’intérêt sociologique de ces poèmes qui ont parfois été publiés. Mais ils ne semblent pas avoir eu d’influence sur la poésie contemporaine, pas plus que ne peuvent en avoir les études pédagogiques.
Cependant, l’interrogation sur la création poétique contemporaine dans la littérature pour les enfants ne peut négliger cette importante constatation : aujourd’hui, la création poétique, c’est aussi l’enfance, à cet égard, l’école est devenu un lieu de création, quoi qu’en disent nos tristes détracteurs. L’enseignement ne vise pas la répétition, mais l’invention ; il ne réussit pas toujours, étant donné le poids des structures sociales et familiales. Du moins existe-t-il, grâce à l’école, un endroit où la création est reconnue.
La création poétique a joué ces dernières années dans le livre pour les enfants, un rôle qui est loin d’être négligeable. Ce lieu d’accueil a, en retour, influencé la création elle-même en lui rappelant ses liens avec l’enfance.
Cependant la situation me semble moins favorable depuis quelques mois.
Non seulement ce secteur subit comme d’autres (plus que d’autres ?) les effets d’une certaine « crise du livre », mais il souffre également d’une baisse de qualité moyenne.
Il serait tout à fait illusoire, et même dangereux à mon point de vue, de faire intervenir en matière de poésie l’Etat, ses commissions, des chapelles, des spécialistes, etc.
Mieux vaut compter sur la vigilance et le discernement des relais entre le livre et l’enfant, enseignants, pédagogues, bibliothécaires, critiques, etc., pour qu’ils sachent distinguer entre la création véritable –et la répétition, l’invention créatrice -et le balbutiement, la poésie vivante –et le « truc » à la mode.
La vitalité de la création poétique dans le livre pour enfants dépend en grande partie de l’exigence des éducateurs –et de leur formation.
( texte paru dans le n° 21 – octobre 1983 – du bulletin du CRILJ )
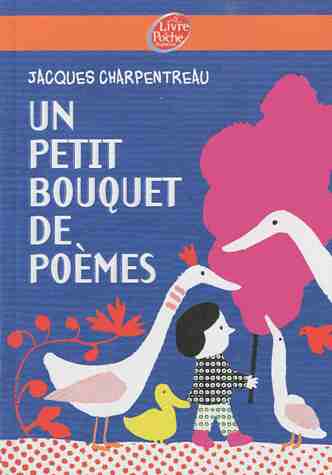
D’abord instituteur et professeur, puis écrivain, anthologiste, directeur de collections chez plusieurs éditeurs, Jacques Charpentreau fit beaucoup pour la diffusion de la poésie. Parmi ses nombreux recueils pour jeunes lecteurs : Poèmes d’aujourd’hui pour les enfants de maintenant et Poèmes pour les jeunes du temps présent. Il écrivit aussi, pour les enfants, de nombreux romans (Comment devenir champion de football en mangeant du fromage, La Famille Crie-toujours). Auteur, pour des lecteurs adultes, de poésie, de théâtre, de pamphlets, il est président de La Maison de Poésie. Très attaché au CRILJ, il en fut longtemps l’un des vice-présidents.