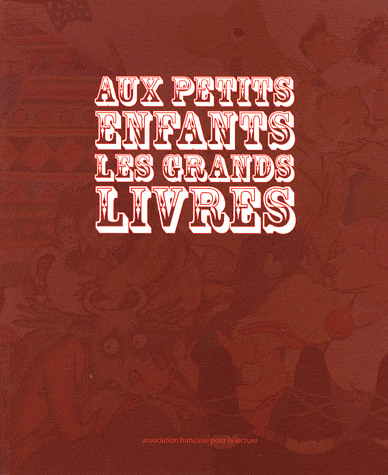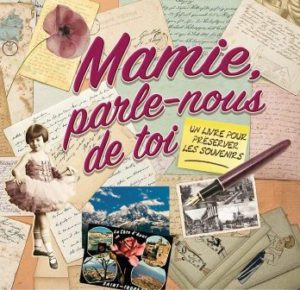L’enfant, la fiction et l’école
Pour l’enfant comme pour l’adulte, la fréquentation du monde des fictions est primordiale, tant pour son équilibre psychique que pour la construction de son identité culturelle. Et les éducateurs que nous sommes sont en droit de se demander si la place que l’école réserve aux histoires et le statut qu’elle leur reconnaît sont à la mesure des enjeux.
Les histoires racontées – ou lues – les contes, les légendes sont présentes dans nos classes, chacun le sait, notamment à l’école maternelle ; mais on n’a pas l’impression que cette présence de la fiction reflète un intérêt profond pour l’imaginaire ; d’ailleurs les enseignants qui organisent des activités de création verbale et de construction de récits sont encore rares.
Tout se passe comme si l’attrait que la fiction exerce sur l’enfant servait uniquement de motivation à la pratique d’autres activités : activités manuelles, graphiques, motrices, ludiques… organisées à l’école maternelle à partir d’un conte ; apprentissage et entraînement à la lecture à l’école primaire dans des pages de romans.
On pourrait multiplier les exemples qui montreraient que notre système éducatif, fidèle en cela à la tradition philosophique occidentale, a eu depuis un siècle une attitude de méfiance, voire d’hostilité à l’égard de l’imaginaire et de la fiction.
Tout le monde s’accorde pour considérer que l’objectif essentiel de l’éducation est l’émergence et la construction de la pensée rationnelle. Mais faut-il pour autant, au nom de la connaissance scientifique et raisonnée, nier l’existence d’une autre connaissance subjective et imagée ?
Sur ce point capital, l’apport de Gaston Bachelard est particulièrement éclairant. Pour lui en effet, les concepts rationnels et les créations imaginaires se développent sur deux axes divergents de notre pensée, mais sont complémentaires et constituent en définitive « l’unité de notre vie psychique ».
Et si « l’esprit scientifique doit sans cesse lutter contre les images, contre les analogies, contre les métaphores » (Bachelard, Formation de l’esprit scientifique), de même l’homme de sciences « doit oublier son savoir, rompre avec toutes ses habitudes de recherches philosophiques, s’il veut étudier les problèmes posés par l’imagination poétique » (Bachelard – Poétique de l’espace).
Mais c’est bien le même homme qui rêve et qui pense alternativement, qui parcourt tour à tour, mais sans jamais les confondre, les deux axes de la vie spirituelle ; rationalité en animus, rêverie en anima, Bachelard reprend et développe l’analyse que fait Jung de la dualité profonde – masculin et féminin – de notre psychisme et en montre la richesse :
« Il faut connaître la bonne conscience du travail alterné des images et des concepts, deux bonnes consciences qui seraient celle du plein jour et celle qui accepte le côté nocturne de l’âme ». (Bachelard – Poétique de la rêverie).
Retenons de la pensée du philosophe que l’imaginaire et le rationnel sont aussi nécessaires l’un que l’autre à notre équilibre psychique.
L’action éducative peut donc – sans craindre de sacrifier à l’infantile – avoir un projet ambitieux dans le domaine de l’imaginaire, notamment par la fréquentation du monde de la fiction (aussi bien par la découverte des œuvres existantes que par la pratique des activités de création).
Ce projet ambitieux de l’école est d’autant plus nécessaire que l’importance de la fiction dans notre vie quotidienne a diminué au cours de ce siècle en particulier, de même que son statut social s’est considérablement dévalorisé ; et cette double évolution qui est particulièrement nette au niveau de l’enfance, se manifeste notamment par la perte d’influence de la pensée mythique, la désacralisation de notre société et le dépérissement de la tradition orale.
Il ne s’agit pas de le regretter ou de s’en féliciter, mais de constater que les moments où nos enfants peuvent rencontrer et apprendre à aimer les héros mythiques sont devenus rares ; et que plus rares encore sont les occasions où ces fictions sont présentées comme des choses sérieuses…
Parallèlement à cette évolution – comme un espace de communication ne reste jamais vide – l’environnement des enfants se voit envahi par une inflation de sous-produits médiatiques qui se caractérisent par une écriture infantilisante, une structure stéréotypée à l’extrême et un simplisme manichéen consternant.
On peut affirmer que sur ce plan notre société a considérablement régressé, et que l’héritage mythologique qu’elle transmet à ses enfants est d’une grande pauvreté par rapport à ce que peut connaître un petit africain, ou ce qu’a pu vivre un petit provençal du début du siècle.
Bettelheim souligne ce danger à propos des versions filmées des contes de fées :
« De nos jours les enfants sont gravement lésés (…). La plupart d’entre eux, en effet, n’abordent les contes que sous une forme embellie et simplifiée qui affaiblit leur signification et les prive de leur portée profonde. Je veux parler des versions présentées par les films et les spectacles télévisés qui font des contes de fées des spectacles dénués de sens ».
Dans ces conditions il est évident que le rôle de l’école pour l’initiation des enfants au monde des récits et des mythes est capital ; car, si l’école n’ouvre pas largement les portes de la fiction, si elle ne favorise pas cette fréquentation, si elle n’aborde pas avec le sérieux et la gravité nécessaires ces histoires, nul ne le fera à sa place, et les « Petit Poucet » qui passent par nos classes ne vivront « qu’une moitié de vie », selon le mot de B. Duborgel.
Fréquenter le monde de la fiction
Fréquenter le monde de la fiction c’est donc un objectif essentiel de l’éducation, dès le plus jeune âge et tout au long de la scolarité (au-delà aussi, bien entendu).
Quelles en sont les voies et les moyens ? On en relèvera trois, qui ne sont pas originales, mais qui prendront dans ce contexte toute leur cohérence.
– La découverte de la fiction par le récit oral d’abord, puis progressivement (et de plus en plus) par la lecture.
– La création d’histoires par l’improvisation orale d’abord puis par la conquête progressive de l’écriture (au sens plein du terme).
– L’immersion dans le monde de l’imaginaire où l’enfant vit pleinement la fiction par la rêverie et le jeu ; de la rêverie secrète et fugitive au jeu libre, puis au jeu organisé et collectif, pour aborder enfin la mise en scène et le jeu dramatique.
Il s’agit de trois manières de pénétrer le monde de la fiction qui trouvent dans le psychisme de l’enfant cohérence et complémentarité ; et qui se nourrissent l’une de l’autre comme elles se nourrissent de l’expérience du monde réel.
Découvrir une fiction, c’est prendre connaissance d’une situation vécue, par la lecture, l’écoute ou le spectacle ; c’est un voyage hors de l’instant présent et une puissante incitation à la rêverie pendant et après le récit.
Et cette rêverie qu’un inconnu nous a transmise, il nous arrive de nous y reconnaître, de la croire nôtre, et parfois de la prolonger :
« Si nous recevons vraiment les images des poètes, elles nous apparaissent comme des documents de rêverie naturelle. A peine reçues, voilà que nous imaginons que nous aurions pu les rêver… Nous lisions et voilà que nous rêvons » (Bachelard – Poétique de la rêverie).
Car vivre une histoire, c’est aussi découvrir le besoin d’inventer, de créer à son tour, de bâtir soi-même un monde. Bachelard, encore, en porte témoignage :
« Personne ne sait qu’en lisant nous revivons nos tentations d’être poète. Tout lecteur un peu passionné de lecture, nourrit et refoule, par la lecture, un désir d’être écrivain. Quand la page lue est trop belle, la modestie refoule ce désir. Mais le désir renaît » (Poétique de l’espace).
Cette interaction entre l’imaginaire d’un autre dont nous savourons la substance, et nos rêveries secrètes qui prennent forme lentement nous entraîne dans des voyages exaltants où se mêlent au plus profond nos élans intimes et la résurgence des personnages fictifs qui sont nos compagnons de rêve.
Empruntons au Sartre des Mots une des plus belles illustrations de cette puissance créatrice et assimilatrice de l’imaginaire. Se retournant vers son passé, l’écrivain montre dans ces pages consacrées à ses rêveries d’enfant, comment l’imagination se développe sur un fond complexe où interfèrent trois facteurs :
– d’abord les préoccupations, les désirs ou les angoisses de l’enfant,
– ensuite le monde des personnages de fiction qui lui sont familiers (et le monde du cinéma muet),
– enfin l’environnement immédiat qui façonne son état d’esprit : ainsi les sentiments de crainte, de morosité ou de gaieté se succèdent au rythme du jeu des sonorités et des lumières.
Sous cette triple influence, l’enfant lance sa rêverie, et avance dans le récit qui se noue, se dénoue, rebondit…
Sartre réussit dans ces pages à nous faire sentir le lien ambigu et mystérieux entre la perception du réel et la création imaginaire ; entre les élans de l’enfant et les échos que lui renvoient ses héros familiers ; entre la volonté qui mène le jeu et l’affectivité qui se laisse entraîner par l’atmosphère…
Tous les enfants vivent cela, et bien des adultes aussi ; tous les enfants connaissent le bonheur de la vie rêvée !
Le rôle de l’école n’est-il pas dans ce domaine de s’efforcer de donner à chaque enfant les aliments de ses rêveries et les occasions de les vivre ?
( texte paru dans le n° 70 – juin 2001 – du bulletin du CRILJ )
Inspectrice d’académie et inspectrice pédagogique régionale vie scolaire honoraire, Anne Rabany s’intéresse à la littérature pour la jeunesse depuis son entrée dans l’enseignement. Elle a participé à différentes actions de promotion de la lecture : Plans lecture de la Ville de Paris et de l’académie de Créteil, développement des BCD, formation d’animateurs, tournées culturelles pour les centres de vacances de la CCAS/EDF. Publications dans de nombreux périodiques (Textes et documents pour la classe, Ecole des parents, Monde de l’éducation…). Contributions à plusieurs ouvrages collectifs dont une étude sur “Les enfants terribles dans les albums” dans L’Humour dans la littérature de jeunesse parue chez In Press en 2000. Anne Rabany intervient au niveau des masters 1 et 2 d’édition à Montauban (université Toulouse-II – Le Mirail) ainsi qu’au Pôle Métiers du Livre de Saint-Cloud (université Paris-X). Elle participe, au plan national, à l’activité du CRILJ et a rejoint le comité de rédaction de la revue Griffon.