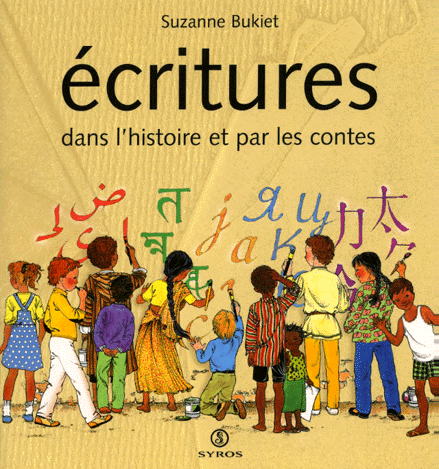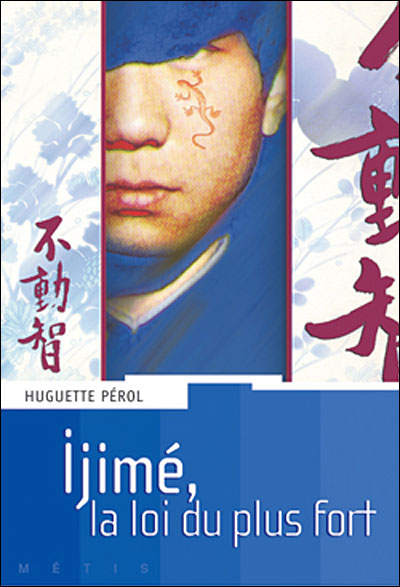par Monique Hennequin
Ecrit en 2009 par celle qui fut pendant plusieurs dizaines d’années secrétaire générale du CRILJ, à un moment où peu nombreux étaient ceux qui croyaient aux chances de survie de l’association, ce texte en forme de bilan apprendra beaucoup à ceux qui aujourd’hui découvre le CRILJ ou qui en ont oublié l’histoire. A lire (ou à relire) et à garder dans un coin de sa mémoire … dans l’attente du jubilé de 2015.
Le Centre de Recherche et d’Information sur la Littérature pour la Jeunesse, carrefour de toutes les activités concernant la littérature pour la jeunesse était ouvert à toutes les initiatives éducatives et culturelles, dans le cadre associatif et institutionnel. Conscient de la nécessité d’une promotion de la littérature pour la jeunesse, le CRILJ a proposé pendant une trentaine d’années une plate-forme d’informations, de rencontres et de réflexions.
Le CRILJ [tel qu’il fonctionnera à compter de 1974] est né à l’issue de journées d’études organisées au Centre International d’Etudes Pédagogiques, à Sèvres, par son directeur Jean Auba, inspecteur général de l’éducation nationale et du travail de la Section française de l’Union Internationale des Livres pour la Jeunesse (IBBY) lors d’une rencontre organisée par cette dernière à Marly le Roi, en octobre 1973.
Sous la présidence de Jean Auba, il a repris le nom d’une association créée en 1965 autour de Natha Caputo, critique et journaliste au Progrès de Lyon, Isabelle Jan, productrice à la radio, Mathilde Leriche, bibliothécaire à l’Heure joyeuse, Marc Soriano, professeur d’université, Jacqueline Dubois, institutrice, et Raoul Dubois, son époux, instituteur et critique, Raymonde Dalimier, bibliothécaire au Lycée La Fontaine.
Le CRILJ par ses statuts association loi 1901 sans but lucratif a été agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports en 1979, et reconnue d’utilité publique en 1983. Il a toujours observé une rigoureuse indépendance et une totale neutralité par rapport à tout mouvement politique ou confessionnel. Il est ouvert autant aux utilisateurs du livre qu’aux professionnels du livre.
Le CRILJ a surtout été composé de membres individuels, venant de toutes les régions de France et regroupant les illustrateurs, écrivains, éditeurs, libraires, critiques, journalistes, documentalistes, bibliothécaires des secteurs public et privé, enseignants de la maternelle à l’université, personnels du secteur médical ou paramédical, animateurs culturels et scientifiques, parents et toute personne s’intéressant à la littérature de jeunesse et au développement de l’enfant. Une grande majorité des adhérents font des actions de terrain et se retrouvent dans les sections régionales du CRILJ.
AUTOUR DES LIVRES POUR LA JEUNESSE ET DU MOUVEMENT DES IDEES
Dès sa création le CRILJ a lancé la mise en œuvre d’une série d’études et de confrontation dans un grand nombre de domaines et il s’est aussi penché sur les grands problèmes de notre société, vus à travers la littérature de jeunesse.
En 1975, au Festival du Livre à Nice, le CRILJ tenait un colloque sur La place et le rôle du livre dans la vie des jeunes et la place de la lecture dans l’éducation de la jeunesse.
En 1977, une rencontre était proposée, au CIEP Sèvres, réunissant des pédagogues, libraires, chercheurs, graphistes ayant une expérience de formation dans le domaine de la littérature de jeunesse.
En 1978, un « cycle d’études » dans le cadre du Laboratoire de Psychologie en milieu scolaire, réunissant un samedi après-midi par mois, une trentaine de personnes (dont la moitié de province) était organisé par Hélène Gratiot-Alphandéry, vice-prési-dente du CRILJ et directeur à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. Les intervenants étaient Mme Chombard de Lauwe, le professeur Widlocher, Georges Jean, Jacques Wittwer, Jacqueline Danset, Marc Soriano, Denise Escarpit, Michèle Kahn.
Après avoir constaté que la presque totalité des documentaires sur les sciences et les techniques étaient des traductions et pour sensibiliser les scientifiques français, en 1980, un colloque ayant pour thème Où se situe la demande des enfants en matière de livre scientifiques et techniques a eu lieu, sous la présidence de Jean-Claude Pecker, professeur au Collège de France, au Centre Georges Pompidou, réunissant 150 personnes et une quarantaine de jeunes venus de toute la France.
Le résultat de ce colloque a été la création de deux collections avec des ouvrages écrits par des scientifiques français, chez Hachette sous la direction de Patrick Baradeau et chez Nathan avec Daniel Sassier.
En 1982, A Saint Etienne, se sont réunis plus de 300 personnes sur le thème : Littérature pour la jeunesse : la création en France. Il s’agissait de faire le point sur la situation des années fin 70, début 80 et d’essayer de stimuler la création par des propositions concrètes des groupes concernés : écrivains, illustrateurs, techniciens du livre et de la presse, mais aussi de faire prendre conscience aux médias de l’importance de leur rôle.
La création a vraiment été au centre des débats de ce Colloque. On pourrait citer quelques réflexions des participants : « La création, c’est le retour aux sources de l’élémentaire » (Georges Jean) – « La création est une vraie littérature de l’imaginaire, les livres ne délivrent pas de message monolithique étroit, ils constituent des graines que l’on sème en aveugle » (Jacqueline Held) – « Le livre est le plus enrichissant des jeux, le livre c’est la complicité entre l’auteur et le lecteur » (Huguette Perol)
Le cri de Jean Claverie « Apprenez à connaître les gens de l’image » fut entendu puisque dès 1983, les illustrateurs regroupés firent appel au CRILJ, pour présenter sous son égide une exposition de dessins originaux, accompagnés des livres correspondants – 82 illustrateurs et 250 dessins originaux étaient au rendez-vous au Salon du Livre, à Paris, au Grand Palais – Une présentation des différents courants de l’illustration par Janine Despinette avait fait l’objet de l’éditorial du catalogue du Salon.
Préalablement, ce colloque en leur donnant l’occasion d’une première rencontre entre eux aura permis une reconnaissance des illustrateurs en tant qu’artistes à part entière, ce qui n’existait pas jusqu’alors. Il aura été le début de la présence des illustrateurs dans les classes et aussi d’expositions dans les bibliothèques et autres lieux.
En 1986, aété organisé en collaboration avec la BPI, sous la présidence de Jacques Charpentreau, un colloque consacré à la poésie L’Enfant et la Poésie. Une importante collecte d’expériences réalisées avec des enfants a été présentée avec l’aide efficace de Christiane Abbadie-Clerc, alors responsable de la Bibliothèque des enfants du Centre Georges Pompidou.
Premier colloque sur ce thème qui avait réuni 150 personnes et qui a permis de confronter les points de vue sur le rôle et la situation de la poésie, notamment contemporaine, à l’école et vis à vis du public.
Après avoir travaillé sur une bibliographie avec le Groupe de Recherche en Education Nutritionnelle (GREEN) et le Professeur Deschamps du Centre de Médecine Préventive CMP) de Vandoeuvre les Nancy, le CRILJ a organisé en 1987, en partenariat avec les institutions précitées, un colloque La santé, le livre et l’enfant qui avait pour but d’informer les non-spécialistes de littérature de jeunesse médecins, orthophonistes, infirmières, professions para-médicales) de ce qui existait sur les différents thèmes liés à la santé, sur leur approche, du documentaire, de la symbolique à la fiction.
Nous rappellerons les paroles du Dr Schwartz : « Le message de la santé n’est pas neutre, d’où nécessité de faire équipe : éducateurs, professionnels de la santé et du livre pour que s’épanouisse la vie ».
En 1988, le CRILJ avait réuni, au Collège de France, sous la présidence de Jean-Claude Pecker, une cinquantaine de personnes, sur le thème L’enfant sous influence : culture et conquête de son autonomie, avec Jacques Perriault, Suzanne Mollo, Isabelle Jan et une remarquable introduction d’Hélène Gratiot-Alphandéry.
Avant l’acte unique européen, il a semblé au CRILJ, important de se poser la question sur les enjeux de 1992 concernant la littérature pour la jeunesse dans l’Europe de demain, d’où un colloque, en 1989, co-organisé par le CRILJ et la Bibliothèque d’Information du Centre Georges Pompidou, sous la présidence d’Emile Noël, directeur général de la Communauté européenne à Bruxelles et président de l’Institut universitaire européen de Florence.
En 1991, Le CRILJ organisait pour Jean Perrot, membre de l’IRSCL du 10ème Congrès de l’IRSCL à l’Ecole Polytechnique, qui avait pour thème L’application des théories contemporaines de la Culture et de la Littérature de Jeunesse.
1997 : La tolérance, la littérature de jeunesse peut-elle participer à la formation des jeunes lecteurs ?
Pour toucher des publics différents, un thème non littéraire au sens propre du terme a été proposé pour un colloque, sous la présidence de Roger Bambuck, Le sport, c’est aussi dans les livres, à l’INJEP, en 1997.
En 1999, au Palais de la Découverte, nous avons souhaité organiser des rencontres destinées aux animateurs de clubs scientifiques et de centres de loisirs pour une utilisation de livres pour la jeunesse dans leurs pratiques avec les jeunes, ce qui a donné lieu au colloque Lire la science, s’ouvrir au monde, sous la présidence de Jean-Claude Pecker.
L’image des adultes se détériorant dans les romans, un colloque a été organisé, en 2000, à l’INRP, sur le thème L’image des adultes dans la littérature pour la jeunesse, où il a été essayé de répondre à quelques questions sur l’évolution de l’image de l’adulte, présent ou absent, modèle ou caricature ? Quel lien a-t-il avec la société ? Des inter- venants d’autres pays sont venus nous dire sous quelle forme l’adulte était présenté dans la littérature de leur pays : Penny Cotton, de l’université de Roehampton, Carla Poesio, du Comité scientifique de la revue LIBER de Florence, Jean-François Bouttin, de l’université Laval à Québec
En 2001, un échange de réflexion intéressant se tenait, à la Société des Gens de Lettres, sur Le livre, un produit comme les autres ? « Il est un temps pour la rapidité, celui de l’économie de marché, un temps que l’on espère préserver par la lenteur, celui de l’auteur, de l’illustrateur et du libraire, un temps pour l’écoute, celui de tous les passeurs de livres ». où avaient pris la parole François Rouet, économiste et attaché au Ministère de la Culture, Ahmed Silem, professeur d’université, des éditeurs ont témoigné : François Geze pour La Découverte- Syros et Dominique Korach pour Flammarion.
Beaucoup d’adultes s’interrogent sur la prévention face au mal de vivre de l’adolescence. Aussi le CRILJ a-t-il proposé aux psychologues de l’hôpital Necker à Paris de réfléchir comment et avec quel contenu la littérature de jeunesse abordait la Prévention. A partir de cette interrogation est née l’idée de proposer en 2002 un colloque Les maux dans les mots aux animateurs et professionnels de la santé. Une enquête auprès des collégiens lancée avec la collaboration d’Inter-CDI, eut un retour de 500 réponses.
En 2005, La précarité dans les livres pour enfants, était-ce un phénomène de mode ou une réflexion sur ce qu’elle est et comment la faire percevoir aux jeunes à travers les ‘’passeurs de livres’’ ?
Reprenons les mots laissés par Raoul Dubois qui avait soutenu ce projet : ‘’Et si la précarité n’était en fait que le nouveau moyen de conjurer ce mot, ce mot qu’on avait cru banni et renvoyé aux images du passé, celles de la pauvreté ».
Seynadou Dia et Lydiane Chabin, militantes du Secours Populaire Français ont apporté l’éclairage de leur expérience au contact quotidien de ces réalités vécues. Le sociologue Jean-Charles Lagrée et le psychanalyste Claude Allard ont abordé la question en combinant les approches économique et sociologique, Anne Rabany, inspectrice d’Académie a présenté une « géographie de l’école » au regard de la précarité. Pour Alain Serres « mêler sa plume au mouvement du monde, est son projet, mais pas à n’importe quel prix. »
Quant aux jeunes ayant rempli le questionnaire : le mot « précarité » n’est pas de leur langage.
Internet envahissant l’espace, on se devait au CRILJ de s’interroger sur la place du livre et de la lecture à l’ère numérique. Il nous a semblé important de réfléchir sur les problèmes qui désormais se posent et comment inciter les médiateurs à un nouveau regard sur leur rôle pour une approche différente de la lecture, une incitation au désir de lire, à la circulation de textes de qualité, à la promotion de la littérature pour la jeunesse. C’est ainsi qu’est née en 2006 l’idée d’un colloque qui a eu lieu en juin 2007 à la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord, co-organisé avec Ghislaine Azémar, Henri Hudrisier de l’université Paris 8. Existe-t-il un projet d’une bibliothèque jeunesse numérique au service des langues et des cultures, pour une culture humaniste ?
Au-delà de la numérisation, Internet, avec les moteurs de recherche, inaugure une nouvelle forme d’accès au savoir. Les chercheurs s’interrogent sur les compétences de lecture que les jeunes désormais doivent acquérir pour maîtriser à la fois l’outil, les codes et le contenu. La formation à la recherche et au traitement de l’information est une préoccupation des éducateurs, qui vise non plus une formation info documentaire mais une véritable culture de l’information.
Les jeunes ne sont plus seulement les enfants de l’image. Ils naviguent sur la toile et bénéficient d’un réseau de communication numérisé permettant le passage d’un média à un autre. Consommateurs avides de jeux vidéo, ils sont des lecteurs à leur manière
Les communications étaient remarquables et même très savantes.
LE CRILJ ET SES PARTENARIATS AU FIL DES ANNEES
Dès 1977, avec Travail et Culture et Georges Jean, pour une exposition dans les comités d’entreprise, le CRILJ a assuré le choix des livres, la réalisation des panneaux de présentation et le concours des animateurs pour une opération Les livres pour les jeunes et le monde d’aujourd’hui.
A la demande de la Délégation à l’Information scientifique et technique (DBMIST) du Ministère de la Recherche, présentation pendant plusieurs années de livres scientifiques et techniques pour les jeunes, dans le cadre du Salon de l’Enfance, de manifestations au Palais de la Découverte ou lors de la Fête de la science dans les jardins de l’ancienne Ecole Polytechnique, rue de la Montagne Ste Geneviève, à Paris
En 1978, dans le cadre de l’année internationale de l’enfant, l’UNICEF et la Commission française de l’Unesco ont organisé un colloque Le livre dans la vie quotidienne de l’enfant auquel le CRILJ a été largement associé dans la préparation.
En 1984 et 1985, le CRILJ a collaboré à toutes les actions du Ministère de la Jeunesse et des Sports concernant le livre et la lecture dans le cadre de la Semaine Le livre et les jeunes. Sensibilisation de 500 libraires pour une vitrine – Participation au train Paris-Pékin – Mise en place des « Point Rencontre Information Littérature de jeunesse » en province avec les Francas, les CRIJ et les sections régionales du CRILJ.
De 1984 à 2007, Avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, organisation du Prix Roman jeunesse, puis du Prix Premier Roman pour les trois dernières années
Après une exposition des livres scientifiques et techniques à Toulouse, lors d’Assises de la Culture scientifique et techniques, le CRILJ fait partie du Collectif d’associations pour la culture scientifique, le CIRASTI, avec outre les réunions une participation régulière aux Exposciences départementales, nationales (Brest, Grenoble, La Réunion) et internationales (Prague – Québec).
Opération avec les Pionniers de France sur la Culture scientifique et technique.
Toujours tourné vers la culture scientifique, le CRILJ a été l’un des membres fondateurs de l’Observatoire du Livre Scientifique, Technique et Industriel pour la Jeunesse, présidé par le professeur Albert Jacquard
En 1995, co-organisateur et gestionnaire de l’université d’été organisée par le Centre Internationale d’Etudes en Littérature pour la Jeunesse (CIELJ) à Charleville-Mézières, La littérature de jeunesse, les nouvelles technologies et la communication ?
Avec le CIEP (Sèvres) et pendant plusieurs années, participation aux séminaires annuels d’été des professeurs de français, langue étrangère, à Caen. Des lycées français à l’étranger
Collaboration avec la Fondation Nationale de la Gérontologie pour la création du Prix Chronos, sur le thème « Grandir, c’est vieillir ».
2001 – Pour le Ministère de la Défense : des recherches bibliographiques sur les albums, les romans, les documentaires traitant des conflits du XXème siècle.
2003 – Implication dans le programme national d’initiation à la lecture et à l’écriture dans le cadre de prévention et de lutte contre l’illettrisme mis en place par le Ministère de l’Education Nationale
( les partenariats ont été repris par date au début de la coopération, un certain nombre se poursuivent )
Depuis 2000, grâce à l’implication personnelle et l’action internationale de Monique Hennequin, participation active dans deux projets Comenius.
BARFIE (Books ans reading for Intercultural Education) projet soutenu par les institutions européennes qui travaillent dans le domaine de la littérature de jeunesse et de l’éducation. L’objectif était de promouvoir une éducation interculturelle à travers la littérature de jeunesse d’un certain nombre de pays en touchant un maximum de professeurs et d’élèves mais aussi d’animateurs, de procurer une plateforme créatrice pour échanger des informations, des expériences sur les meilleures pratiques en terme d’utilisation novatrice de la littérature au sein d’une éducation interculturelle et de renforcer la dimension européenne dans le processus d’éducation. C’est ainsi qu’a été constituée une collection de livres européens destinée à circuler.
Cette recherche a fait l’objet de l’édition d’un catalogue dans les langues de chaque pays partenaire (10 partenaires) présentant chaque livre avec son résumé
EDM Reporter (Electronic Digital Media Reporter), projet également soutenu par les institutions européennes qui travaillent dans le domaine de la littérature de jeunesse et de l’éducation. L’objectif était de mettre en place des outils pour les enseignants, bibliothécaires, animateurs et jeunes pour utiliser le WEB dans toutes activités liées à la lecture, à la littérature de jeunesse dans toute son interculturalité et sa multiculturalité.
LE CRILJ, C’ETAIT AUSSI UN CENTRE DE RESSOURCES
Pendant 35 ans, grâce à son secrétariat permanent, dans son centre national et parisien, le CRILJ engrangera toute information quelle qu’elle soit sur la littérature et la presse de jeunesse, assurera au quotidien toute recherche de documentation, diffusera l’information aidant à une meilleure connaissance de ce domaine.
Il a été un lieu d’accueil et de travail fréquenté par les documentalistes de collège, les enseignants, les bibliothécaires, les libraires, les animateurs mais aussi les professeurs et étudiants français et étrangers en diverses disciplines s’engageant dans des mémoires ou des thèses liés à l’enfance, la jeunesse, l’édition, la littérature de jeunesse.
( texte paru dans le n° 93-94 – septembre 2008 – du bulletin du CRILJ )
Quittant les éditions Stock quand Hachette rachète la maison, Monique Hennequin entre à l’Association nationale pour le livre français à l’étranger (Ministère des Affaires étrangères) où elle est l’adjointe de Lise Lebel. Elle publie chez Seghers en 1969 un Dictionnaire des écrivains pour la jeunesse de langue francaise, non signé, pour la section francaise de l’Union internationale des livres pour la jeunesse (IBBY). Travaillant ensuite à mi-temps au Comité permanent du livre français à l’étranger (Ministère de la Culture), elle assure à compter de 1980 le secrétariat général du CRILJ. Déclarant volontiers ne pas être une militante, Monique Hennequin fut, pendant trente années, l’indispensable cheville ouvrière de l’association.