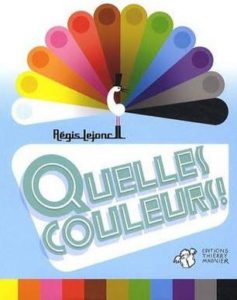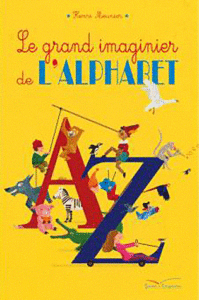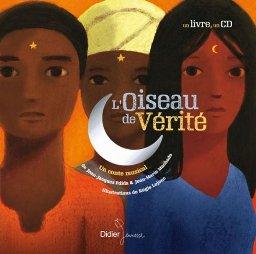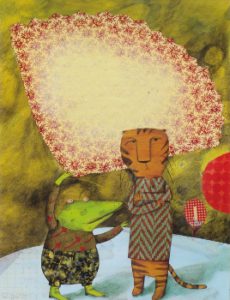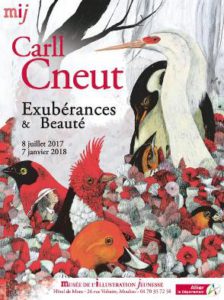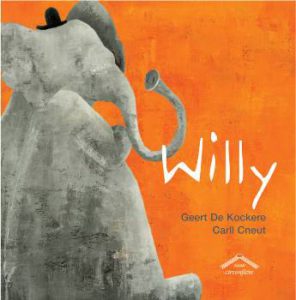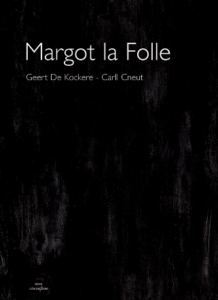Ce dialogue entre Carll Cneut et Emmanuelle Martinat-Dupré, responsable scientifique du Musée de l’illustration jeunesse de Moulins (mij) et commissaire de l’exposition Carll Cneut, exubérances et beauté, s’est déroulé le samedi 30 septembre 2017, lors des journées professionnelles de la quatrième Biennale des illustrateurs de Moulins.
propos retranscrits par Béatrice Chaubard
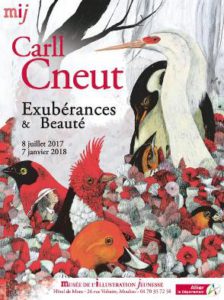
. Emmanuelle Martinat-Dupré – Bonjour Carll. Tu es déjà venu à Moulins, cet été, à l’occasion de l’inauguration de ton exposition, tu nous fais la joie de revenir pour la Biennale. Merci ! Tu n’as toujours pas eu le temps de visiter les richesses de Moulins et, notamment, à la cathédrale, le magnifique triptyque du maître de Moulins qu’on attribue à Jean Hay, d’origine flamande. Moulins avait donc déjà le maître de Moulins et, avec nous aujourd’hui, nous avons l’honneur d’avoir le maître de Gand… Lucie Cauwe, qui a gentiment accepté d’écrire un texte pour le catalogue de l’exposition, dit qu’ « avant toi, on n’a jamais connu d’artistes proposant de telles images aux enfants, à savoir des images baroques, rigoureuses, sensuelles et mystérieuses. » De manière plus légère pour démarrer cet entretien, tu dis dans une interview qu’Alex le personnage de l’album Monstre ne me mange pas ! c’est un peu toi. Tu peux nous en dire plus ?
Carll Cneut : Oui, effectivement, c’est un peu ça parce que je mange beaucoup. Et ma plus grande angoisse dans la vie, c’est de me retrouver sans rien à manger ! Quand je voyage, dans ma valise, il y a toujours quelque chose à manger au cas où, à mon arrivée, tous les restaurants et magasins seraient fermés.
. Tu es né et tu as grandi à la frontière entre la France et la Belgique. Tu as fait tes études de graphisme à l’Institut des Beaux Arts de Saint-Luc. Quand tu étais petit, il paraît que tu te voyais pâtissier, fleuriste ou artiste de cirque ?
Pâtissier surtout ! Je suis un fils de fermier. Mes parents souhaitaient que je fasse des études de droit pour devenir avocat. D’ailleurs je devais étudier le latin-grec pour être préparé à ces études. Tous les deux ans, pendant la scolarité, on nous faisait passer des tests pour préparer notre avenir et, de cette batterie de tests, se dégageait toujours pour moi le métier de fleuriste. Je suppose que c’était le seul métier un peu artistique qui était inscrit dans ce logiciel préhistorique et je me souviens que ma mère était furieuse de ces résultats. Pour moi, cela a toujours été clair que je voulais m’orienter vers quelque chose de créatif mais, comme je suis le fils d’un agriculteur, c’était très loin de mes origines et donc difficile à envisager pour moi et mes parents.
. Ceci dit, ce métier de fleuriste nous renvoie à certains de tes ouvrages où les fleurs sont très présentes. Mais l’amour de l’histoire de l’art, c’est venu d’où ? Il semblerait que les pâtes y soient pour quelque chose !
Dans le village où je vivais, à 15 kms de la frontière française, il ne se passait pas grand-chose. C’était un coin perdu. De plus, j’ai perdu mon père à l’âge de 7 ans. Par contre, j’avais une tante qui vivait à Bruges. Comme elle n’avait pas d’enfants, elle venait le week-end aider ma mère. Un jour, elle est arrivée avec des spaghettis que nous ne connaissions pas chez nous. Sur la boîte, il y avait des points à collectionner qu’on devait coller sur une feuille et, une fois atteint le nombre de 40 points, on recevait un cahier avec 4 reproductions d’œuvres d’art. Je me souviens encore de ce premier cahier qui m’a ouvert les yeux sur la peinture car, jusque-là, la peinture pour moi ça se cantonnait à des fruits ou des fleurs, parfois des paysages et là je découvrais qu’on pouvait peindre des têtes de morts, des squelettes… C’est un moment qui a déterminé ma vie.
. Tu parlais de la disparition de ton papa. Dans le film que l’on peut visionner sur le lieu de l’exposition, tu en parles aussi et on remarque aussi l’influence de Mickey Mouse. J’aimerais que tu nous dises en quoi cet évènement majeur de ta vie d’enfant et ce personnage de dessin animé ont contribué à l’artiste que tu es aujourd’hui.
Quand j’étais petit, il y avait un rituel au moment du coucher. Une fois couché, je me relevais, je dessinais un Mickey Mouse avec mon père sur la table de la cuisine et j’allais me recoucher. Comme mon père est mort à l’âge de 36 ans et que je n’avais alors que 7 ans, il me reste peu de souvenirs de lui mais ce moment restera pour toujours gravé dans ma mémoire.
. Tu étais destiné à une profession sérieuse, en fait tu fais des études de graphisme à l’Institut Saint-Luc et tu deviens chef de produit dans une agence de publicité. Tu arrives à l’illustration par hasard.
Oui, en effet. Après mes études à Gand, j’ai fait l’armée puis j’ai travaillé pour de grandes agences car je voulais être un « homme avec un costume cravate ». J’ai même travaillé pour une marque de produits surgelés en Russie. A Gand, ma voisine travaillait pour une revue féministe. Un soir, elle est venue sonner à ma porte et elle m’a sollicité dans l’urgence pour remplacer un illustrateur car la revue devait être tirée le lendemain, je crois. J’étais hésitant mais je l’ai fait pour lui faire plaisir. Elle a été contente du résultat et m’a sollicité ainsi trois fois. La dernière fois, j’ai reçu un coup de fil du directeur de ce magazine qui me donnait rendez-vous pour me parler. Je suis parti à Anvers et je pensais qu’il allait me remercier et me féliciter pour mes dessins. Mais, quand je suis arrivé là-bas, dans une grande salle où il n’y avait que des femmes, le seul homme, lui, s’est mis à m’engueuler en me disant que mes dessins étaient moches et je n’étais pas gentil avec les femmes. Le lendemain, en écoutant la radio, j’ai appris que cet homme était décédé le jour même d’une crise cardiaque. Je me sentais un peu coupable mais, en discutant avec mon médecin, il m’a dit que souvent les gens qui vont faire une crise cardiaque peuvent se montrer agressifs. Donc ce n’est pas ma faute !
J’ai continué à travailler pour des agences et pour Canal Plus et un jour en travaillant sur une campagne pour Canal avec la responsable, une des illustrations que j’avais faites pour cette revue est tombée de mon portfolio. La dame s’en est saisie, m’a demandé des précisions et m’a tout de suite dit que son frère travaillait dans une maison d’édition pour la jeunesse et que je devrais lui proposer une illustration. Cette idée ne me plaisait pas du tout mais, le soir même, ce monsieur par fax m’envoyait un poème à illustrer à destination des enfants. Je me suis mis à dessiner des enfants avec de grands yeux et de grandes oreilles et je l’ai envoyée à l’éditeur qui l’a retenu pour la 4ème de couverture. Le lendemain de la parution, j’ai reçu un coup de fil de l’auteur du texte me disant qu’il trouvait le dessin très moche. Un peu plus tard, je reçois de nouveau un poème de cet auteur, je fais le dessin, je l’envoie et je reçois de nouveau un appel de l’auteur me disant que c’était encore pire ! Le scénario se reproduit et là je décide de faire deux dessins, un pour les enfants et un qui représentait ce que moi j’avais envie de dire à propos du texte. En me disant que, suivant le choix qui serait fait, soit je continuais soit j’arrêtais de travailler pour cette maison d’édition. Heureusement c’est le dessin qui « était vraiment le mien » qui a été retenu. Le lendemain, je recevais un mot de l’auteur me disant non seulement qu’il trouvait le dessin magnifique mais aussi qu’il souhaitait que nous fassions un livre ensemble.
. Le premier livre qui te met le pied à l’étrier de l’édition jeunesse c’est Sacrée Zoé !
Non, c’est plutôt Willy. En faisant ce livre avec Geert de Kockere avec lequel j’avais déjà travaillé, je me suis rendu compte que tous les morceaux s’agençaient très bien, que je prenais du plaisir à ce travail d’illustration.

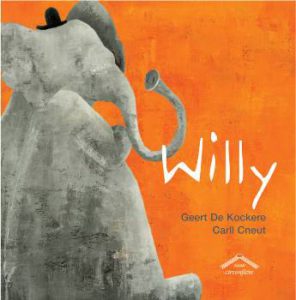
. Je voudrais que tu nous parles maintenant de l’évolution de ton travail. Quel parcours quand on voit le chemin parcouru entre la couverture de Sacrée Zoé ! et le foisonnement de couleurs de tes derniers albums ! On va donc parler de tes influences. Il y en a que tu revendiques comme les primitifs flamands. Avec Margot la folle, que tu as fait avec Geert de Kockoere, il y a une vraie citation à Brueghel, à un de ces tableaux très énigmatiques dont les interprétations dans le temps sont restées très diverses. Comment, quand on est illustrateur, mais aussi auteur d’ailleurs, peut-on s’attaquer à un tableau aussi étrange ?
C’est un tableau très connu en Flandre. A l’école, on étudie beaucoup les œuvres de Brueghel et notamment celle-là. Donc je la connaissais bien sans avoir, par ailleurs, une interprétation parce qu’elle fait partie du patrimoine flamand. Un jour, j’étais en dédicaces avec mon ami Geert et on plaisantait sur l’influence qu’on me prêtait à Chagall alors que je ne la reconnais pas. Alors on s’est dit, il faudrait peut-être faire un livre qui fasse écho à mes influences, celles que je revendique, à savoir les peintres flamands. Geert a choisi ce tableau Margot la folle. Pour moi, la difficulté a été à la fois de garder la distance par rapport à ce tableau qui fait vraiment partie de mon patrimoine personnel mais de ne pas m’en éloigner trop non plus pour que le lecteur reconnaisse la citation.

. Dans cette œuvre, vous vous attaquez à une œuvre d’art, à une dimension politique. Mais il y a aussi ce parti-pris éditorial qui propose une couverture noire. C’est décidé par qui ?
Par moi ! Mais cela n’a pas été facile car certains éditeurs allemands et italiens notamment, n’étaient pas d’accord. Ils trouvaient ce livre destructif et, en Italie, on m’a même reproché de faire un livre qui parle de religion. A moment donné, je m’attendais même à un coup de fil du pape !
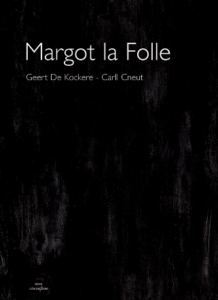
. On va parler quand même de tes éditeurs et de tes relations avec eux. Jusqu’où t’autorises-tu à aller pour faire accepter tes exigences ?
Avec mon éditeur flamand, je fais ce que je veux. J’ai démarré avec cette maison d’édition quand elle était encore toute petite. Personne n’avait trop le temps de nous guider donc j’ai avancé tout seul et maintenant je dispose d’une grande liberté chez eux. J’ai un contrat avec mon éditrice qui n’habite pas très loin de chez moi. Elle sait qu’il y a toujours un moment de panique pendant l’élaboration d’un livre et, dans ce cas, elle vient chez moi pour me rassurer et son passage me permet de continuer. On se connaît depuis plus de vingt ans, on est devenus amis et elle a un profond respect de mon travail.
. On va continuer sur les influences. Mais aussi sur tes techniques d’illustration et tes couleurs. On dit de toi qu’il y a un « rouge Carll Cneut ». Par rapport aux peintres flamands, on s’aperçoit qu’ils ont une façon très particulière d’utiliser la peinture à l’huile avec des couches successives. Toi, tu vas jusqu’à combien de couches successives d’acrylique ?
Oui, de temps en temps j’aime bien montrer vraiment ces influences flamandes. Pour ce qui est des successions de couches, cela dépend de la couleur finale que je veux obtenir. Pour le blanc, ça peut aller jusqu’à quatre couches, le jaune ça peut être huit à neuf couches. Le jaune, c’est la couleur que je retravaille le plus.
. Et puis tu as des petits secrets de fabrication comme l’adjonction de café et d’huile d’olive…
Parfois, je fais un peu n’importe quoi pour voir où cela m’amène. Par exemple pour un travail sur l’ombre et la lumière, je suis parti du foncé vers le clair par couches successives. Mais, comme j’ai toujours envie de me renouveler, parfois je vais dans ma cuisine et je cherche quelque chose à mélanger pour faire des expériences. Par exemple quand on ajoute de l’huile d’olive à de l’acrylique, les deux se repoussent. Quand cela a séché le lendemain, on obtient une brillance intéressante notamment dans le drapé des tissus, créée par l’huile qui est remontée à la surface.
En fait, pour revenir un peu en arrière, comme je ne me destinais pas au départ à l’illustration et que je n’avais pas écouté avec attention les cours sur la couleur pendant ma formation, j’ai dû beaucoup expérimenter. Je ne connaissais pas bien la matière, j’avais l’impression de ne pas trop savoir dessiner. Cela m’a amené au départ vers un style très graphique dans mes premiers albums. Mais, au fil du temps, comme je dessine et je peins tous les jours, j’ai appris à travailler la matière et à mieux dessiner, même si je ne me considère pas encore comme un grand dessinateur. Mais j’ai fini par trouver ma propre technique d’illustration qui me permet aujourd’hui de dessiner à peu près tout ce que je veux.
. Pour effectivement parler de ton style d’illustration, on remarque que tes personnages sont toujours de profil …
Cette histoire de profil, c’est venu effectivement de mes limites au départ mais aujourd’hui, de temps en temps, j’inscris un personnage de face pour montrer que je suis capable ! En Flandre, il y a eu pas mal d’articles sur le sujet. Certains ont été surpris par cela car c’était nouveau, d’autres, au contraire, pensaient que ces personnages de profil permettaient davantage aux lecteurs de se projeter dans l’histoire. Au cours des ateliers menés avec les enfants, aucun ne m’a jamais posé la question sur ce sujet. Il me semble que le profil permet davantage au lecteur de faire un effort pour s’identifier et comprendre le personnage.
. Toi, tu aimes donc laisser sa place au lecteur …
Oui, cela me paraît très important. Par exemple, dans Willy, sur la première page, on voit juste quelques éléments dans l’illustration qui ne permettent pas de savoir qu’il s’agit d’un éléphant. Et le texte sur la page d’en face est minimaliste. Cela permet à chaque enfant d’interpréter l’image, de commencer à faire fonctionner l’imaginaire.
. Que pourrais-tu nous dire sur la réitération d’un motif d’un album à l’autre ? Est-ce volontaire, prémédité ?
Oui, je pense notamment à la réédition de La fée sorcière, que j’ai voulue à l’occasion de mes vingt ans d’illustration. Il me semblait intéressant d’insérer des motifs d’autres albums pour faire un peu lien entre mes livres et justement marquer ces vingt ans d’illustration.
. On n’a pas encore parlé de tes cadrages et de la façon dont tes personnages paraissent en lévitation ou bien de passage. Ils apparaissent et disparaissent. Tu as en fait des cadrages très particuliers et parfois des rapports d’échelle. Est-ce que ce sont des choses calculées ?
Non. Je travaille assez intuitivement. Mais en même temps je passe aussi beaucoup de temps à faire des croquis, à construire des maquettes. Au début, mon travail était plus cérébral, mais maintenant, c’est beaucoup plus intuitif. Une forme de maturation sans doute.
. Revenons à La Fée sorcière. Il y a beaucoup de rose dans cette seconde édition de l’album. Est-ce que tu voulais poser la question du genre dans cet album ? Pour ceux qui ne connaissent pas l’album, il s’agit de l’histoire d’une petite fée qui n’a justement pas envie de respecter les codes qu’on lui impose et voudrait aller expérimenter autre chose, d’autres activités, d’autres mondes. Est-ce que cette question du genre a été présente dans tes choix d’illustrateur ?
Non, pas du tout, je trouve que cette question devient très lourde aujourd’hui.

. En France, dans le monde de la littérature de jeunesse, cette question est très présente. Il y a même une maison d’édition qui s’est spécialisée sur ces questions pour faire réfléchir les enfants aux stéréotypes et leur permettre de mieux s’en éloigner. Mais je vois que cette question n’est pas centrale pour toi ! Donc, revenons à La fée Sorcière. Pourrais-tu nous dire comment tu t’y es pris pour cette seconde édition car c’est plutôt rare de refaire différemment le même livre, la même histoire ? Sacré défi !
La vérité, je crois, c’est que je voulais montrer que je dessinais un peu mieux. Cet album a été très important dans ma carrière qui m’a ouvert la porte vers d’autres pays, des traductions. Je voulais comme je vous le disais marquer ces vingt ans d’illustration et ce livre était un peu une synthèse de mon travail d’illustration pendant toutes ces années.
. Effectivement, comme tu le dis, c’est la première version de ce livre qui t’a fait connaître dans les pays francophones mais aussi ailleurs. Il y en a un autre aujourd’hui, c’est La volière dorée. C’est une véritable aventure textuelle et visuelle. Tu dis que parfois des auteurs t’envoient un texte et que cela ne te met pas toujours très à l’aise car tu sens une attente très forte.
Oui, je crains beaucoup quand des auteurs m’envoient un texte en précisant « Je l’ai écrit pour toi ». Cela a pour conséquence de créer un stress. Mais dans le cas de La volière dorée, ce n’est pas du tout cela. Je suis tout de suite tombé amoureux de cette histoire.
. Dans cet ouvrage, il me paraît important de parler aussi de la mise en page et de la typographie mais aussi de ton écriture que l’on découvre et qu’on a voulu mettre en avant dans l’exposition. C’est ton choix ?
Oui.. mais, par contre au départ, je ne m’étais pas rendue compte que je devrais l’écrire dans des langues différentes. La version polonaise, par exemple, m’a pris des jours et des jours.
. C’est un livre qui est bien reçu à l’étranger ?
Oui, mais il est encore peu traduit. Et puis, dans certains pays, certains éditeurs voudraient transformer le texte. Mais les enfants l’aiment beaucoup et c’est là l’essentiel.
. Ce livre revêt pour nous une grande importance car c’est de ce livre qu’est partie l’idée de cette exposition. Mais je sais que tu réalises de plus en plus d’expositions. Et tu joues particulièrement le jeu puisque tu encadres tes œuvres. Pourquoi les encadres-tu car cela leur donne un statut particulier. Tu vas chercher dans des brocantes des cadres dorées, noirs, en fonction de tes tableaux, de tes illustrations
L’idée est venue de l’exposition à Gand car je voulais donner plus d’ampleur. Du coup, on a cherché des cadres qui mettraient le mieux en valeur les illustrations. Et une fois encadré, l’original a une autre force.
. Quelques mots sur l’oiseau bleu dans Le secret du chant du rossignol, avant de terminer cet entretien ?
C’est bizarre parce que, dans ce livre, on ne voit qu’une fois un oiseau et pourtant on me considère comme un spécialiste des oiseaux. On m’invite dans des conférences d’ornithologues et on m’a même demandé de travailler pour une marque de soutien-gorge ce que j’ai refusé !
. Tu prends beaucoup de photos pour témoigner de la vie d’un illustrateur, pour démontrer aussi que les illustrateurs ne sont pas des paresseux qui se contentent de dessiner à leur table quand ça leur chante mais bien plus que ça. C’est en fait un témoignage sur la vie d’un artiste.
Pendant deux ans, j’ai pris tous les jours une photo montrant où j’étais, ce que je faisais. Souvent dans les représentations des gens il y a cette idée qu’un illustrateur se lève à 10 heures, puis reste deux heures en peignoir… Ces photos révèlent que l’on voyage beaucoup, qu’on se lève tôt…
. Ce matin, tu nous as tenus des propos très émouvants sur ta rencontre avec Anthony Browne…
C’est un moment très important dans ma carrière. Je l’ai rencontré hier mais je l’avais déjà rencontré il y a une quinzaine d’années, à Londres, où je travaillais sur un livre. Arrive à moment donné, dans les bureaux de la maison d’édition, cette grande star de la littérature. Et j’ai trouvé ce grand monsieur si gentil, si sympathique que cela a un peu changé ma vie et j’ai décidé à partir de ce jour d’être toujours gentil avec les gens !
. Toi aussi, Carll, tu sais être très gentil et sympathique et tu nous l’as bien montré ce matin. Tu as à ton actif une quantité conséquente d’albums et d’illustrations de romans, dont plusieurs ont été récompensés. Et nous allons faire un vœu, tu es candidat, je crois, au Prix Andersen ou au prix Astrid Lindgren. Nous te souhaitons de tout cœur que ce vœu soit exhaussé et que tu obtiennes ce prix un jour prochain car tu es vraiment un artiste hors pair.
Moi aussi, je le souhaite pour le Prix, bien sûr, mais aussi pour le chèque qui va avec …
(transcription : février-mars 2018)
Bibliographie sélective ici.

Adhérente du CRILJ depuis deux ans, Béatrice Chaubard est bibliothécaire, travaillant actuellement à la Médiathèque de Chailloux (Haute Garonne). Elle s’est beaucoup investi dans les activités de la section Midi-Pyrénées de l’association, recevant notamment Anne Brouillard en 2015. Apportant sa collaboration, en décembre 2016, à la formation à propos du théâtre contemporain pour la jeunesse, elle a, par la suite, dans le droit fil de l’éducation populaire, accompagné des habitants de sa commune au théâtre, à Toulouse. Béatrice Chaubard est l’une des cinq boursières ayant bénéficié d’un « coup de pouce » du CRILJ à l’occasion de la quatrième Biennale des illustrateurs de Moulins.
.
Photo du bas : André Delobel
 Nikolaus Heidelbach nous confie qu’il a toujours été un très grand lecteur, entouré d’une grande bibliothèque bien fournie et que, parfois s’opère en lui un déclic que lui-même ne s’explique pas, et qui le pousse à dessiner, souvent du matin au soir. Auteur d’une version des Contes des frères Grimm, il s’amuse à dessiner le moindre détail du texte, y compris une virgule. Par exemple, dans un conte, le roi décide de comprendre pourquoi les gens disparaissent autour d’un lac, et quand il s’y rend, au moment où son chien renifle près de ce lac, une main sort de l’eau, et le chien disparaît. Avant sa disparition, une virgule apparaît…
Nikolaus Heidelbach nous confie qu’il a toujours été un très grand lecteur, entouré d’une grande bibliothèque bien fournie et que, parfois s’opère en lui un déclic que lui-même ne s’explique pas, et qui le pousse à dessiner, souvent du matin au soir. Auteur d’une version des Contes des frères Grimm, il s’amuse à dessiner le moindre détail du texte, y compris une virgule. Par exemple, dans un conte, le roi décide de comprendre pourquoi les gens disparaissent autour d’un lac, et quand il s’y rend, au moment où son chien renifle près de ce lac, une main sort de l’eau, et le chien disparaît. Avant sa disparition, une virgule apparaît… Aussi, avec L’enfant-phoque, plongé dans cet univers de créatures marines inspiré des légendes de selkies*, il a souhaité mettre en avant sa fascination pour l’art de conter et traiter du sujet de la mort du personnage de la mère dans le regard – dont on ne voit presque jamais les yeux – du jeune garçon, sans drame.
Aussi, avec L’enfant-phoque, plongé dans cet univers de créatures marines inspiré des légendes de selkies*, il a souhaité mettre en avant sa fascination pour l’art de conter et traiter du sujet de la mort du personnage de la mère dans le regard – dont on ne voit presque jamais les yeux – du jeune garçon, sans drame. Située sous les ors du salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, elle vient confirmer à nos yeux la réelle finesse de son univers à travers les originaux de ses albums : Les contes d’Andersen, l’intégralité des planches de Que font les petites filles aujourd’hui ? et de Que font les petits garçons aujourd’hui ?. Gouaches, encres et crayons nous montrent ainsi autant d’images d’un univers surréaliste et dérangeant d’un auteur et illustrateur qui semble « avoir rejoint le complot des enfants contre la vie ennuyeuse des adultes ».
Située sous les ors du salon d’honneur de l’Hôtel de Ville, elle vient confirmer à nos yeux la réelle finesse de son univers à travers les originaux de ses albums : Les contes d’Andersen, l’intégralité des planches de Que font les petites filles aujourd’hui ? et de Que font les petits garçons aujourd’hui ?. Gouaches, encres et crayons nous montrent ainsi autant d’images d’un univers surréaliste et dérangeant d’un auteur et illustrateur qui semble « avoir rejoint le complot des enfants contre la vie ennuyeuse des adultes ».