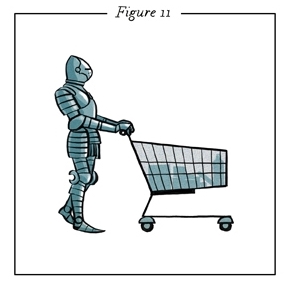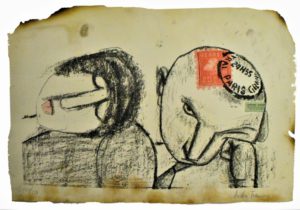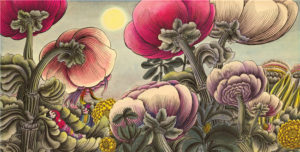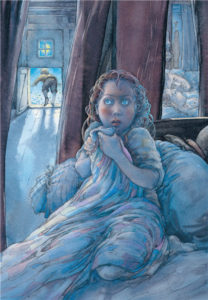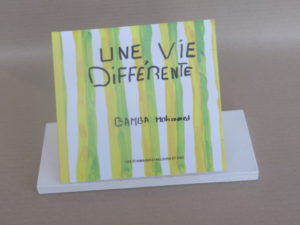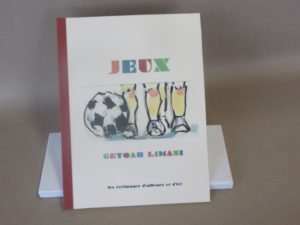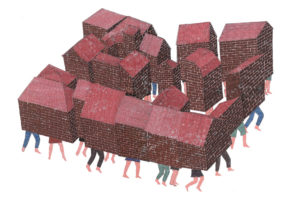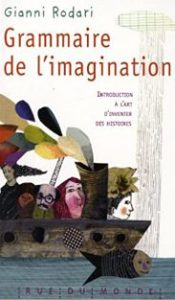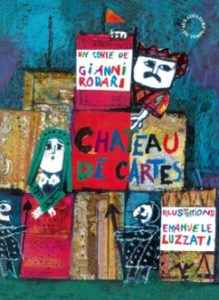.
Les États généraux de la littérature de jeunesse du lundi 5 octobre 2020 étaient organisée par La Charte des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse, à la Bibliothèque publique d’information (BPI) du Centre Pompidou.
.
Et elles ne vécurent plus lésées jusqu’à la fin des temps…
.
Cette journée avait été précédée par la mise à disposition, en ligne, de vidéos présentant des témoignages d’autrices et d’illustratrices réalisées pour alerter sur les différences femmes/hommes dans leur métier. Ces interviews donnaient la parole à cinq autrices (Sophie Adriansen, Clémentine Beauvais, Moka, Laura Nsafou et Cécile Roumiguière) et à trois autrices-illustratrices (Loren Capelli, Malika Doray et Marie Spénale).
Ce sont Lucie Kosmala et Léa Bordier qui, en coordination avec la Charte, ont produit ces cinq vidéos. Cinq thèmes y sont traités : les débuts, les difficultés, les enfants, la sensibilité féminine. l »engagement et l’avenir. Il sera, au cours de la journée, fréquemment fait référence aux propos tenus dans ces vidéos.
Dans l’amphithéâtre de la BPI où sont accueillis les participants, on respecte les obligations sanitaires de distanciation : un siège sur deux occupé, des participants masqués ainsi que tous les intervenants, jusqu’à leur montée sur l’estrade au moment de leur intervention.

 . Hélène Vignal et Jo Witek
. Hélène Vignal et Jo Witek
Hélène Vignal, co-présidente de la Charte, ouvre les travaux de la journée. Elle rappelle que l’Observatoire de l’égalité du ministère de la Culture alerte sur des différences de revenus notoires entre les auteurs et les autrices : moins 26% pour les autrices affiliées à l’AGESSA et moins 22% pour celles relevant de la maison des artistes. Au-delà de ce constat, cette inégalité se retrouve dans de nombreux domaines touchant à la vie professionnelle et parfois aussi personnelle des autrices, il est donc nécessaire pour améliorer l’inégalité entre femmes et hommes d’identifier les situations où elle se manifeste et d’analyser les freins à une amélioration.
Jo Witek, grand témoin, prononce le discours d’ouverture. Elle revendique une position féministe et inscrit délibérément ses propos sous l’égide des travaux de Michelle Perrot. Elle replace la réflexion de cette journée dans la longue et lente progression des femmes sur le chemin de l’égalité. En 1789? les femmes n’étaient présentes que par le détournement et la séduction. Même les défricheuses étaient empêchées ». Elle cite, exemples à l’appui choisis dans leur vie de femmes de lettres, Wirginia Woolf, Simone de Beauvoir, Elsa Triolet. Elle s’interroge aussi sur la manière de faire émerger l’implicite d’une culture mâle, patriarcale pour aboutir à une société du partage et de l’égalité.
Plusieurs intervenantes n’ont pas pu se déplacer pour des raisons liées à l’épidémie et elles ont enregistré leur intervention, diffusée en séquence(s) vidéo, des incrustations permettant de bénéficier à la fois de l’exposé de la conférencière et du diaporama qu’elle utilise en appui.
 . Doriane Montmasson
. Doriane Montmasson
Ce sera le cas de Doriane Montmasson, maitresse de conférences en sociologie de l’éducation, à l’INPE de l’académie de Paris. Elle interroge le rôle joué par les stéréotypes de genre véhiculés par les récits et les représentations de la littérature de jeunesse. Cette dernière tendrait-elle à entretenir une vision genrée de la place des hommes et des femmes dans la société ? Elle a mené une étude sur la réception des stéréotypes par les enfants et propose des premières réponses.
Elle se réfère aux recherches des années 1990 qui ont mis en lumière l’existence de stéréotypes de sexe dans les livres destinés aux enfants et qui ont supposé que ces « modèles » étaient déterminants pour leur construction identitaire. Elle note que si le nombre des ouvrages présentant une vision stéréotypique du masculin et du féminin restent important, ils sont de plus en plus nombreux à proposer une vision moins ou peu explicite des normes de genre. Elle insiste sur la nécessité de compléter l’étude du contenu des albums par une étude de réception, pour analyser comment les jeunes lecteurs et lectrices s’approprient les » modèles » proposés par la littérature.
Une des recherches de Doriane Montmasson a porté sur un ensemble de 150 livres, des années 1950 à 2012 (pas d’information fournie sur le corpus, les quelques exemples de pages présentées ne faisant pas référence à des œuvres de littérature identifiables) proposé à une centaine d’enfants (G/F) de 5 à 8 ans. La recherche a mis en évidence :
– que la socialisation familiale tient une place prépondérante, pour les plus jeunes, en matière de genre. Ils ne relèvent pas l’existence d’organisations familiales dissemblables, ils sont même portés à modifier le sens de certains ouvrages afin qu’ils correspondent à leur propre représentation du masculin et du féminin. On peut dire qu’ « à cet âge, les livres ne sont pas responsables de tout et n’ont pas à eux seuls le pouvoir de tout changer. »
– que la réception d’ouvrages par des enfants plus âgés montre que la littérature tend à prendre une place plus importante dans la construction identitaire des filles et des garçons.
Doriane Montmasson estime important de réaffirmer :
– qu’il est primordial qu’une offre de livres proposant des normes de genre moins stéréotypées continue de se développer ;
– qu’il « est essentiel que l’utilisation de ces livres fasse l’objet d’un étayage permettant aux enfants de s’inscrire dans une posture réflexive. »
 . Anne-Sophie Métais
. Anne-Sophie Métais
Anne-Sophie Métais, chargée de mission auprès de la direction du Centre national du livre, présente un point d’étape d’une étude du CNL portant sur l’économie de la filière du livre de jeunesse. Elle centrera son intervention sur le volet consacré aux auteur-trice(s), cette étude en comportant deux autres consacrés aux éditeur-trice(s) et aux libraires.
Cette étude inclut une enquête conduite par le CNL à partir de la base Électre, soit 11 000 auteurs identifiés dont près de 75% sont des autrices (autrices pour le texte : 60% ; pour le texte et les illustrations : 65% ; traductrices : 68%). Elle porte sur cinq segments de l’édition : éveil et petite enfance, albums, documentaires, romans 8/12 ans, romans plus de 13 ans et jeunes adultes, la bande dessinée en ayant été exclue. Sur 1641 auteurs touchés, 435 ont renseigné le questionnaire.
L’enquête interroge, au-delà des revenus générés par les œuvres pour la jeunesse, ceux issus des publications réalisées à destination d’un public hors du secteur jeunesse et des activités connexes.
Concernant le pourcentage des aides accordées à des auteurs et à des autrices, la représentante du CNL indique que ce dernier reçoit les demandes et ne les suscite pas. Hélène Vignal insiste sur l’importance, même dans ces conditions, de garder en tête le principe d’égalité.


 . Table ronde
. Table ronde
Hélène Rajcak (autrice-illustratrice), Martin Page (auteur-éditeur) et Coline Pierré (autrice-éditrice), ensemble ou séparément, Roxane Edouard (agente littéraire), en visio-conférence depuis Londres, sont invités à témoigner de leurs expériences et à échanger à propos de leurs initiatives autour de la question : la considération des autrices est-elle la seule clé de l’égalité en littérature de jeunesse ? Modératrice : Hélène Vignal
Concernant la différence de rémunération entre les auteurs/autrices de littérature générale et de littérature de jeunesse, une des réponses fallacieuses apportée a été le coût de l’album par rapport au roman, alors que ce c’est en fait une dévalorisation de la littérature de jeunesse et de ses auteurs-trices.
Les participants à la table ronde tombent d’accord sur le fait qu’il entre une part d’affectivité dans les échanges auteurs/éditeurs. On accueille un auteur, une autrice, mais aussi une situation financière corollaire La faible place des agents et agentes littéraires en France tend à renforcer cet état de fait.
Des pastilles-vidéo donnent, à divers moments, la parole à Roxane Édouard, ce qui permet à travers de ses propos de préciser la représentation, assez floue, de ce que peut être le rôle d’un ou d’une agent-e littéraire dans la gestion financières et juridiques des intérêts des autrices et auteurs dont elle administre la carrière. La place des agents et agentes est plus affirmée dans les pays anglo-saxons, en Espagne et en Italie qu’en France.
Roxane Édouard ouvre aussi le champ des différences à prendre en compte à ceux des inégalités de race ou du handicap. Elle confirme que les négociations d’une agente ne portent pas que sur les rémunérations, d’autres composantes interviennent aussi : les enfants, les vacances…
Martin Page précise qu’il s’est interrogé sur sa participation à la table-ronde : un homme peut-il défendre les femmes à la place des femmes ? Il ajoute qu’il trouve le secteur de la littérature de jeunesse plus agréable, plus ouvert, plus attentif que le secteur de la littérature générale, sur divers registres : l’égalité F/H mais aussi par exemple le « livre durable » face au pilonnage. Avec Coline Pierré, ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour montrer le quotidien, comme ils le font aussi dans avec leur maison d’édition Monstrograph et avec des titres comme Les artistes ont-ils vraiment besoin de manger ?
Hélène Rajcak insiste sur le fait que les autrices sont aussi légitimes que les auteurs, mais qu’il faut du courage pour « négocier » un contrat lorsqu’on est une femme. Autrice-illustratrice de documentaires à composantes scientifiques, elle est aussi très attentive à la réception par les enfants, aux différences filles/garçons et à la médiation qui accompagne la lecture.
Une question de la salle porte sur le pourcentage d’éditrices dans la littérature pour la jeunesse et ce que cela peut modifier dans les relations, éditrices/autrices.
Hélène Vignal souhaite interroger un représentant du Syndicat national de l’édition (SNE) sur ce point, mais aucun n’est présent dans la salle. Martin Page estime que les éditrices travaillent mieux que les éditeurs, dans le secteur adulte comme en jeunesse.
Un témoignage dans la salle met en lumière la méconnaissance du public sur les différentes professions de la chaine du livre. Les participants de la table-ronde font remarquer que la littérature de jeunesse n’est pas ou peu représentée dans les médias généralistes.
De la salle, Samantha Bailly, co-présidente de La Charte, conclut qu’il est nécessaire de faire reconnaitre qu’être un auteur ou une autrice, c’est un métier.
. En guise de conclusion
Cette matinée a été très riche, abordant des sujets variés sur la question de l’égalité entre les auteurs et les autrices, avec conviction mais sans dogmatisme. Les intervenants ont fait preuve d’une grande ouverture d’esprit, de positions nuancées, de perspectives originales et courageuses. Vives regrets de devoir quitter les travaux en milieu de journée….
Un petit tour effectué, le soir, sur le compte Facebook de La Charte a permis de retenir un extrait du discours de clôture de Jo Witek, grand témoin, bien dans la tonalité de cette journée .
« La littérature jeunesse comme toute littérature doit aussi déranger, surprendre, garder sa liberté de ton, son insolence et donner à voir l’état du monde tel qu’il est. Parfois, un personnage de père machiste et alcoolique fera beaucoup plus réfléchir un ado, qu’un papa féministe et écolo. L’important n’est pas tant de coller aux nouveaux archétypes, aux nouvelles représentations, que d’écrire avec sincérité, là où on en est. Avoir cette honnêteté-intellectuelle là. Et en ce moment, à voir le nombre de romans qui mettent des filles à l’honneur, par rapport à la réalité de l’égalité filles-garçons dans nos sociétés, on peut s’interroger sur cette honnêteté. »
par Françoise Lagarde – octobre 2020
.
Françoise Lagarde, formatrice dans le premier degré, est devenue ingénieur d’études au ministère de l’Éducation nationale où elle fut chargée, jusqu’en 2013, des dossiers relatifs au livre et à la lecture en tant qu’adjointe au chef de bureau des écoles à la direction générale de l’enseignement scolaire ; elle a assuré la mise en œuvre de l’opération Des livres pour les écoles et des plans de développement des BCD, coordonné l’élaboration et la production du répertoire 1001 livres pour l’école (1997), contribué à la mise en place des sélections d’ouvrages de littérature pour les trois cycles de l’école primaire, collaboré au Guide de la coopération bibliothèque-école (CRDP de Créteil, 1986) et à la mise en ligne sur le site ministériel Éduscol de ressources pour faire la classe ; elle est l’actuelle présidente du CRILJ.
.
.
POUR ALLER PLUS LOIN
- Le programme et la présentation des intervenants :
https://drive.infomaniak.com/app/share/118494/41ac10d4-dc3c-4136-9bbf-baee7a2f3040/preview/pdf/54596
. les débuts : https://www.youtube.com/watch?v=YsXSNPFRSo8
. les difficultés : https://www.youtube.com/watch?v=-HSyeg-0B-I
. la sensibilité féminine : https://www.youtube.com/watch?v=-zk_yw1Z8w0
. les enfants : https://www.youtube.com/watch?v=z-WhMdi536A
. l’engagement et l’avenir : https://www.youtube.com/watch?v=Y-4luCd6sn8
- L’intégrale de la séance du matin :
https://www.youtube.com/watch?v=J5_quVogoOw
- L’intégrale de la séance de l’après-midi :
https://www.youtube.com/watch?v=i6DNzUL_3sg
.
.
.