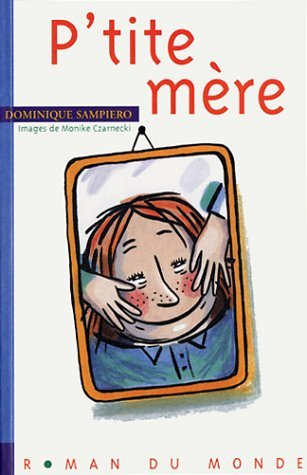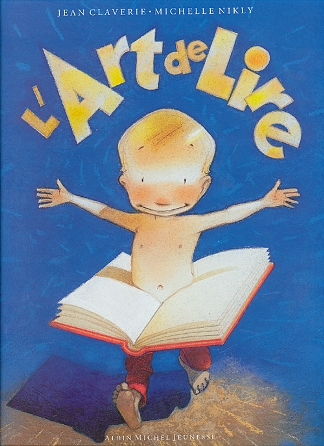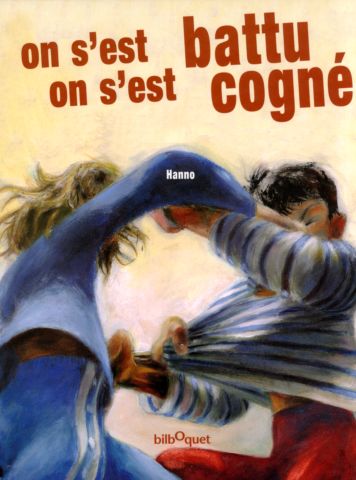Auteur : CRILJ
La précarité dans les livres pour enfants
Avec sa vie, le Gavroche des Misérables a aussi perdu son combat : au vingtième siècle, des enfants sont toujours dans la rue, à la merci de conditions de vie qualifiées de « précaires ». Préoccupant sur le plan socio-éducatif, le constat est aussi suffisamment récurrent dans les livres pour enfants pour que le Centre de Recherche et d’Information sur la Littérature pour la Jeunesse l’ait placé au cœur des débats de son dernier colloque, en octobre 2005 : Temps incertains : les jeunes, l’écrit et la précarité. Occasion de cerner l’actualisation du thème qui, bien qu’ayant évolué, reste actuel dans l’édition pour la jeunesse.
Précaire : dont l’avenir, la durée ne sont pas assurés. Incertain, instable, fragile. Conditions de vie précaires.
De cette définition du dictionnaire, il ressort que la précarité relève d’un statut socio-économique qui entraîne l’appauvrissement des individus, qui les met dans l’incapacité de mener une vie sociale normale. C’est un état subi plus qu’assumé, aux limites extrêmes de la société, dernier état avant la marginalité.
La marginalité est une précarité assumée, où l’individu s’est isolé peu à peu de toute vie sociale ; ses repères psychologiques ne sont plus suffisants pour l’inciter à la réintégrer.
En littérature de jeunesse, à travers les livres qui ont traité ce sujet récemment, il est sans doute plus juste de parler de personnes en situation de grande précarité qu’elle soit transitoire, donc dans la signification stricte du terme, ou plus chronique. Dans ce deuxième cas, la précaution linguistique vise à substituer le terme « précarité » au vieux mot de « pauvreté », qui induit des connotations plus paternalistes dans l’attitude adoptée par les autres vis-à-vis de ceux qui vivent dans ce statut.
La pauvreté est une situation de fait, décrite par le passé avec une condescendance générale qui vient soutenir un propos moralisateur. Elle a longtemps trouvé une fonction « éducative » en littérature de jeunesse, à l’instar de Rémi, le héros d’Hector Malot (Sans famille), récemment adapté en bande dessinée, ou de Dadou, gosse de Paris de Trilby, Titi parisien un peu vagabond et marginal repris en main par la société bien pensante : sa réinsertion sociale glorifie la générosité de ceux qui le « rééduquent ».
Sur un plan littéraire, la marginalité est beaucoup moins « pédagogique ». Elle n’est pas supportable en tant que telle en littérature de jeunesse et trouve le plus souvent une solution miracle pour amener le héros enfant à sortir de sa précarité, ou tout du moins à s’inscrire dans le périmètre classique des « assistés ».
La société actuelle a pris conscience depuis longtemps que bien des gens vivent très proches du seuil de pauvreté tout près de chez nous,ou bien plus loin. Mais les développements médiatiques du phénomène ne permettent plus de le gommer en quelques traits qui relèveraient d’une sorte de magie romanesque, qui donnerait bonne conscience. La vérité, associée à une certaine neutralité de ton, se fait jour dans les derniers livres sortis sur le sujet. Romans et albums dressent des constats, servent de révélateurs, à peine déguisés en « histoires », d’un état de fait sur lequel les auteurs prennent position par le simple fait de la raconter.
La mondialisation incite aussi à intégrer la précarité planétaire. L’information ne permet plus d’ignorer les conditions de vie précaires aux quatre coins de la planète ; elle incite au contraire à les lier dans une sorte de communautarisme international de la précarité. Des livres venus d’autres continents ont des accents communs avec ceux qui sont écrits par des auteurs français.
Ce thème, malheureusement récurrent, touche ainsi aujourd’hui toutes les tranches d’âge, toutes les zones géographiques. Il a ses livres-phares : On est tous dans la gadoue de Maurice Sendak, La petite marchande d’allumettes par Tomi Ungerer (1974), Les petits bonhommes derrière le carreau d’Olivier Douzou. Les titres plus récemment parus sur le sujet ont un ton, une authenticité qui sensibilisent les lecteurs enfants et veut les inciter à regarder ces héros en état de précarité comme semblable à eux, Un garçon comme moi, comme le souligne le titre d’un livre brésilien.
Avant d’étudier les ressorts des intrigues qui lient ces personnages au cadre social qui les entoure, un bref regard sur le décor environnant donne les couleurs de cette vie difficile dont joie et solidarité ne sont pas pourtant pas absents, tout comme l’espoir.
Le décor de la rue
Camper le décor des ouvrages qui traitent de la précarité est relativement simple. Il a pourtant son importance, car il induit le type de précarité abordée dans le livre.
La plupart du temps, c’est la rue, des cartons entassés sous un pont (Miloko), une impasse ou une ruelle obscure, souvent encombrée de détritus (Le rat).
Les rues sont le plus souvent celles des pays occidentaux, de préférence la nuit et en hiver ; sous des lumières, blafardes ou au contraire parcimonieuses se dessine la fragilité des silhouettes qui cherchent à se couler dans l’anonymat de la ville. Ambiance proche des films noirs avec, en toile de fond, des immeubles qui écrasent les protagonistes.
Rues des grandes villes où la minuscule silhouette d’une petite fille se glisse entre les tables des restaurants pour vendre ses fleurs, banlieue à peine esquissée vers laquelle elle s’en va, à la fin de l’album, suivant un adulte au rôle ambigu (Eva au pays de fleurs).
Central Park, au cœur de New York, dernier ilôt de bien-être où quelques miséreux vivent une sorte de ‘‘robinsonnade’’,société en microcosme qui les préserve encore quelques temps de la marginalisation définitive (L’île aux singes).
Dans les villes de type occidental, errent les SDF, les laissés-pour-compte de l’économie, victimes de ces embardées de la vie qui font sortir du chemin habituel : chômage, divorce, situation qui a changé parce qu’un grain de sable est venu introduire la précarité dans une vie initialement stable, sans pour autant être toujours brillante. Dans ces lieux familiers, le schéma de la précarité est surtout celui de l’adulte en perdition : le choix de héros enfants en rendrait, par la proximité du cadre, la lecture trop évidente et angoissante à décoder.
Rues des contrées plus exotiques : Amérique latine, Afrique, moins souvent Asie. Sous le soleil ou les pluies diluviennes, c’est la nature qui écrase alors l’homme ou l’enfant pris au piège de la solitude et de la misère (Prince des rues, Maestro). Dans ces mégapoles à taille inhumaine, les vitrines des magasins sont souvent le lieu de confrontation entre richesse et pauvreté, raccourci saisissant entre l’abondance des biens de consommation venus d’Occident, inaccessibles à ceux qui trimballent leur misère dans ce décor anonyme. Les héros adolescents rêvent devant ces cavernes merveilleuses et intouchables (Un garçon comme moi), ou mènent de véritables commandos de gamins des rues révoltés pour les piller (Maestro).
Ce décor « exotique » est en effet le cadre de la précarité inhérente aux origines, héritage de pauvreté si profondément ancré dans le statut économique de la population qu’adultes et enfants y sont enracinés comme dans une seconde nature. Dans le décor immense de ces mégapoles lointaines, les jeunes – car dans ce type de décors, les héros sont plutôt adolescents parfois tout jeunes ; ils se coulent dans la foule, se dissimulent aux yeux des autres et des autorités, s’organisent, subsistent avec des moyens infimes, et tentent de garder la tête haute. (Princes des rues, Un garçon comme moi, Maestro)
Ce cadre urbain est plus imprécis et symbolique dans les livres d’images, où formes et décor – ruelles, angles de rue où sont assis les hommes en attente – sont plus souvent esquissés que vraiment peints avec précision. Les petits bonshommes derrière le carreau sont blottis dans une encoignure de mur entr’aperçue à travers la buée déposée sur la vitre, qui introduit le contraste entre la chaleur intérieure de la maison, tandis qu’au dehors, quelques pauvres se gèlent dans leur abri de carton. Dans Le petit marchand des rues, album brésilien, c’est un carrefour à peine esquissé, un embouteillage de voitures qui sert de cadre unique à une histoire en boucle résumant la précarité en quelques scènes de mendicité, d’agressivité, vues en plongées cinématographiques qui « écrasent » symboliquement l’enfant qui mendie en vendant trois fruits. Dans les albums de Piotr, le décor s’efface encore plus pour ne laisser à voir que les personnages, dialoguistes de scènes qui sont autant de thèses qui dénoncent la difficulté d’être.
La maison
La maison, à peine dessinée, est le rempart ultime contre la misère absolue.
Dans les albums, où la peinture de la rue est plus estompée, c’est la peinture de la maison qui est expressive de cette situation, comme dans la série des albums Ernest et Célestine. Le couple formé par le gros ours et sa petite fille adoptive vit dans une situation tout à fait symbolique de la précarité, sans pour autant être marginaux puisqu’ils entérinent les codes de vie de la société. Les aquarelles esquissent un vrai décor de pauvreté, mais les éléments qui transparaissent de leur maison sont autant de synonymes de refuge, de chaleur du foyer, que tout abri permanent doit être pour des gens qui vivent dans la précarité. Il n’y fait pourtant certainement pas très chaud, puisque Célestine et Ernest superposent souvent leurs vêtements, et que le poêle doit être rallumé… Symbole de protection aussi dans P’tite mère : un décor réduit à l’essentiel, et un gros édredon, comme une bulle de chaleur tout ronde dans laquelle les enfants sont lovés, dernier rempart contre la froidure du dehors.
Les vêtements
Comme l’édredon, les vêtements sont symboliques d’un reste de dignité humaine, et la dernière défense contre les agressions de la rue. Être habillé signifie être encore protégé, avoir encore figure présentable, comme le héros de Feuille de verre : « J’étais nu comme un ver, ou presque. Je n’avais qu’un tee-shirt complètement mort sur le dos et une espèce de pantalon qui n’en était pas vraiment un. Il n’avait de pantalon que le nom, je le portais simplement parce que je ne pouvais pas faire autrement, il faisait partir du décor, si je puis dire, je n’imaginais pas un seul instant m’en séparer, mais il ne me protégeait convenablement ni le cul, ni les guibolles. »
Tout aussi importantes, les chaussures. Pour les ados, ce sont les baskets, concentré de société de consommation et code d’identification. C’est devant la vitrine d’un vendeur de baskets que les protagonistes de Un garçon comme moi se rencontrent. Riches ou pauvres, devant la même vitrine, leurs rêves les unissent et les séparent en même temps : pour l’un le dernier modèle relève d’une lubie de plus, pour l’autre de l’inaccessible. Et pourtant : « Coucher dans la rue me fait peur. Mais marcher dans la rue au petit matin me fait encore plus peur. Tout est désert. À cette heure, il n’y a plus dehors que la police et les gens dangereux. Ou des rats. C’est l’heure de leur promenade. Si j’avais de grandes baskets comme celles du magasin, je me baladerais en shootant dans les rats. Mais pieds nus, on ne peut pas faire l’imbécile. Un jour un rat énorme a cru que mon orteil était le meilleur hamburger qu’il ait jamais vu. Et il a décidé de se le gagner. Ça a été dur d’échapper à la bête. Elle voulait mon orteil à tout prix. »
Le rat, maître de la rue, beaucoup moins supportable que les souris qui mènent une allègre sarabande dans la cuisine de P’tite Mère … Le rat, ennemi-ami, s’incruste dans la vie d’un homme tombé dans la déchéance au fond d’une ruelle ; lui dispute sa pitance, guette son premier signe de faiblesse. Avant d’établir avec lui une étrange relation d’égal à égal (Le rat).
Pendant longtemps, dans la littérature jeunesse, les personnages en situation de précarité ont été, globalement, des adultes, ce qui permettait de maintenir un peu de distanciation vis-à-vis de situations affectivement lourdes à « vivre » pour les lecteurs jeunes.
L’anthropomorphisme servit aussi de stratagème pour permettre de comprendre, à leur niveau, la difficulté de vie en situation de précarité. Avec des réussites diverses, qui vont de l’analyse subtile et sensible au manichéisme primaire de certains titres.
Dans les ouvrages récemment publiés, ce sont en fait tous les âges de la vie qui incarnent les différentes situations.
Des adultes déstructurés
La différence entre les adultes qui dessinaient le portrait de la marginalité et ceux qui dressent aujourd’hui le tableau de la précarité tient à ce que ces derniers sont moins des êtres en rupture de société que les victimes d’un système qui fait de la pauvreté un cercle infernal. Si ce sont presque toujours des personnages secondaires, ils n’en sont pas moins « la » référence adulte proposée aux héros jeunes dans des histoires à peine imaginées.
Chômage, divorce, accident de santé, ont déstabilisés ces adultes, leur ont fait perdre peu à peu leurs repères personnels, parfois dans un passé bien antérieur à l’action du roman. Pris dans l’engrenage de la dégringolade sociale, ils y entraînent les enfants dont ils ont la charge. A contrario, d’autres parviennent à nouer un contact avec les enfants esseulés, et à les aider afin de leur éviter une déchéance plus grande. Dans une sorte de « happy end », salvateur pour les héros et rassérénant pour le lecteur, ils rétablissent un simulacre de famille, les aident à réintégrer un circuit économique où un semblant de travail leur rendra leur dignité (Maestro, Un garçon comme moi).
La plupart de ces adultes sont en galère, et le regard que leurs propres enfants portent sur eux est souvent lucide, parfois sans pitié, comme celui de Uolace (Un garçon comme moi) qui peut réellement se demander si sa mère, noyée en permanence dans l’alcool, a jamais su qu’elle avait un fils.
Étrange image de père que ce boxeur atteint par un coup trop violent, et qui en perd ses repères (Papa porte une robe). Son comportement « hors normes » entraîne les siens dans la précarité, et il faudra l’intervention de personnes intelligentes pour qu’il puisse restaurer son équilibre, et le leur.
Dans ce tableau plutôt sombre des adultes en situation précaire, il y a aussi des parents attentifs et présents qui, malgré les épreuves traversées, ne perdent jamais des yeux leurs enfants ; ils font tout pour leur épargner le pire en maintenant autour d’eux une bulle d’affection, la meilleure protection contre l’adversité (P’tite mère).
La cohorte des enfants délaissés
Depuis que la précarité « ordinaire » a pris le pas sur l’errance du SDF, l’émergence de personnages enfants, de plus en plus jeunes, est plus évidente.
Cohorte impressionnante de ces enfants rejetés dans l’instabilité : le sort qui leur est réservé dépend de l’âge qu’on peut leur attribuer, de la présence ou non d’un adulte à leur côté.
Les plus jeunes sont souvent accompagnés d’un ou de deux adultes, la plupart du temps leurs parents comme pour la petite Laeticia. (P’tite mère). Cette pauvreté « ordinaire » dans l’environnement occidental européen reste « supportable » pour son personnage – et pour le lecteur qui a presque son âge – parce que l’affection de ses parents ne lui fait jamais défaut.
À l’inverse, les garçons croisés dans les rues des grande villes (Le petit marchand des rues, Miloko) sont complètement isolés, sans autre ressource que la mendicité, le vol à la sauvette.
Gamin solitaire, Nino, orphelin à qui l’on conseille de fuir la favela à la mort de sa mère pour essayer de s’en sortir, de trouver de quoi vivre dans la mégapole de Rio (L’enfant qui voulait dormir).
Seuls dans la cohue d’une grande ville indienne, Asha et son ami Nahir survivent de menus services rendus aux passagers des trains (Pieds nus dans la rue).
Solitaire, le jeune émigré à l’identité imprécise, débarqué d’on ne sait trop où en Afrique sur une île volcanique sicilienne, et qui vend des objets de pacotille aux touristes à la descente des bateaux (Boum).
Si les enfants en situation précaire sont plus nombreux qu’auparavant dans les romans traitant de ce thème, cela tient sans doute à la description du phénomène des bandes d’adolescents, qui vivent l’extrême pauvreté des favelas sud-américaines, des grandes villes africaines ou indiennes. Leur errance ne tient pas de la fugue ou de la rébellion contre la famille, mais essentiellement du fait que leur environnement est devenu insupportable, que leurs parents sont morts ou en perdition. La structure sociale de la bande leur permet d’organiser leur vie, leur survie plutôt. C’est leur statut d’enfants en état de pauvreté qui est analysé pour lui-même, et non plus celui des adultes qui les entourent.
Deux bandes se croisent, s’observent et se défient sur le trottoir d’une ville sud-américaine, jusqu’à la bagarre qui concrétisera la haine entre riche et pauvre (Un garçon comme moi). Bande qui s’organise pour survivre dans les rues d’Addis-Abbeba (Princes des rues), bande de petits cireurs de chaussures ou vendeurs de journaux, qui exercent à la sauvette des métiers d’adultes (Maestro).
Tous ces personnages sont des enfants que les circonstances de la vie ont isolés du schéma social habituel. Leur solitude est d’autant plus grande, au début de leur histoire, que ceux qui le croisent ne semblent pas, ou ne veulent pas, les voir. Bien que teinté d’exotisme, à l’image d’un décor sud-américain, ce contexte permet de donner un ton bien plus réaliste à cette peinture de la précarité. L’isolement des enfants dans ces mégapoles déshumanisées est bien expressif d’une réalité locale ; et il est aussi plus supportable pour le lecteur européen, parce que son éloignement induit une certaine distanciation.
Causes et effets de la précarité
Bien souvent, il n’est pas précisé pourquoi les enfants aboutissent ainsi dans la rue. Car, plus que leur parcours qui les a conduits là, plus qu’une analyse sociologique des causes de la précarité, c’est la peinture des réactions des jeunes face à l’ensemble de la société, le côté exemplaire de leur situation et les effets qu’elle induit sur leurs modes de relation qui intéressent.
La dégradation du cadre de vie familial, pas toujours explicitée, le changement de statut social des parents y sont pour beaucoup : absence, abandon ou mort d’un père entraînant la privation de ressources et/ou la déchéance d’une mère. Échouer dans la rue est une étape grave, le retour en arrière devient difficile, surtout si l’épreuve se prolonge (Princes des rues, Champ de mines, Maestro, Le garçon qui voulait dormir).
À cela s’ajoutent les conditions économiques dans les pays sous-développés, la pauvreté d’une immense majorité de la population, pauvreté structurelle aggravée par d’autres fléaux : la famine, la guerre. (Champ de mines)
Les effets de la précarité se rejoignent d’une histoire à l’autre: la galère le long des trottoirs, l’inactivité, la vacuité des jours qui se ressemblent dans la quête de nourriture, la douloureuse sensation de manque, de faim, qui empêche de dormir, la frénésie de dépenser en une seule fois dans un énorme jus de fruit ou un hamburger les trois maigres pièces qu’on a eu tant de mal à grappiller (L’enfant qui voulait dormir).
Tous les sentiments, toutes les sensations et émotions que ce type de vie font naître sont abordés : faim, haine, peur, solitude, honte.
De la France à l’Amérique latine est évoqué, assez brièvement, le problème de la déscolarisation des enfants (P’tite mère, Un garçon comme moi). Plus récurrents : les démêlés avec la police, les conflits entre bandes rivales, les bagarres, les combats dans la rue, les révoltes de la faim (Maestro).
Les scènes de rue révèlent parfois de beaux moments de solidarité, mais elles sont surtout le cadre des petits boulots, et des activités plus ou moins licites pour obtenir une ou deux pièces de monnaie afin d’acheter le hamburger mythique. Tout y est : cireurs de chaussures, vendeurs de journaux, laveurs de pare-brise au feu rouge, chiffonniers, etc. (Maestro, Feuille de verre).
Condensé symbolique de l’état de précarité, le garçon qui essaie de vendre trois fruits au feu rouge, ne rencontre que méfiance, hostilité, regards durs des automobilistes qui roulent toutes issues fermées pour ne pas se retrouver sous la menace d’une arme au feu rouge. Abrégé saisissant où s’entremêlent mendicité et agression à peine différenciées.
Ces « métiers » de précarité permettent de ne pas devenir totalement dépendant par la mendicité ou l’agression – décrite avec verdeur – qui permettent d’extorquer l’argent des passants (Un garçon comme moi) :
« La seule façon de leur faire cracher un peu de tunes, c’est d’être très mal élevés […] C’est comme cela qu’il faut s’y prendre, on s’approche du propriétaire ou de la propriétaire du portefeuille, on prend un air féroce et on crie :
– Crache ton fric !
Et ils le donnent.
Alors on file en courant, mort de rire. Il faut vraiment courir parce que des fois, il y a un flic derrière. »
L’improbable rencontre
Face à ces personnages dans lesquels on peut se reconnaître, chacun peut se dire : « c’est Un garçon comme moi ». Tous ces livres le montrent bien : la précarité peut atteindre n’importe qui. Il ne s’agit plus, en l’occurrence, d’adultes en rupture de société, mais bien de jeunes, d’adultes, victimes d’un système qui rejette les plus démunis, les plus faibles, aux frontières de la société dite « normale ». Par-delà les différences de données économiques entre le Nord et le Sud, les ressorts qui y entraînent sont les mêmes. Cet autre, si semblable à soi, est-il possible de le reconnaître, de le rencontrer ? Le face-à-face qui surgit avec acuité, et violence dans deux romans.
Rencontre ? Plutôt croisement de deux lignes de vie, de deux bandes d’adolescents, une riche et une pauvre, aux hiérarchies similaires, comme un double dans le reflet de la vitrine dans la vitrine du marchand de baskets. Le roman analyse le regard porté par l’une sur l’autre. Si les deux garçons placés au coeur de la confrontation souffrent de la même absence de père, leurs mères sont très différentes : l’une mène une vie aisée et surveille son fils de trop près ; l’autre, pire qu’une clocharde, a oublié depuis longtemps le sien dans l’alcool.
Parallélisme des ressorts de la violence entre les deux bandes : envieux et m’as-tu-vu, fascination de l’excès de bien de consommation, démonstration magistrale de puissance, corollaire de la peur de l’autre, ou de la sienne. Conclusion en demi-teinte : les deux personnages médians prennent conscience de la précarité de leur sort personnel, aussi incertain que ce soit dans la rue ou dans la maison. (Un garçon comme moi)
Célestino, jeune ado de seize ans un peu oisif croise la route d’un garçon solitaire, encombré d’une lourde valise. Dans l’espace clos de l’île, son chemin croise sans cesse celui de l’autre, entré clandestinement en Italie depuis l’Afrique. Celui qui vit en situation précaire, c’est presque un autre lui-même. Vague curiosité de l’un, indifférence de l’autre : si la confrontation se dessine, la rencontre des deux garçons est impossible. Ils ne se parlent quasiment pas, n’échangent pas. Et leurs routes s’écarteront de la même manière qu’elles se sont croisées : sans raison. Au passage, il y aura eu un vol, dont le nanti se moque éperdument, et dont le pauvre se défend, en venant rendre l’objet volé. Curieux roman qui reste à la surface des choses, traduisant ainsi peut-être l’impossibilité de rencontre entre riche et pauvre. L’auteur démontre plus en racontant l’impossibilité de l’échange, que par une histoire trop positive.
Sortir (ou pas) de la précarité
Aucun futur positif n’est certain dans ces romans, lorsqu’ils veulent parler vrai jusque dans leur conclusion.
Les fins optimistes relèvent parfois du conte de fées. Asha réalisera son rêve de danser en gagnant un concours et en étant prise en charge, avec son ami Nasri, par une fillette issue de famille riche émue de sa situation (Pieds nus dans la rue). Ce type de « happy end » n’a de sens qu’en fonction de l’âge du lecteur enfant auquel il est difficile, voire impossible, d’imposer un « non espoir ».
Il y aussi le regard attentif et agissant d’adultes alertés par l’état de dénuement de gamins à peine sortis de l’enfance. Leur intervention donne le coup de pouce indispensable. La famille de Laeticia est prise en charge par les services sociaux alertés par son institutrice (P’tite mère).
Tous n’auront pas la possibilité de se découvrir une vocation, de voir s’épanouir un véritable don artistique comme Tartamudo, un des plus rebelles de ceux qui entrent à l’école de musique lancée pour les enfants des rues par le vieux musicien. Son succès d’artiste à la voix exceptionnelle ne rachètera pas la mort de l’un d’entre eux sous les coups de pied de la milice lors d’un pillage de vitrines. Un des rares romans à conclure sur un futur lointain, ce qui permet de mesurer le chemin parcouru par chacun (Maestro).
Ainsi enfin pour deux amis de Uolace (Un garçon comme moi) : l’un trouvera sa place en « héritant » de la bicoque d’un vieux monsieur qui s’est intéressé à son sort ; pour un autre, ce sont les parents qui franchissent le pas : retour au village, qu’ils n’auraient jamais dû quitter, pour y retrouver une forme de socialisation et offrir à leurs enfants une chance d’en bénéficier. Cette issue suppose néanmoins un choix crucial pour le héros en tant qu’adolescent : s’exclure de la bande pour tenter de trouver une place, même incertaine, dans l’environnement social. Uolace, lui, n’aura pas cette chance : malgré un sursaut d’humanité, sa mère, engluée dans sa déchéance, définitivement plus préoccupée de sa dépendance que du sort de son fils, l’abandonne à la rue où il ira disputer ses orteils à la voracité des rats. (Un garçon comme moi).
Ainsi, plus les héros (et leurs lecteurs) avancent vers l’adolescence, plus la conclusion des romans tend au réalisme, sans apporter de solution magique à des situations ancrées dans une réalité profondément grave. Pour un qui sort de la misère, combien y en a t-il qui, comme dans une scène de cinéma, s’en vont vers le coeur de la ville pour se perdre dans la masse, vers une incertitude évidente ? (Un garçon comme moi, Princes des rues, Boum) L’histoire laisse flotter en suspens leur silhouette fragilisée par une fatalité qu’ils n’ont pas su vaincre au cours du récit. Engrenage inéluctable et logique, qui confère à tous ces ouvrages un réel accent de vérité tout en laissant un fragile espoir d’avenir meilleur, puisque d’autres ont pu y accéder.
Toi, vole ! album publié tout récemment, ramène le lecteur enfant à une précarité de proximité d’autant plus pernicieuse qu’elle parvient à se fondre dans l’anonymat de la foule. L’auteur, américaine, s’appuie sur des faits avérés remontant aux années 90 : la présence dans les aéroports internationaux d’adultes en situation de précarité qui y organisent leur survie au milieu des voyageurs. Un père et son fils parviennent à se fondre dans la foule, à passer complètement inaperçus : l’adulte a un travail précaire (vigile durant le week-end), et n’est pas en mesure d’assurer l’hébergement de son enfant. La fin laisse espérer une issue, dans le symbole de l’oiseau piégé dans l’aéroport et libéré par le petit garçon.
Parce que l’illustrateur, en reprenant tout récemment ce texte, a situé l’action dans une aérogare qui ressemble beaucoup à Roissy, le livre fait toucher du doigt, sans grand discours, ce vers quoi tend désormais la précarité « ordinaire » : des adultes, plutôt jeunes d’ailleurs, qui ne sont en rien des marginaux, ne parviennent plus à prendre place dans les schémas types que les conditions économiques imposent.
Cette analyse succincte, dont chacun des aspects pourrait être approfondi pour lui-même, permet de discerner les couleurs que la littérature de jeunesse donne à un problème social grave et multiforme. Le sujet n’est jamais clos, puisqu’il évolue selon le ton de plus en plus réaliste des livres pour la jeunesse, selon les âges de lecture concernés et les données socio-culturelles d’un problème en évolution constante. La tendance actuelle s’inscrit vers plus de réalisme, jusque dans les solutions pour s’en sortir : la porte est étroite, mais elle reste ouverte.
( mars 2007 )
D’abord enseignante, Muriel Tiberghien fut rédactrice en chef adjointe pour la partie jeunesse de la revue Notes Bibliographiques (Culture et Bibliothèques pour tous) et, à ce titre, coordinatrice du comité de lecture. Des articles toujours très documentés, des formations, des interventions et des collaborations nombreuses, notamment avec le CRILJ dont elle est administratrice.
Bbliographie des ouvrages cités :
Ammi Kebir Mohamed, Feuille de verre, Gallimard Jeunesse, 2004
Barsony Piotr, Papa porte une robe, Seuil jeunesse, 2004
Brûlé Michel, L’enfant qui voulait dormir, Grasset Jeunesse, 2005
Bunting Eve, Toi vole, Syros jeunesse, 2006
Ferdjoukh Malika, Boum, École des loisirs, 2005
Herbert Magali, Le rat, Bayard Jeunesse, 2004
Lago Angela, Le petit marchand des rues, Rue du monde, 2005
Laird Elisabeth, Princes des rues, Gallimard Jeunesse, 2004
Petit Xavier-Laurent, Maestro, École des loisirs, 2005
Sampiero Dominique, P’tite mère, Rue du monde, 2002
Siccardi Jean et Guth Joly, Miloko, Le Rocher Jeunesse, 2004
Strauss Rosa Amanda, Un garçon comme moi, Seuil/Métailié, 2005
Ternaux Catherine, Pieds nus dans la rue, Flammarion Jeunesse, 2005
La création et le livre pour la jeunesse
Extraits du discours de clôture du colloque de Saint-Etienne (Loire) L’enfant et la création – 22, 23 et 24 octobre 1982.
Ce colloque a été extrêmement vivant, la diversité des sentiments qu’il a provoqué est un signe de la liberté des discussions, il y a eu un foisonnement d’idées fort sympathiques.
L’enfant a été constamment présent au cours de ce colloque, l’enfant et le jeune, et la création aussi. J’ai été sensible à de très belles phrases de plusieurs auteurs qui nous disaient : « La création, c’est le retour aux sources de l’élémentaire (Georges Jean), « La création c’est une vraie littérature de l’imaginaire ; les livres ne délivrent pas de message monolithique étroit, ils constituent des graines que l’on sème en aveugle » (Jacqueline Held), « Le livre est le plus enrichissant des jeux, le livre c’est la complicité entre l’auteur et le lecteur » (Huguette Pérol).
De l’expression de ces points de vue, il est vrai que nous pourrions être satisfaits et, dire que le colloque a été un « témoignage de foi et d’enthousiasme ». On a pu remarquer chez plusieurs intervenants certains signes d’inquiétude :
Bernadette Bricout a parlé de l’inquiétude des créateurs, des parents, de la critique, des médiateurs du livre : éditeurs, bibliothécaires, libraires, enseignants. M. Despinette s’est demandé si l’enfant est le véritable acheteur, s’il n’est pas l’acheteur au second degré et comment était informé l’acheteur véritable.
Cette inquiétude s’est révélée presque angoissante lorsqu’Hélène Gratiot-Alphandéry et Germaine Finifter nous ont fait connaître chacune pour sa part les résultats de leur enquête.
Ainsi chacun à son tour est apparu pour dire « nous sommes oubliés », et j »ai noté avec émotion le cri de Jean Claverie qui disait : « Apprenez à connaître les gens de l’image ». Chacun a l’impression qu’il n’est pas assez connu des autres. Dans le même sens, Christian Bruel a manifesté l’importance qu’ont les traductions, et il a dit à juste titre : « la traduction, c’est faire l’apprentissage de l’autre et de la différence, mais cela peut être aussi une paresse : l’importance donnée aux grands classiques, à la réédition, est un signe de longévité, mais peut devenir aussi signe de stagnation ».
François Ruy-Vidal a insisté sur l’insuffisance des circuits de réception et on a parlé du silence des médias. Plus gravement, Jean Cazalbou remarquait que l’insuffisance de la lecture chez les jeunes reflétait la structure sociale puisque 80% des livres étaient lus par 20% des lecteurs.
Heureusement, quelques éléments d’espoir ont contrebalancé cette inquiétude : le développement du livre de poche, le crédit des illustrateurs français à l’étranger, le fait que, Isabelle Jan le disait, l’enfant de l’audio-visuel, c’est aussi l’enfant de la lecture et qu’il n’y a pas de contradiction, et on montrait comment ces enfants de l’audio-visuel avaient plaisir à lire et à écrire.
Raoul Dubois a insisté sur le fait que nous étions résolument optimistes, il a rappelé le développement des veillées et la présence des médias et en particulier des médias dans les régions.
Un nouvel élément renforce notre optimisme, à ce colloque du CRILJ, il y a beaucoup plus de jeunes qu’au début de nos réunions.
J’ai parlé d’enthousiasme, j’ai parlé d’inquiétude, j’ai parlé d’espoir, il y a un mot qui a été employé, à deux reprises, dans deux interventions proches l’une de l’autre, c’est le mot confiance. Huguette Pérol a dit que la lecture, c’était à la fois confiance du créateur et confiance du lecteur tandis que Keleck lançait un cri angoissé des illustrateurs qui était : « faites-nous confiance ».
On a beaucoup discuté, on a été optimiste, on a été inquiet, mais peut-être pourrions-nous reprendre pour le compte du CRILJ, l’expression de Keleck, en l’élargissant : « Faisons-nous confiance et travaillons ensemble dans la confiance ».
( texte paru dans le n° 18 – 15 décembre 1982 – du bulletin du CRILJ )
Né en mars 1917 à Barbaste (Lot-et-Garonne), ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de lettres, Jean Auba fut iinspecteur général de l’Instruction publique. conseiller technique de plusieurs ministres de l’Éducation nationale et, de 1967 à 1983, directeur du Centre international d’études pédagogiques de Sèvres (CIEP). Spécialiste en sciences de l’éducation, correspondant de l’Académie des sciences morales et politiques, il a exercé de nombreuses responsabilités associatives : vice-président-fondateur de la Fédération internationale des professeurs de français, vice-président de l’Alliance française de Paris, président de l’Association des membres de l’ordre des palmes académiques, fondateur de l’Association francophone d’éducation comparée. Il fut, de 1975 à 1983, au Centre de recherche et d’information sur la littérature pour la jeunesse (CRILJ), un président très présent, attentif au rayonnement de l’association.
Michèle Piquard
par Viviane Ezratty
Nous avons appris avec tristesse la disparition cet été de Michèle Piquard. Nous avions eu la chance de partager certains de ses questionnements en tant que chercheuse et d’apprécier ses qualités humaines. A quel moment Michèle Piquard est-elle devenue une habituée de l’Heure Joyeuse ? Il me semble me souvenir qu’elle avait pris rendez-vous avec Françoise Lévèque, responsable du Fonds historique, pour travailler sur la collection des Enfants de la terre, et que Françoise lui avait proposé de la mettre en relation avec François Faucher, pour travailler sur les archives du Père Castor. Elle en avait été ravie et cela a pu se faire facilement. Les liens étaient noués.
Ils se sont renforcés, alors que Françoise et moi rencontrions régulièrement François Ruy-Vidal, ce dernier nous parlait toujours d’une personne formidable doublée d’une chercheuse rigoureuse qu’il serait bien que nous rencontrions. Il s’agissait de Michèle Piquard et nous nous sommes retrouvés tous les quatre à déjeuner un certain nombre de fois. Ces déjeuners discussions, nous plongeaient dans l’histoire foisonnante et passionnante du travail d’éditeur de François Ruy-Vidal, dont elle avait une grande connaissance. Je garderai toujours en mémoire ces moments d’exception, joyeux par moments, plus graves à d’autres, alors que Michèle Piquard faisait part de ses doutes en tant que chercheuse. Et puis la maladie était là, elle en parlait librement, disant qu’elle mettait toute son énergie à se battre contre elle pour son fils.
Lorsque François Ruy-Vidal a fait don de ses archives à l’Heure Joyeuse, cela nous est apparu comme une évidence à tous, que c’était elle qui devait les explorer et également mener des interviews de François Ruy-Vidal sur son travail. Elle est venue un certain nombre de fois à l’Heure Joyeuse pour cela, mais ce printemps 2012, elle nous a dit qu’elle ne pouvait plus assumer ce travail, à cause de la fatigue que cela représentait. Et puis il y a eu une dernière opération et le choc d’apprendre son décès, parce que jusqu’au bout nous ne pouvions imaginer que ce ne soit pas sa volonté qui gagne.
Au-delà de l’émotion qui perdure, il restera le fruit de son travail de chercheuse et en particulier son ouvrage sur l’Edition pour la jeunesse en France de 1945 à 1980 qui, sans jargon inutile, démontre sa maîtrise du sujet. Un traité qui est encore la référence sur la question du livre pour la jeunesse et permet d’en objectiver l’approche. Je garderai aussi la vision d’une chercheuse en action, exigeante, allant jusqu’au bout de ses questionnements, intéressée par l’enfance, l’éducation nouvelle et la création artistique.
(octobre 2012)
Conservatrice des bibliothèques de la Ville de Paris depuis 1979, Viviane Ezratty est, depuis 1986, directrice de la bibliothèque L’Heure Joyeuse. Elle a collaboré à L’Histoire des bibliothèques françaises (Promodis-Cercle de la librairie, 1992), L’Heure Joyeuse, 1924-1994 : 70 ans de jeunesse (Agence culturelle de Paris, 1994), Désherber en bibliothèque (Cercle de la librairie, 1999). Elle est signataire régulière d’articles dans le Bulletin des Bibliothèques de France et dans La Revue des livres pour enfants où elle assure la veille des revues spécialisées “littérature pour la jeunesse” de langue anglaise. Membre du comité permanent des bibliothèques jeunesse à l’IFLA (International Federation of Library Associations), elle apporte également son concours au conseil d’administration du CRILJ.
Chargée de recherche au CNRS, Michèle Piquard fut spécialiste de l’histoire du livre et de la lecture. Elle a consacré ses recherches à une analyse historique et sociologique du processus de « patrimonialisation » de la littérature pour la jeunesse au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, dans le cadre de l’histoire économique, juridique et institutionnelle de l’édition pour la jeunesse.
BIBLIOGRAPHIE
. Ouvrages :
2004, L’Edition pour la jeunesse en France de 1945 à 1980, Presses de l’ENSSIB, réédition. 2005
. Articles :
2011. Paul Faucher, concepteur des albums du Père Castor, sergent recruteur de la Nouvelle Education dans l’entre deux guerres (Recherches & éducations n°4)
2008. Robert Delpire, précurseur dans l’édition pour la jeunesse des années 1950-1970, (in « Robert Delpire éditeur », mis en ligne le 14 juin 2010 : http://strenae.revues.org/75)
2007. La Bibliothèque Rouge & Or à l’heure de la concentration des entreprises d’édition, 1961-2006, (in Les Cahiers Robinson n°21, Université d’Artois)
2007. La Littérature de jeunesse a-t-elle atteint l’âge adulte ? (in Dazibao, n°15, Agence régionale du livre PACA)
2007. L’Emergence d’un nouveau concept d’édition dans l’album pour la jeunesse des années soixante-dix (in « La Littérature jeunesse, une littérature de son temps ? », Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis)
2005, Les Stratégies des éditeurs pour la jeunesse depuis 1965 : réponse aux demandes et élaboration de l’offre, analyse d’exemples, (in « Regards sur le livre et la lecture des jeunes : la joie par les livres a 40 ans », actes du colloque 29 et 30 septembre 2005, Bibliothèque Nationale de France)
2005. New Editing Strategies of French Catholic Publishing Houses since 1945, (in « Religion children’s literature and modernity inEurope 1750-2000 », sous la direction de Jan de Maeyer, Hans-Heino Ewers, Rita Ghesquière, Michel Manson, Leuven University Press)
2004. Les Presses enfantines chrétiennes aujourd’hui en France : la montée en puissance du groupe Bayard, (in « Les Presses enfantines chrétiennes », actes du colloque des 14 et 15 décembre 2004, Presses de l’Université d’Artois)
2004, Le Roman de Renart : patrimoine littéraire pour la jeunesse, entre culture scolaire et culture de masse, (in « Children’s publishing between heritage and mass culture, L’Edition pour la jeunesse entre héritage et culture de masse », Institut international Charles-Perrault, GREC (Paris XIII), CEEI (Paris VII) et Afreloce)
2004. Renart et les anguilles dans l’édition pour la jeunesse depuis 1945 : Renart de male escole, (in Les Cahiers Robinson, n° 16, Université d’Artois)
2003. La Loi du 16 juillet 1949 et la production de livres et albums pour la jeunesse, (in « L’Image pour enfants : pratiques, normes, discours : France et pays francophones, XVI-XXe siècles », La Licorne, n°65, Poitiers : Maison des Sciences de l’Homme et de la Société)
2002. François Ruy-Vidal et Harlin Quist, nouveaux concepteurs dans l’édition pour la jeunesse des années 1970. Etude de cas : Les Contes de Ionesco, (in « Communication et histoire : Ecritures et espaces-temps pluriels », journées d’étude organisées les 9 et 10 mars)
François Ruy-Vidal, éditeur, a souhaité compléter ce témoignage par un extrait de la lettre qu’il a adressée au fils de Michèle :
« Michèle m’a toujours accompagné. sans faille, sans hésitation en me permettant même, sur la fin de ma vie, par son courage, son engagement, sa générosité et son soutien moral et amical, alors qu’elle était déjà affaiblie par les assauts de ce qui la rongeait, de ne pas désespérer, de regarder mon passé sans trop le discréditer comme j’étais porté à le faire, en m’obligeant à voir les livres que j’ai publiés avec le regard indulgent et tonique avec lequel elle les considérait elle-même.
Je souhaite qu’elle vive en vous comme elle vivra en moi tant que je vivrai. Avec sa profonde honnêteté, sa rigueur, sa simplicité et cette intuition exceptionnelle qui lui permettait, sans rien demander, de nous obliger à nous élever à sa hauteur. Ce fut pour moi un grand bonheur de la connaître et un honneur de savoir qu’elle me comptait parmi ses amis. Je lui dois beaucoup car elle m’a toujours accompagné et aidé. »
(septembre 2012)
Le voyage est dans les livres
par Christiane Abbadie-Clerc et Bernard Pédebosq
La lecture portée par la magie des images est toujours une invitation au voyage, d’autant plus séduisante que les écrivains et illustrateurs se révèlent, avec leurs passions, leurs talents, leurs convictions, proches de l’univers d’enfance. Tout livre entraîne un dé-pays-ement au sens propre. Voyage dans l’espace, dans le temps, dans l’imaginaire, voyage plus intimiste, ou à l’intérieur de soi-même. Voyage au centre de la terre ou Voyage de Gulliver ou bien Voyage au pays des Merveilles ou « de l’autre côté du miroir » avec Alice. Chaque fois, dans chaque album, dans chaque livre, il s’agit d’un chemin nouveau accompagné par l’auteur d’abord, par des personnages et des images ensuite, par tout un environnement riche de valeurs. En complicité les auteurs croisent la plume et le pinceau pour camper les décors et donner naissance à des « héros » qui captent l’attention de leurs jeunes lecteurs, parce qu’ils leur ressemblent comme frères et sœurs.
Henri Wallon et Marc Soriano insistaient sur les secrets de ce « double ton » de l’enfant et de l’homme, propre à favoriser les ressorts d’identification à l’histoire, aux personnages. Les auteurs, pères ou mères de famille entourés d’enfants ont souvent une expérience passionnante dans le domaine de l’éducation, de la librairie, des bibliothèques, du journalisme, de la radio, du cinéma, du spectacle ou des beaux arts. Ils mettent en jeux l’art de la communication, l’humour, la tendresse mais aussi indirectement leur histoire personnelle, dans ce petit théâtre d’apprentissage social qu’est le livre de jeunesse. Ils ouvrent en grand les fenêtres sur la vie et sur le monde, sur un vent frais de liberté et d’invention de sorte que l’enfant devient ainsi son propre démiurge. Il déménage alors de l’intérieur, et se réapproprie les valeurs de la tolérance, de la diversité culturelle, l’histoire des révoltes, intègre les balises et les repères pour trouver sa place dans un monde élargi où la solidarité et les valeurs d’échange peuvent être des moyen de survie.
Dans le Livre du voyage, Bernard Werber propose : « Imaginez un livre qui vous entraîne vers le plus beau, le plus simple et le plus étonnant des voyages. Un voyage dans votre vie. Un voyage dans vos rêves. Un voyage hors du temps. »
(octobre 2011)
Ce texte, publié sous la double signature de Christiane Abbadie-Clerc et Bernard Pédeboscq, administrateurs du CRILJ/Pau-Béarn, est l’introduction à la sélection de livres proposée aux visiteurs de la douzième édition de « Frissons à Bordères » dont le thème était L’invitation aux voyages. Document disponible à cette adresse.
Une réponse à Georges Jean
Si la chape de silence écrasant le livre de jeunesse, entrefêlée depuis quelques années par quelques téméraires, naïfs, désintéressés et impécunieux (critiques, associations et gens du livre) semble se fendre aujourd’hui, la fissure reste modeste et peut, d’un jour à l’autre, se refermer.
Le Colloque de Saint-Etienne l’a encore élargie de quelques millimètres, mais à quel prix !
Trop de choses à dire en deux jours et un soir. Certains en bégayaient, d’autres parlaient trop vite ou cédaient à la rhétorique par pudeur universitaire et beaucoup n’ont rien pu dire.
Ce qui aura été mis à jour, la partie émergée, c’est la caresse voluptueuse, mais la caresse qui reste fugitive et fait souffrir d’en rester là. C’est pourtant toujours ça de pris !
Comme à vous, que j’ai entrevu et avec qui je crois partager la même passion, il me reste bien des choses à dire. D’abord, en premier lieu, que d’autres gens de l’image auraient pu intervenir à ma place.
Ensuite, je tenterai, en faisant court, de répondre à Georges Jean, ce que j’ai mal fait par inexpérience : il ne fallait pas lâcher le crachoir.
1) Y a-t-il une finalité Jeunesse ? Certes, Georges Jean, on crée pour soi et pour tout le monde. Souvent l’illustrateur doit tuer le père, l’auteur du livre aimé pendant l’enfance. Pour moi ce fut Samivel et son Joueur de flûte qu’un vent contraire a privé de l’auteur/profanateur avec lequel je comptais m’acoquiner : François Ruy-Vidal. C’est la façon qu’ont les illustrateurs de « guérir de leur enfance » en en conservant précieusement la cicatrice, la mémoire car le rapport à soi-même, petit, ne se gomme jamais. Avec les armes que sont cultures et savoir-faire, on court après d’autres livres qu’on aurait pu aimer autrefois en ayant bien à l’esprit que l’enfance d’aujourd’hui est différente. Serait-ce là le bon usage du narcissisme auquel vous faisiez allusion ?
Créer pour tout le monde ! Oui, mais comme vous le dites, sans penser aux tranches d’âge, aux données psychologiques qui feraient « polir » un produit marketing, sans penser non plus aux « problématiques » que condamnait Bruel et qui tiennent lieu de concepts éditoriaux à bon marché – le sexe, la mort, l’argent – méritent, en effet, mieux que de servir d’étiquettes. Ils doivent s’introduire, j’oserais dire subrepticement, poétiquement dans le livre, autorisant ainsi une lecture complexe mais pas nécessairement compliquée. Littérature et image débordent donc le public jeune. A ce propos beaucoup d’illustrateurs, dans la recherche de complicité (et non d’admiration) en jouant de clins d’yeux, d’empilement de métaphores, pensent aussi au plaisir/travail de l’adulte porteur d’un enfant sur les genoux ou simplement lecteur pour soi. Malheureusement ce sont encore les petits qui sentent, les grands n’ayant appris à « lire » que les images prémâchées de la pub, de modes d’emploi, de l’érotisme, autant dire de rien lire du tout. Il y a pourtant quelques adultes attardés !
Vous posiez aussi la question de la revitalisation de la création. Certes, grâce à Quist, Ruy-Vidal puis Marchand, Colline Poirée et certains autres, il y a eu du nouveau. Normalement je devrais ici glisser ici une longue liste d’illustrateurs que j’aime mais faute de place… Il faut cependant aussi ne pas oublier le rôle qu’a joué l’étranger dans ce réveil de la création hexagonale : pour l’image on cite souvent Sendak, presque trop souvent car on en oublie d’autres au moins aussi importants : Mercer Mayer, les Dillon, Edelman, la mère nourricière des années 1970. Les Français ont souvent trouvé chez eux l’exemple de l’audace, de la liberté formelle mais surtout conceptuelle, le tremplin qui les a détournés (bien ou mal ?) de l’Art, celui de l’expression purement personnelle. Mais j’ai aussi fait allusion à la nécessité de retrouver notre Histoire qui n’est pas elle aussi étrangère à bien des recherches actuelles. La légitimité se fait aussi par les traces révélées (jazz, photo, cinéma) et la création y gagne infiniment. On verrait ainsi que la préoccupation fondamentale de l’illustration, soit le rapport créatif image/texte, a été abordé de façon surprenante par nombre d’oubliés.
2) Quand au rôle du créateur, je dirais, avec bien d’autres dessinateurs, qu’il se situe encore dans sa relation au texte. Que ce dernier soit ancien ou contemporain et quelle que soit sa forme littéraire, conte, légende, nouvelle, roman, récit… l’image se doit de lui apporter une « valeur » qui peut aller jusqu’à l’appropriation complète, le détournement, la perversion. « Tremblez, auteurs, devant l’irrespect ! ». L’image remplit alors l’une de ses missions majeures : débrider, provoque l’imaginaire du lecteur qui, sentant une distance, une liberté conquise osera prendre la sienne. C’est le pendant du désir de lire qui se mue en désir d’écrire auquel vous faisiez allusion en vous référant à Barthes. Nous refusons donc le rôle d’ornemaniste et revendiquons un statut d’ « auteur entre les lignes » jouant sur les ancrages, les sens flottants, les relais, les non-dits, au risque du pléonasme, monstre tapi qui nous guette en permanence, nous qui venons presque toujours « après ». La plupart des illustrateurs se veulent donc metteurs en scène, réalisateurs, accessoiristes, éclairagistes, décorateurs aussi… Bref un peu mégalos (ceci compensant la modestie de nos gains : il est vrai qu’on nous rabâche que c’est un sacerdoce).
3) A la question de la « Culture de masse des médias » à laquelle elle est si fâcheusement associée, l’image, dont le devoir est, redisons-le, de lancer l’imaginaire, est presque impuissante. Passées les premières années au cours desquelles elle est langage privilégié, elle devient produit qui fait subir et qui doit faire subir en un clin d’œil. Ceci explique aussi son incapacité à véhiculer autre chose que les lieux communs d’une culture au sens anthropologique du terme à laquelle vous avez fait allusion. Tout le système éducatif a donc un rôle à jouer et, effectivement, seul l’apprentissage du plaisir de la durée, de la relecture peut nous sortir de cet appauvrissement. Il ne s’agit pas tant d’enseigner une quelconque sémiologie mais de tenter de maintenir ce plaisir dans l’intimité d’une image qui aura alors à évoluer, s’enrichir pour nourrir. Si cela ne se fait pas, elle (l’image) continuera d’être, un moment, l’objet des longues fouilles et des analyses amusées du petit, puis de devenir un accessoire, une béquille du texte pour enfin glisser vers sa triste mission d’abrutissoir des masses. Tout continuera de se passer comme si, de catapulte des rêves et de la connaissance du monde puis, d’accompagnatrice du texte pour un bout de chemin, elle se suicidait pour laisser à ce dernier champ libre, lui qui ne retiendra sous ses charmes que quelques élus.
Qu’on ne s’y trompe pas, je ne dis nullement que l’image est perdue pour l’adulte : il y a un certain cinéma, une certaine BD, le peinture, la photo, mais ceux-ci sont encore plus élitaires. C’est pourquoi, Pierre Marchand, je maintiens que si l’album décline c’est très grave car c’était, c’est encore, le juste premier pas dans l’image. Ce serait plutôt l’usage qu’on fait d’elle après que me plonge dans l’incertitude. On dit du texte court, la nouvelle par exemple, qu’il est un genre difficile ; je crois que celui de l’album est encore plus difficile car il doit jouer, fifty-fifty avec l’image, un savant assaut d’escrime ou plus exactement un ballet. J’en appelle donc aux éditeurs pour qu’ils maintiennent, par-delà les crises de tous acabits, ce genre littéraire (au sens large) proprement fondamental. C’est curieusement l’un de ceux qui le connaissent et le pratiquent le mieux qui doute naïvement, à moins que ce ne soit qu’une provocation roublarde.
4) Pour ce qui est des mécanismes de la création reconnaissons qu’ils démarrent, s’appuient sur la double envie d’exprimer (ce qui relie l’illustrateur plus ou moins à l’Art) et de communiquer (ce qui nous fait tendre vers un second pôle que faute de mieux, j’appellerais l’artisanat). Ces mécanismes sont donc à la fois obscurs et simples.
Citons pêle-mêle. Pour l’obscur : le goût des symboles, le café, le tabac, des pratiques d’auto-conditionnement psychologiques voisines de celles du comédien sujet au trac qui n’excluent pas la superstition, le passage sommeil/veille, une culture souvent brouillonne rarement de type universitaire, le hasard suscité ou récupéré. Pour le simple : le professionnalisme, la volonté de faire mieux, le goût des signes, d’une rhétorique particulière (acceptée ou transgressée), pas l’appât du gain, le rapport au document ou la volonté de s’en passer, la mémoire visuelle, le plaisir des accords de tons, celui de l’organisation de l’espace, des agencements image/image, image/texte, celui de la typographie, celui du découpage, etc.
Au risque de faire long par écrit ce que je n’ai pas fait oralement et ce que je regrette, je voudrais revenir sur les quelques revendications qui font l’accord de la plupart des illustrateurs : en tout premier lieu notre volonté de nous inscrire dans une dynamique culturelle et économique et notre refus de l’assistanat et d’une forme quelconque de salariat (ce qu’un passage de l’intervention de Roland Garel aurait pu, à tort, laisser entendre). Par contre nous voulons travailler en profondeur, ne plus « torcher » des livres pour vivre et n’acceptons pas davantage ce propos fallacieux qui consiste à nous encourager dans notre vocation sacerdotale en imposant à la plupart d’entre nous un autre métier en parallèle. C’est au XIXème siècle que l’Art était sacré et l’Artiste maudit.
Ensuite, pour ceux qui commencent, il serait intéressant qu’ils puissent montrer leur travail autrement qu’à Bologne entre deux stands, ou à la va-vite chez un éditeur qui le plus souvent confie le soin de « voir » les dossiers à un cerbère incompétent. Il faudrait que les illustrateurs (et pourquoi pas les auteurs) débutants, aient, comme les plasticiens ont une aide à la première exposition, une aide au premier livre : ce pourrait être une collection expérimentale financée en partie par les éditeurs « réunis », en partie par le Ministère de la Culture, ou celui de l’Education. Collection pas nécessairement luxueuse mais accessible au plus grand nombre.
Il conviendrait aussi de permettre, outre le temps de la recherche sur les travaux en cours (ce qui est un problème temps/argent qui pourrait peut-être trouver une amorce de solution dans la réduction des gâchis à la distribution (voir l’intervention de Christiane Clerc) à des professionnels, l’expérimentation sur d’autres médias, vidéo, micro-informatique, inaccessibles aux particuliers. Je crois avoir expliqué en quoi le livre aurait à y gagner.
Enfin, il serait bon de mettre à la portée des gens du livre et du public intéressé, les moyens d’une culture spécifique : je pense en particulier à l’histoire de l’illustration (travail largement amorcé en pays anglo-saxons).
Il n’appartient pas aux illustrateurs de dire comment tout cela pourrait prendre forme, mais il n’est pas douteux que de nombreuses institutions, associations comme le CRILJ, éditeurs, Etat… et les illustrateurs eux-mêmes pourraient participer. L’idéal serait que l’image manuelle, tabulaire et médiatisée, en un mot l’illustration, soit aussi saisie dans son caractère multi-médias : publicité, presse, édition et pourquoi pas audio-visuel.
Je conclurai, très subjectivement, en chuchotant que sa préférence va quand même à cet objet parallépipédique, d’épaisseur variable où courent plein de signes noirs.
( texte paru dans le n° 19 – 15 mars 1983 – du bulletin du CRILJ )
Né à Beaune (Côte-d’Or) en 1946, Jean Claverie fait ses études à l’École nationale des Beaux-Arts de Lyon puis à l’École des Arts décoratifs de Genève. Il travaille pour la publicité puis se spécialise dans le domaine du livre pour la jeunesse. Premier album en 1977 : L’enjôleur de Hameln, aux éditions Nord-Sud. Autres titres, parmi les mieux connus : Que ma joie demeure (Gallimard, 1982), Musée blues (Gallimard, 1986), Little Lou (Gallimard, 1990). L’art des bises (Albin Michel, 1993), Le Théorème de Mamadou (Le Seuil, 2002). Jean Claverie enseigne à l’École Nationale des Beaux-Arts de Lyon et à l’École Émile Cohl. Il rencontre régulièrement ses jeunes lecteurs et, musicien au sein du quartet de blues Little Lou tour, il se produit volontiers lors de concerts pas uniquement pédagogiques. Nombreux prix et expositions personnelles dont, en 2006, une vaste rétrospective au Centre de l’illustration de Moulins. Les trois cents participants du colloque Littérature pour la jeunesse : la création en France organisé par le CRILJ, à Saint-Etienne, en 1983, se souviennent encore de son cri désormais historique : « Apprenez à connaître les gens de l’image ! »
Qui sont vraiment les lecteurs jeunes adultes ?
Compte-rendu de la rencontre du 26 juin 2012 organisée à la bibliothèque Buffon par le Centre National du Llvre et Babelio avec le soutien de la Sofia
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du cycle des huit séances sur Les pratiques des lecteur. Les prochains thèmes sont à définir et les propositions des éditeurs sont les bienvenues. Ce cycle, destiné aux éditeurs, vise à explorer les pratiques des lecteurs, en se fondant sur une enquête de lectorat menée par Babelio et sur un double éclairage professionnel et universitaire.
Trois intervenants interrogent les lecteurs jeunes adultes dans leurs pratiques de lecture, leurs modes de prescriptions, leurs modes de consommation et d’information. Qu’attendent-ils des éditeurs et des médiateurs du livre ?
. La première intervenante, Sonia de Liste-le Guillou, directrice de l’association Lecture Jeunesse et directrice de la rédaction de la revue Lecture Jeune, tente de définir cette notion de jeunes adultes avant de s’intéresser à la production éditoriale qui leur est dédiée. Elle prévient que ce concept de jeunes adultes comporte plus de questions que de réponses.
Elle aborde le sujet par une étude comparée des travaux menées par deux sociologues Olivier Galland et Cécile Van de Velde et en référence à plusieurs articles parus dans Lecture Jeune. Selon Cécile Van de Velde? la définition de l’âge adulte est en train de changer. La sociologue a effectué ses recherches comparatives sur les expériences contemporaines de l’entrée dans l’âge adulte en France, au Royaume-Uni, au Danemark et en Espagne. Pour chaque pays l’âge médian de passage à l’âge adulte est différent. Il est lié au système économique et sociologique. Si l’âge médian est en France de 23 ans, il est en Espagne de 28 ans, de 20 ans au Danemark et de 21 au Royaume Uni.
Les jeunes Français connaissent, entre 18 et 30 ans, une période d’entre-deux dont la longueur est liée aux difficultés à trouver un emploi, des prêts, un logement… Devenir adulte est devenu extrêmement subjectif. Ce n’est plus uniquement accéder à l’indépendance. C’est aussi se construire, être responsable, réussir à trouver une place, être à l’aise avec son autonomie.
Il résulte des travaux de la sociologue que devenir adulte est une perception de soi. On n’est plus dans des bases prédéfinies mais dans un processus.
Olivier Galland, lui, constate l’affaiblissement des rites de passage, l’importance de l’école comme pratiquement unique lieu de socialisation et l’affaiblissement du rôle de la famille dans le rôle de transmission. Ces jeunes qui tardent à entrer dans l’âge adulte adhérent à une culture commune, hors de la culture scolaire, à une culture nouvelle, une culture de la communication grâce aux nouveaux média. C’est ce qu’il appelle « la culture des pairs ». Le sociologue parle de socialisation horizontale.
S’il n’est pas facile de définir le passage entre les grands adolescents et les jeunes adultes, est-il plus facile de définir la littérature « Young adult » ?
Il ne s’agit pas d’un genre. On y trouve des séries et des cycles, des classiques, de la littérature populaire, des rééditions de publication de littérature générale de type littérature populaire, et une littérature éphémère avec ses univers transmédiatiques :jeux de rôle, film et une présence des éditeurs sur le net.
Ce serait davantage une littérature passerelle où la médiation joue un rôle clé. En effet, ce ne sont ni les éditeurs ni les enseignants ni les bibliothécaires ni les libraires qui influencent ce lectorat. L’essentiel de la prescription se fait par les pairs avec les réseaux sociaux, les sites, les forums.
. Guillaume Teisseire, cofondateur du réseau social du livre Babelio publie et analyse les résultats d’une étude qualitative et quantitative sur ces lecteurs jeunes adultes, administrés à près de 800 lecteurs par internet.
Ce questionnaire consistait en 30 questions fermées et 6 ouvertes. Sur une base sollicitée des 29000 membres de Babelio, 800 réponses ont été reçues émanaint à 80,5% de femmes et 19,5% d’hommes. 24% des réponses provenaient des lecteurs de 18/25 ans, 38% des lecteurs de 25/30 ans.
25% des lecteurs ayant répondu lisent un livre par semaine. Tous achètent beaucoup en ligne même si le premier lieu d’achat est la librairie. Leur accès est multicanal : librairie, bibliothèque, internet. Le segment jeune adulte est connu par les 2/3 des lecteurs Babelio qui l’associent avant tout àla SFet à la fantasy. Le lecteur « jeune adulte » est jeune, femme et bibliophage.
Les deux titres passerelles les plus citées sont Harry Potter et Twilight. Les sondés associent cette littérature aux auteurs anglo-saxons. Peu citent des auteurs. Pas d’achat sur la notoriété et donc pas de fidélité aux auteurs, ni aux collections ni même aux maisons d’édition.
Si Internet est la première source de découverte, la librairie reste juste derrière. Toutefois la prescription passe beaucoup de lecteur à lecteur par les critiques sur Babelio, les blogs, les forums.
Libraires et bibliothécaires ne savent pas où placer cette littérature car le thème, le résumé et la couverture passent avant le nom de l’auteur. La maison d’édition et la collection arrivent en dernier critère.
. La dernière intervenante est Barbara Bessat-Lelarge, directrice éditoriale de Castelmore. Elle apportera son expertise professionnelle sur les évolutions du marché du livre jeunes adultes, en tant que conceptrice de collection pour lecteurs adolescents.
L’éditrice présente Castelmore, le label de la littérature « Young adult » des éditions Bragelonne, label fondé en octobre 2010 et qui compte aujourd’hui 49 titres publiés. La meilleure vente est Vampire Academy, blockbuster vendu à 80 000 exemplaires.
Barbara Bessat-Lelarge souligne l’importance de l’objet livre lui-même pour ce lectorat très attentif à la couverture qui fait partie du champ des critiques sur le net. L‘objet est important pour les bons lecteurs comme pour les faibles lecteurs ce qui pose problème pour l’édition numérique.
Le grand format et le prix, comparables à ceux des livres des romans de la littérature pour adulte, valorisent ce type de romans. Plus pris au sérieux qu’une édition en poche.
La ligne éditoriale de Castelmore est rattachée à celle de Bragelonne par l’imaginaire avec deux critères pour les sujets abordés : parodie et paranormal.
Les héros sont des créatures qui vivent dans un monde normal mais avec des super pouvoirs. On y trouve aussi des mythes remis au goût du jour.
L’éditrice identifie trois catégories d’acheteurs :
– les 12/18 ans
– les mères qui lisent avec leurs filles,
– les jeunes adultes qui cherchent une lecture plaisir
Forte de son expérience, elle donne ensuite quelques repères qui, selon elle, caractérisent les romans Young Adult :
– La voix narrative doit être entendue avant la dixième page.
– La présentation, en début de roman, ne dépasse pas trois pages.
– On trouve souvent dans ces romans le thème de l’apprentissage.
– Les personnages doivent évoluer hors considération morale.
– Son changement et sa réflexion se font par la confrontation au monde extérieur.
– Les livres sont écrit pour fonctionner en lecture plaisir.
– Les thèmes se succèdent de collection en collection.
– Chaque nouvelle vague de parution assimile la précédente et l’enrichit.
– Avant tout cette littérature ne fonctionne qu’avec une très forte communication.
– La communication se fait par les réseaux sociaux et les sites dédiés à chaque livre.
– Les plus efficaces des media sont les blogs des lecteurs et les éditeurs prévoient des interlocuteurs qui s’y consacrent à plein temps.
– Il faut prévoir des spécimens pour les blogueurs.
– Une personne se consacre également à plein temps aux librairies.
En librairie les livres Young Adult sont souvent rangés avec mangas, les BD et la fantasy adulte. Certains titres trouvent une double implantation, au rayon jeunesse et au rayon adulte et sortent simultanément avec deux couvertures différentes. En bibliothèque ces livres sont parfois mêlés à d’autres supports (vidéos, jeux) pour un meilleur repérage dans une offre très large.
Françoise Mateu a traversé pendant plus de vingt ans plusieurs métiers du livre : libraire en librairie générale, libraire en librairie spécialisée jeunesse, fondatrice, avec Suzanne Bukiet, de la librairie L’arbre à livre largement ouverte aux cultures du monde, directrice éditoriale aux éditions Syros jeunesse puis au Seuil Jeunesse et aux éditions du Sorbier. Impliquée depuis fort longtemps, et généreusement, dans les activités du CRILJ, elle s’intéresse particulièrement aux questions de formation et il n’est pas rare de la rencontrer lors d’une journée professionnelle pour parler édition ou sur un salon du livre, assurant la médiation d’une rencontre ou d’un débat.
Les enfants, les livres, la création : premières notes rapides à propos d’un colloque
Il convient tout d’abord de saluer l’heureuse initiative du CRILJ qui, en organisant ce Colloque sur « La création en France aujourd’hui » dans la littérature pour la jeunesse, a permis que s’ouvre une réflexion devenue nécessaire sur l’un des problèmes majeurs que pose le livre aujourd’hui dans son rapport avec les enfants et les adolescents. Je suis personnellement lié au CRILJ depuis sa fondation et il faut souligner qu’avec des moyens dérisoires et le dévouement sans limite de ses membres, cet organisme est en France l’un de ceux (et ils sont peu nombreux) pour lesquels la « Littérature dite de jeunesse » doit être prise au sérieux comme un phénomène culturel marquant notre temps.
Il était à priori évident de penser que ce Colloque « déraperait » à chaque instant. Chacun des participants : auteurs, illustrateurs, éditeurs, enseignants, bibliothécaires, libraires, profitant de cette rencontre pour essayer et de se situer et de se justifier et de s’exprimer par rapport à cet univers complexe et ambigu qu’est « la littérature de jeunesse ». Ce « déballage » était nécessaire et on aurait pu souhaiter des réunions plus restreintes où chacun aurait pu donner son point de vue. Il reste que les problèmes plus spécifiquement liés à la création à proprement parler, n’ont pu être posés comme questions. Il semble donc utile de préciser à nouveau quelque uns d’entre eux pour relancer un débat qui devrait rebondir.
La création littéraire ou plastique, quelle qu’elle soit, est une activité d’une complexité infinie dans la mesure où l’écrivain au travail est quelqu’un qui construit, à partir de lui, de sa personne, de sa « culture » et presque toujours de sa solitude, une « œuvre de papier » susceptible de rencontrer d’autres solitudes, d’autres personnes, d’autres cultures, etc. Et ceci pour peupler des attentes de personnages, de lieux, de temporalités, d’émotion, d’informations, etc. Le lecteur dans cette perspective est sans conteste « l’autre créateur », nécessaire. Qui dit en effet création dans ce domaine entend implicitement ou présuppose une « recréation » par l’acte de lire et pour un enfant ou un adolescent d’un univers proposé par un adulte ne va pas sans entrainer des phénomènes d’écart. Ces écarts peuvent aussi bien conduire l’enfant au plaisir de lire quelque chose venu d’ailleurs que de lui-même, qu’à la gêne provoquée par certaines distorsions (maturité affective différente de l’adulte, complexité de syntaxe et de lexique, projection inconsciente de l’adulte comme enfant idéal, etc.). Mais ces faits concernent toute création. Et tout lecteur réinvestit à partir de lui, de son expérience de sa culture (au sens anthropologique du terme) les données multiples qu’il reçoit d’un livre : et il existe le plus souvent, et heureusement dans un sens, une distance entre ce que propose le livre et ce qu’on en fait.
Or, nombreux sont les auteurs « spécialisés » dans la littérature pour la jeunesse qui, pressentant cet écart, le comblent en jetant vers l’enfant des « passerelles » facilitantes. Il s’agit alors de créer pour « le peuple enfant » comme disait Alain. Quelques uns atteignent leur cible sans démagogie ni infantilisation puérilisante (passez-moi cette redondance) ; ils visent « l’enfant tel qu’il est » et l’atteignent sans faire les enfants, ni tenir un discours clos d’adulte. Un plus grand nombre réduisent la littérature « pour la jeunesse » à n’être qu’une création « auto-censurée », adaptée à des enfants plus imaginaires que réels, simplifiée (sous le prétexte que ce ne sont que des enfants). On s’aperçoit que très souvent, ces auteurs croyant simplifier leurs propos, les compliquent, réinventant le « français fictif » d’un grand nombre de manuels scolaires. Souvent les traducteurs des très nombreux textes étrangers proposés aux enfants de France, et qui veulent aboutir à une langue soi-disant simple, la neutralisent en fait. Or, sur le plan du lexique par exemple, l’enfant préfère les mots « précis », même s’il faut rechercher le sens, aux mots « vagues » et « passe-partout ».
Une des conséquences de ces pratiques est que le rapport entre les textes et les images est souvent faussé. Dans la plupart des cas, pour ces livres, c’est l’image qui contraint le texte à une certaine neutralité sémantique. Le texte « illustre » l’image. Ce qui est préjudiciable au fonctionnement complet de cette dernière ; elle est choisie, et le livre ou l’album avec elle, plus pour son caractère ornemental que pour sa signification.
Dans un troisième type de démarche, créer c’est écrire (ou dessiner) ce que l’on désire, « pour soi » sans viser plus particulièrement les enfants. Cette voie semble la meilleure et l’est bien souvent ; mais il faut avoir l’honnêteté de reconnaître que seules certaines œuvres ont des chances d’atteindre pleinement les enfants. Leur immaturité affective (toute relative reconnaissons-le selon les milieux socio-culturels, socio-économiques, etc.), leur capacité naturellement limitée au niveau de la perception des complexités syntaxiques et lexicales, rend pour eux, certains textes particulièrement opaques. Il me semble par ailleurs fâcheux de lire trop tôt des œuvres que l’on ne peut savourer pleinement qu’au regard d’une certaine expérience existentielle. Il ne s’agit pas ici de morale et l’occultation de certaines réalités, du sexe, du plaisir, de la souffrance, de la mort, du langage tel qu’il se parle est effectivement à condamner sans appel. Il s’agit au contraire de savoir ce que l’enfant, en fonction de sa propre « culture » vécue peut recevoir sans traumatisme inutile et sans rejet pour cause d’illisibilité (à tous les sens du terme).
Et l’on croit souvent que certaine illisibilité du texte est masquée par la lisibilité à peu près constante dit-on, des images. C’est là encore se contenter de peu ; et il faudra bien admettre que la perception des images par l’enfant nécessaire des apprentissages créatifs au terme desquels une image peut se parcourir longtemps et apporter d’autres messages que ceux résultant d’un seul caractère décoratif et/ou ornemental. Il semble pourtant que certains livres pour enfants, dans leur réussite ont entraîné de nouvelles démarches de lectures conjointes et articulées entre elles des textes et des images. Car il n’est pas exact de dire des images qu’elles sont toujours données. Comme les meilleurs textes, les bonnes images demandent des regards exigeants. Et il arrive que la lecture « textuelle » amorce ou provoque une découverte (au sens d’un dévoilement sous le regard) des images et de ce qu’elles déclenchent dans l’imaginaire. Mais ceci supposerait que l’écrivain et le graphiste soient plus étroitement associés dans la genèse des livres. Sans empiéter sur la liberté de l’un et de l’autre, il serait souvent bénéfique de les associer au départ d’une entreprise, qu’ils en discutent, etc. Ce qui se fait parfois, mais trop rarement. Ils pourraient savoir qu’elle pourrait être dans chaque cas l’organisation globale d’une démarche créatrice, savoir qui commence, l’écrivain, le graphiste, l’un et l’autre. Ils pourraient envisager les parallélismes, les redondances, les distorsions, les complémentarités entre textes et images. Et réciproquement.
On voit, par ces quelques rapides remarques que le champ de réflexion concernant le travail et les techniques propres à aider la création dans le domaine du livre de jeunesse est illimité et qu’il est nécessaire de l’explorer.
Il reste que rien ne sera fait en dehors de réflexions théoriques intéressantes et stériles si le lecteur éditorial ne réfléchit pas lui-même, en même temps que sur le côté commercial, sur la part de création qu’il assume. Il me semble, pour simplifier un vaste problème, que pour l’écrivain et le plasticien l’éditeur doit créer par la provocation, l’incitation au dépassement, la garantie donnée par lui que la fabrication, la réalisation technique du livre sera conforme à l’utopie projetée par les auteurs d’un objet futur conforme à leurs désirs. De plus, la création éditoriale n’est efficace que si elle est foisonnement, multiforme, toujours « en avant », inquiète et tranquille tout à la fois, associant dans son rayonnement les enfants, les parents, les éducateurs, les bibliothécaires, les libraires, etc.
A terme, on constate que lorsque la création est vraiment création et non reproduction, la littérature dite « de jeunesse » transforme la vision que nous avons de la littérature ; car elle contraint l’adulte à de nouveaux regards et à découvrir que la fécondité créatrice fonctionne à des niveaux qui ne sont pas ceux, où on la rangeait habituellement, d’une sous-littérature. On y découvre d’autres chefs-d’œuvre, d’autres plaisirs et souvent un formidable dynamisme novateur, qui fait de certains auteurs, de certains illustrateurs des défricheurs exigeants et lucides de l’avenir culturel ; et pas seulement de l’avenir des enfants.
L’avenir est ouvert pour peu que la littérature de jeunesse ne devienne pas le refuge de certains « ringards » déçus par leur insuccès auprès des adultes, mais la voie royale de la création des livres qui « changent la vie ».
(article paru dans le n°19 – mars 1983 – du bulletin du CRILJ)
Né en 1920 à Besançon, décédé en 2002; Georges Jean a fait des études de Lettres et de Philosophie. Il fut instituteur, puis professeur d’école normale au Mans, à l’Université du Maine et à l’Ecole Nationale Supérieure des Bibliothèques. Il est membre du mouvement d’éducation permanente Peuple et Culture. Sa pratique de la poésie, ses fonctions et ses convictions font de lui un théoricien avisé du langage et de l’imaginaire. Il publia de nombreuses anthologies pour les enfants et les jeunes dont Il était une fois la poésie (La Farandole, 1974), Le premier livre d’or des poètes (Seghers 1975), Poussières d’images (Larousse, 1986). Parmi ses essais : Pour une pédagogie de l’imaginaire (Casteman, 1976) et Le pouvoir des mots (Casterman, 1981) qui recut le Prix de la Fondation de France. A noter aussi, avec Jacques Charpentreau, un Dictionnaire des poètes et de la poésie (Gallimard, 1983).
Pourquoi j'aime Max et les maximonstres de Maurice Sendak
Max et les Maximonstres, édité aux Etats Unis en 1963, publié pour la première fois en France par Robert Delpire en 1965, déclencha les foudres des rares critiques s’intéressant à l’édition pour la jeunesse, avant que d’être publié en 1967 à l’Ecole des loisirs où il trouva la consécration que l’on sait. L’esprit de 1968 commençait à souffler sur la création et sur la critique, autorisant la prise en compte de l’inconscient dans les albums pour enfants.
J’ai découvert Max et les Maximonstres il y a presque 30 ans, alors que j’étais bibliothécaire et jeune maman d’un petit garçon terrible à qui je l’ai lu souvent. C’était la première fois que je voyais un enfant porter un costume de loup et cet enfant du livre ainsi vêtu me fascina d’emblée, car beau et terrible à la fois, comme un jeune animal sauvage.
En lisant cet album à mon fils comme à d’autres jeunes enfants j’ai souvent constaté que l’enfant à qui on lit Max et les Maximonstres pour la première fois ne manifeste pas d’enthousiasme, ne dit rien et reste songeur.
Plus tard il demandera qu’on lui relise cet album qui le trouble, et moi après toutes ces années je reste face à Max comme ces enfants, songeuse.
On ne peut revenir autrement me semble-t-il de ce voyage Where the wild things are, de cette plongée au cœur de notre intériorité.
Découvrant l’œuvre de Maurice Sendak, avec ceux de mes collègues de la Médiathèque de Metz qui partagèrent avec moi l’aventure de la revue Bouquins/Potins, j’ai lu tout ce qui était alors publié de Sendak et sur Sendak, en français comme dans la langue originale, mais cela n’empêcha pas et n’empêche toujours pas que je continue de me heurter à la force de cet album, à sa belle opacité. Je suis attirée par Max et les Maximonstres, j’aime la beauté du trait, la finesse des couleurs, la musique du texte, mais quand je prends cet album en main c’est comme si je venais de trouver au bord d’un rivage un beau galet. Je le ramasse, le regarde, le touche, le caresse, il me fascine par sa perfection plastique certes, mais aussi et surtout à cause de tout ce qu’il contient d’informations qui me restent inaccessibles car je ne connais rien à la géologie ni à la minéralogie. Pourtant, même si je ne les mets pas à jour, savoir qu’elles sont là enfermées, comme l’image dans le tapis, me donne du contentement.
Au fil du temps j’ai avancé dans ma compréhension de cet album. J’ai profité de lectures expertes qui m’ont révélé la subtilité de ce texte ô combien elliptique, l’orches-tration de ces images qui nous emmènent sans prévenir de l’autre côté du miroir. Je me suis intéressée aux yeux ouverts et aux yeux fermés de Max, à ce jeu de ses pieds dressés et de ses pieds posés qui en dit long sur sa satisfaction. Je sais tout le travail accompli par Maurice Sendak sur lui-même, pour retrouver au plus près les sensations du jeune enfant qu’il fut. Je vois bien que Max s’embarque vers l’imaginaire grâce au principe de plaisir et revient à cause du principe de réalité…
J’observe ces monstres, terribles, leurs griffes leurs cornes et leur crocs, mais ils me semblent en même temps si débonnaires. Ils me font sourire car je vois bien qu’ils font tout pour être terribles et que cette jubilation qu’ils manifestent vient de ce qu’ils jouent à faire les monstres. Ils agissent à la commande de Max, ils donnent une représentation, regardant bien leur public comme des enfants lors d’un spectacle de fin d’année et Max, qui les a convoqués, les domine totalement. Trois petits tour et puis s’en vont…
Mais les regardant à nouveau la fois suivante je m’interroge encore et encore sur ce qu’ils ont à me dire.
Chaque fois que je lis Max et les Maximonstres c’est comme si tout recommençait.
C’est comme dans une histoire d’amour. Je l’aime, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être aussi que je l’aime parce qu’il me résiste…
(juin 2012)
C’est dans le même temps que Claude André apprend à être mère de deux garçons et à connaître les livres pour enfants, C’était il y a longtemps, du temps d’une librairie qui s’appelait Le Temps des cerises et où son premier invité fut Christian Bruel qui venait de publier L’Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon. Bibliothécaire jeunesse durant quatorze ans à la Médiathèque de Metz, Claude André a activement participé à la création et au développement de la Librairie L’Autre Rive à Nancy où elle conseille au rayon jeunesse. Elle est présidente de l’Association Jeunes Lectures et donne ici ou là des formations à la littérature pour l’enfance et la jeunesse. Membre de l’Association des librairies spécialisées jeunesse, elle participe à la rédaction du magazine Citrouille comme du site www.citrouille.net. Elle quitte le métier (de libraire) à la fin du mois de novembre 2012.
La violence dans les livres pour enfants
La violence de plus en plus banale et « banalisée » dans la littérature de jeunesse, se fait l’écho de drames que connaissent des enfants dans tous les pays et dans tous les milieux, drames souvent provoqués ou évoqués par des adultes qui respectent de moins en moins la part d’innocence de l’enfance. Elle est aussi la résultante d’une écriture qui se veut actuelle, influencée par une « adultisation » qui laisse libre cours à une expression directe et forte. Cette littérature porte-t-elle atteinte à l’intégrité de l’enfance ? Problème de société crucial auquel les adultes conscients se doivent d’apporter non pas une réponse, mais des éléments de réflexion.
Le problème de la violence est une question délicate qui déstabilise souvent l’adulte, médiateur et donc éducateur, dans son choix de livres pour enfants, et cela sous l’effet d’un double regard sur ce choix : le regard qu’il porte lui-même sur la société et l’image qui en est donnée dans le livre, confronté à ce qu’il veut transmettre à son lectorat enfant ; le regard que les parents portent sur ses choix en tant que médiateur. Car ce sont plus souvent les parents qui « censurent » la lecture de leurs enfants et qui s’opposent à des choix trop audacieux.
Aucune tranche d’âge en littérature de jeunesse n’est épargnée par le phénomène, mais les lecteurs adolescents sont les plus visés : omniprésence de la littérature d’horreur ou fantastique, avec des ressorts visuels forts et un appel presque malsain à l’émotivité de chacun ; attrait de la forme et du fond qui utilisent de plus en plus les ressorts d’accroche cinématographiques d’une écriture très visuelle pour capter le lecteur et le garder, une écriture à la Stephen King.
La question de la violence dans les livres d’enfants peut donc être abordée sous deux angles d’attaque : la violence « banalisée » est-elle un bon argument littéraire ? Quelle « violence » exercée par l’auteur envers l’enfant lecteur ?
Violente la littérature ? Par rapport à qui ?
L’évolution sociale est génératrice de question parce qu’elle heurte, et que le médiateur est obligé de la véhiculer malgré lui. Pourtant il faut se garder de faire de l’angélisme : la violence est présente dans l’évolution psychologique de l’enfant (cf. les cours de récré). Celui-ci apprend très vite désormais qu’il vit dans un monde où il faut se battre pour s’en sortir. Face aux violences physiques et aux agressions morales inhérentes à ce monde, il est inévitable que la littérature de jeunesse, si elle veut être réaliste, soit l’écho de ces tendances et aide à réfléchir, à intégrer certaines données liées à la violence.
Un fait vient brouiller les cartes : les livres pour enfants sont écrits par des adultes. Il peut en résulter un phénomène divergent. Soit les auteurs sont « en deçà » de ce que vivent les enfants au quotidien par ignorance de ce qui s’y passe ou par peur de l’écrire et leurs livres manquent de réalisme dans l’expression de la quotidienneté. Soit les auteurs vont « au-delà » de ce qu’il faudrait en laissant libre cours à l’expression de leurs fantasmes adultes : ils pèchent par excès d’agressivité dans l’imaginaire fantasmagorique. Par contre, si les auteurs sont des enseignants, ils agissent en militants conscients de la façon dont cette violence peut s’exprimer au quotidien.
. La violence : un phénomène de mode ?
Une mode en littérature est l’expression d’interrogations de la société, d’un besoin plus ou moins exprimé, d’un rejet d’une chose ou d’une personne. Besoins qui sont partagés par beaucoup. La violence héritée des contes existe depuis toujours, mais elle a une vocation pédagogique. Par contre, depuis cinq à six ans, elle affiche une présence croissante sous les formes les plus diverses, et une recrudescence actuelle de l’escalade des détails forts. C’est la résultante de concordances particulières. La cloison entre littérature adulte et jeune cède : des auteurs, passant de l’une à l’autre, ignorent ou veulent ignorer les normes et tabous classiques de la littérature de jeunesse. L’environnement social épargne de moins en moins à l’enfant de l’impact incalculable de ce que véhiculent les médias. Tout ce que l’enfant prend de plein fouet dans la rue ou à la télé est présent dans la littérature de jeunesse.
Les livres pour enfants peuvent aider à réfléchir que cette violence. C’est là la justification de leur effet « caisse de résonnance ». La rémanence d’un texte s’opposant à la fugacité des images quotidiennes permet un certain recul, des retours pour analyser et expliquer.
. Quelle violence dans les livres pour enfants ?
Il y a deux types de violence en littérature : celle qui se nourrit d’imaginaire et celle qui s’appuie sur le réel. Bien que procédant d’une démarche totalement inverse, elles ne sont pas étrangères l’une à l’autre et peuvent être complémentaires.
La littérature de jeunesse semble se nourrir davantage de la violence issue du réel qu’elle ne l’a fait ces dernières années. Comme s’il fallait toujours plus d’émotions fortes proches de la réalité et du quotidien, nourries des faits divers qui s’étalent à la une des journaux, et en traduisent toutes les ambiguïtés et les images dévalorisantes de l’adulte. Ces livres peuvent servir de base à une réflexion et leurs thèmes peuvent être regroupés en plusieurs types :
– L’exclusion, le racisme et l’abus de pouvoir, thèmes les plus courants qui analysent les différents rejets que la société peut générer.
– La violence civique : guerre, terrorisme, dictature. Thèses à caractère historique ou politique qui peuvent prendre une dimension symbolique pour les héros et les lecteurs et qui ont le plus souvent besoin de déboucher sur une réflexion avec un adulte médiateur.
– L’enfance exploitée et maltraitée : affronter les conséquences terribles que ces abus provoquent sur la psychologie. Vers 13-14 ans, le ton rejoint celui de la littérature adulte. Livres douloureux difficiles à un âge où celui qui subit des abus ne peut pas encore « dire », et où les autres ont encore du mal à exprimer ce qu’ils pensent et redoutent
– La violence pathologique moderne : née aussi de l’actualité, c’est celle des tueurs fous et la manipulation des sectes. Les auteurs, entre le monde littéraire adulte et jeune, ont un talent certain pour en faire d’excellents thrillers pour lecteurs adolescents au cœur et au niveau de lecture bien accrochés.
. La violence nourrie d’imaginaire ; la peur du monstre
Historiquement, c’est la plus ancienne et aussi la plus récente en littérature de jeunesse. Elle découle d’un imaginaire débridé, à travers des personnages et des décors qui n’ont qu’un lointain rapport avec la réalité, car se situant toujours aux frontières du surnaturel. Déconnectée de la vie, elle autorise une certaine distanciation du lecteur.
Elle relève de deux types : le roman d’angoisse d’inspiration classique, et la littérature « gore », version poussée à l’extrême.
Dans la roman d’angoisse classique, hérité du XIXème siècle, cette distanciation du réel laisse toute la place à l’appréciation des qualités littéraires de l’œuvre, surtout si elle est écrite par des maîtres du genre. On peut y assimiler les albums peuplés de monstres, sorcières, ogres et autres joyeux drilles venus en droite ligne des contes de tous les temps et de tous les lieux. Ces albums ont toujours une conclusion positive, eu égard à l’âge du lecteur, et une morale intrinsèque comme dans les contes.
Le livre d’horreur représente une déviation du livre d’angoisse. Cette littérature gore fait référence à un fantastique aux marges mal définies, à des ambiances malsaines où le sang et l’agression sont élevés au rang d’argument littéraire absolu et surtout d’argument commercial envers les plus jeunes lecteurs. Ils se situent dans la lignée de ce nouvel engouement des médias pour les émissions sur le paranormal, la psychopathologique, les analyses des comportements des serial-killer dont les américains se sont fait une spécialité.
. La violence virtuelle, donc niée.
C’est peut-être le plus inquiétant, un aspect nouveau qui est venu avec le développement anarchique des consoles vidéo, des jeux sur CD-Rom et autres jeux de rôle, et dont les limites dégringolent l’escalier des tranches d’âge à toute vitesse. L’auteur y entraîne l’enfant dans un jeu et un monde irréel où, armé de pouvoirs aussi aberrants qu’agressifs, il doit combattre, vaincre, tuer pour gagner et s’en sortir « vivant virtuellement ». Cela présente un double danger : créer l’habitude de pratiquer la violence pour se sortir de toute situation malaisée ou contraignante, au risque de ne plus discerner le virtuel du réel, et d’éprouver des difficultés à revenir à la réalité, à faire la part du jeu. Nous sommes loin de l’imaginaire fantastique qui permet une distanciation du lecteur.
Mais ces « risques » ne sont-ils pas largement dépassés par les faits dont on reçoit les échos quotidiennement de la part d’adolescents en mal de vivre ?
Les enfants en viennent à se forger un nouvel imaginaire, un monde interactif et immatériel où être violent correspond à une nécessité de survie, une action sans conséquences matérielles. Car si la mort n’est plus « réelle », la violence devient virtuelle, donc « niable ». Elle devient un jeu élémentaire.
La violence : comment l’utiliser ?
Cette violence qui devient omniprésente dans la littérature jeunesse, les adultes médiateurs doivent apprendre à la gérer, voire à l’utiliser, mais ce n’est pas sans risque. Les enfants sont tous différents et sur des sujets aussi délicats, les raisons pour lesquelles ils posent des questions, leurs attentes vis-à-vis de l’adulte sont à ressentir et à gérer en fonction de chaque situation.
Il faut faire attention à l’effet « bombe à retardement » éventuelle que peut porter le livre : inciter au lieu de faire réfléchir. C’est le reproche classique qui est fait à la démarche à visée « pédagogique » de certains auteurs : en parlant de violence, comme en montrant la violence à la télé, ne risquent-ils pas de susciter l’envie de devenir violent chez l’enfant ? En certaines circonstances, un ouvrage trop ancré dans le réel peut avoir un effet pervers : inviter à regarder son voisin comme le « mauvais de l’histoire », stigmatiser les rancœurs, réveiller les bagarres et d’aboutir à l’effet inverse de celui que l’on recherche. Cela risque de transformer la bibliothèque en une sorte de prétoire où chacun, en fonction du sort des héros peut désigner un coupable, ou se sentir désigné comme tel.
Pour contourner ces écueils, il faut faire attention à des principes essentiels : éveiller l’esprit critique, apprendre au lecteur à prendre du recul. Pour que l’histoire soit crédible, le ressort de l’analyse psychologique doit être solide. Les enfants savent transposer un problème dans leur propre champ de vision et ils savent reconnaître les agressions et les problèmes d’aujourd’hui dans le récit de ceux d’hier ou d’ailleurs. Il faut néanmoins choisir judicieusement le livre et le sujet en fonction des capacités de réflexion et d’assimilation de chacun.
La violence dans les livres pour enfants pose un problème grave, celui d’une société qui porte atteinte à ses propres enfants, donc à son devenir, qui ne parvient plus à donner des modèles positifs, qui ne parvient plus à gérer l’instinct de violence chez ses enfants. Cette question angoisse les adultes médiateurs, d’autant plus que les frontières entre l’univers enfant et l’univers adulte deviennent de plus en plus poreuses. Les livres peuvent amener à réfléchir sur cette violence, et c’est en quelque sorte la seule justification de la présence prégnante de cette violence. La distanciation que propose le texte écrit s’oppose à la fugacité impressionnante des images au quotidien. Elle autorise le recul nécessaire au retour sur les choses, à l’analyse, au travail d’explication. Mais il ne faut pas oublier un fait majeur : si la violence dans les livres pour enfant est une mode montante, si ces livres sont un aspect noir de la littérature de jeunesse, ils ne représentent qu’un petit pourcentage de la production éditoriale, et il existe à côté bien d’autres livres qui parlent de la vie d’une manière plus positive, voire distrayante, et qu’il faut aussi faire connaître aux enfants en contrepartie.
Mais ce sont d’autres histoires.
(article paru dans le n°73 – juin 2002 – du bulletin du CRILJ)
D’abord enseignante, Muriel Tiberghien fut rédactrice en chef adjointe pour la partie jeunesse de la revue Notes Bibliographiques (Culture et Bibliothèques pour tous) et, à ce titre, coordinatrice du comité de lecture. Des articles toujours très documentés, des formations, des interventions et des collaborations nombreuses, notamment avec le CRILJ dont elle est administratrice.