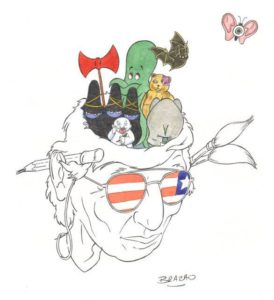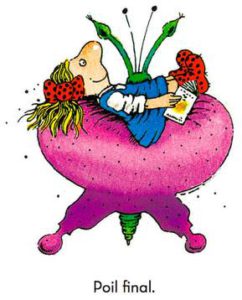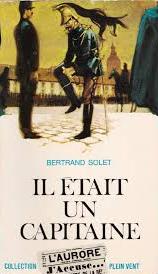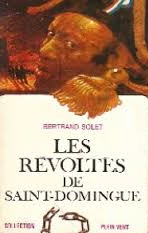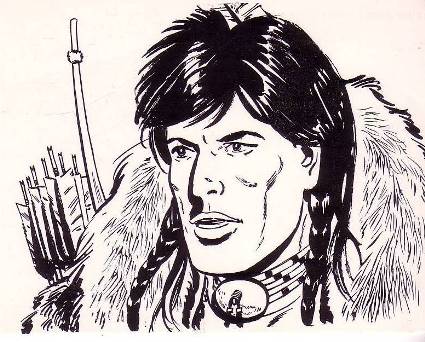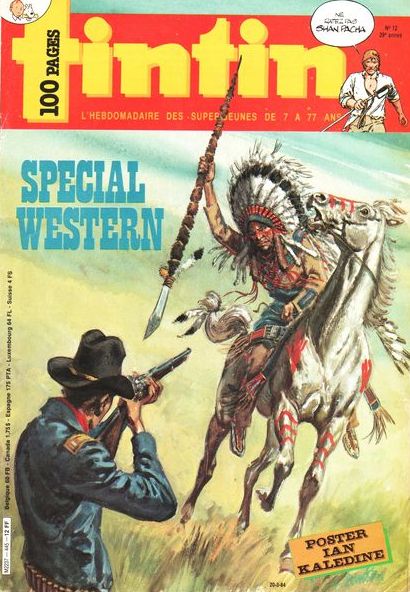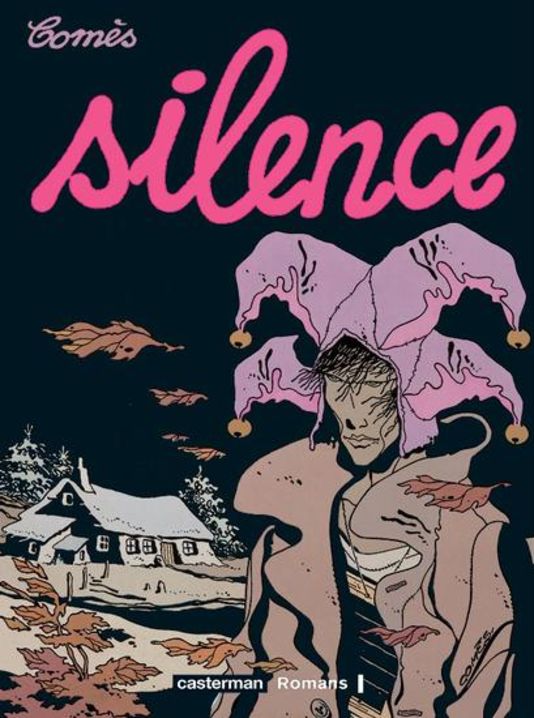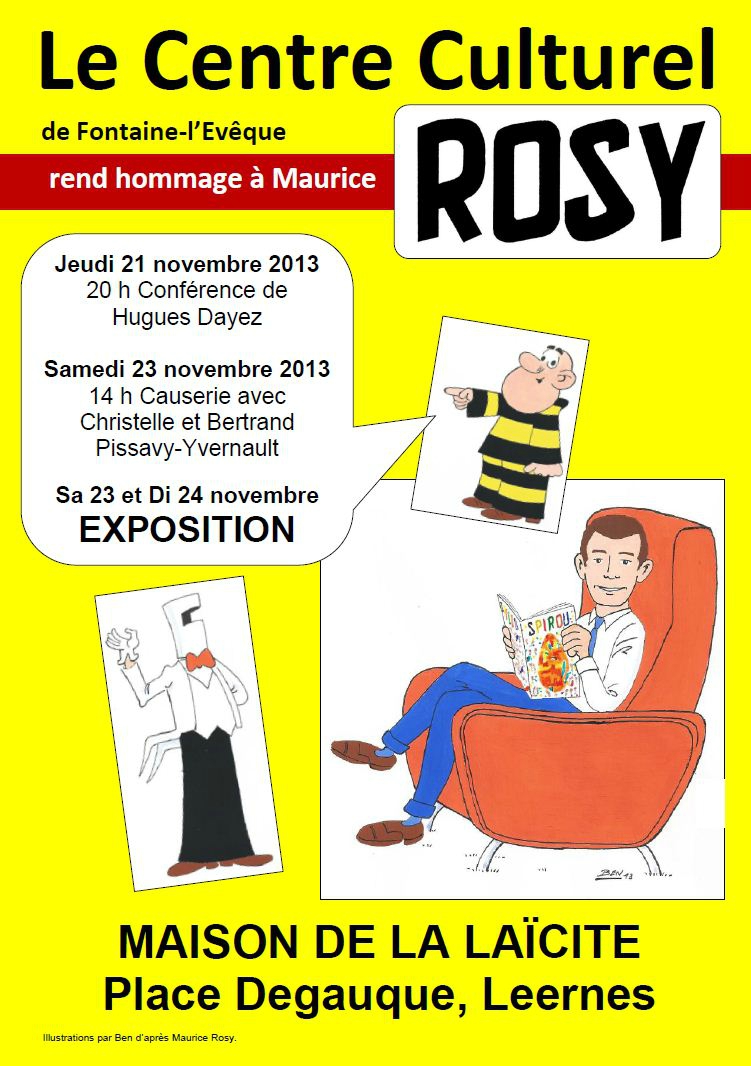a
.
« Je ne saurais situer la semaine de cette décade soixante-soixante-dix qui vit fleurir tant de merveilles dans le livre de jeunesse d’alors, mais je ne peux pas oublier comment l’arrivée en service de presse de l’album Les Trois brigands fut pour moi une sorte de sésame d’un monde narratif inégalé : tout d’un coup une maitrise éloquente du trait qui dit l’essentiel, une fonction franche de la couleur, des personnages non pas réduits mais porteurs de vérités incontournables et, pour satisfaire mon esprit en quête de poil à gratter moral, une parodie en demi-teinte des récits édifiants d’alors. Bref, l’omniprésence d’Ungerer s’imposait jusqu’à aujourd’hui. Cependant, au delà de l’étroitesse de ce jugement, mon âge avancé me conduit à travailler le souvenir d’une autre lucidité. Ungerer ne fut pas d’emblée admis unanimement. Dans les ventes de livres que nous animions les réticences familiales ne manquaient pas, voire les refus, et dans le monde des « spécialistes », j’ai le souvenir de réactions indignées à propos de la vulgarité de certaines caricatures et surtout des détails malicieusement grivois glissés ici et là, quand ce ne fut pas l’indignation virulente pour La grosse bête de monsieur Racine. Il est vrai qu’on découvrit alors Ungerer auteur de dessins érotiques, sans parler de ses pamphlets contre la guerre du Viêt Nam passés généralement sous silence. Avec les années et dans le désir d’hommage qui nous envahit, Ungerer créateur d’albums de génie est inséparable d’une œuvre protéiforme qui ne cesse de nous enseigner l’humour et la tendresse. » (Bernard Epin, enseignant, critique)
 « Jeunes parents, jeunes artistes, nous commencions à nous intéresser aux livres pour les enfants. Nous avions même l’ambition d’en faire et étions à l’affut d’ouvrages sortant des classiques aux formes compassés. Nous avions acheté Max et les Maximonstres de Maurice Sendak (1967 chez Delpire) que le libraire nous avait fortement déconseillé d’offrir à un enfant et qui faisait nos délices des lectures du soir. La découverte des Larmes de crocodile d’André François (1967 chez Delpire encore) presque un livre-jeu avec sa boite à coulisse et son format atypique. Mais le récit n’avait pas les mêmes ressorts et ne suscitait pas le même attachement. Les trois brigands de Tomi Ungerer (1968 à l’école des loisirs) nous enchantèrent tout de suite. Livre simple et direct, au style allant à l’essentiel. Sans fioriture, une histoire plus transgressive encore que Max. Contrairement aux apparences, les méchants, malgré leurs attributs, n’étaient pas de si vilains bougres. Ils s’amélioraient même pour devenir de généreux donateurs, de super éducateurs mettant garçons et filles sur un pied d’égalité (cela était rare, peut-être même inédit), rendant les orphelins si heureux, qu’adultes, les enfants restaient vivre auprès des brigands, allant jusqu’à bâtir une cité idéale coiffée de chapeaux de brigands. Nous passions par des émotions diverses : tristesse pour la pauvre orpheline, peur avec l’attaque des brigands, admiration pour le courage de la petite fille, questionnement sur la richesse puis la transformation soudaine des voleurs. Nous aimions la possibilité de lire le même récit dans l’image et dans le texte, une image décomplexée, pas jolie, pas léchée, mais fonctionnelle et efficace, au service du texte. Et une critique sociale fort bien vue. Bref, un conte moderne. Vinrent ensuite, dans la même veine, Le géant de Zéralda (1971) et Pas de baiser pour maman (1976), d’autres ensuite que je ne cite pas. Même efficacité. Même esprit caustique. Même dépouillement. Même accord entre texte et image. Merci, merci et encore merci, Monsieur Ungerer. » (Claire Nadaud, auteure et illustratrice, mère et grand-mère)
« Jeunes parents, jeunes artistes, nous commencions à nous intéresser aux livres pour les enfants. Nous avions même l’ambition d’en faire et étions à l’affut d’ouvrages sortant des classiques aux formes compassés. Nous avions acheté Max et les Maximonstres de Maurice Sendak (1967 chez Delpire) que le libraire nous avait fortement déconseillé d’offrir à un enfant et qui faisait nos délices des lectures du soir. La découverte des Larmes de crocodile d’André François (1967 chez Delpire encore) presque un livre-jeu avec sa boite à coulisse et son format atypique. Mais le récit n’avait pas les mêmes ressorts et ne suscitait pas le même attachement. Les trois brigands de Tomi Ungerer (1968 à l’école des loisirs) nous enchantèrent tout de suite. Livre simple et direct, au style allant à l’essentiel. Sans fioriture, une histoire plus transgressive encore que Max. Contrairement aux apparences, les méchants, malgré leurs attributs, n’étaient pas de si vilains bougres. Ils s’amélioraient même pour devenir de généreux donateurs, de super éducateurs mettant garçons et filles sur un pied d’égalité (cela était rare, peut-être même inédit), rendant les orphelins si heureux, qu’adultes, les enfants restaient vivre auprès des brigands, allant jusqu’à bâtir une cité idéale coiffée de chapeaux de brigands. Nous passions par des émotions diverses : tristesse pour la pauvre orpheline, peur avec l’attaque des brigands, admiration pour le courage de la petite fille, questionnement sur la richesse puis la transformation soudaine des voleurs. Nous aimions la possibilité de lire le même récit dans l’image et dans le texte, une image décomplexée, pas jolie, pas léchée, mais fonctionnelle et efficace, au service du texte. Et une critique sociale fort bien vue. Bref, un conte moderne. Vinrent ensuite, dans la même veine, Le géant de Zéralda (1971) et Pas de baiser pour maman (1976), d’autres ensuite que je ne cite pas. Même efficacité. Même esprit caustique. Même dépouillement. Même accord entre texte et image. Merci, merci et encore merci, Monsieur Ungerer. » (Claire Nadaud, auteure et illustratrice, mère et grand-mère)
« Au Festival d’Avignon pour la troisième ou quatrième fois, je raconte à ma plus qu’amie du moment les difficultés que j’ai eu à intéresser à la lecture Marc, bon élève par ailleurs, et que cela me tracasse fort. « Pas étonnant, me répond abruptement Catherine, avec ce que tu lui donnes à lire. » Et, la voici qui, stagiaire un temps chez Delpire, m’invite à fréquenter La joie de lire, librairie fondée par François Maspéro, et de pousser jusqu’à la troisième salle, au fond, tout au fond, vraiment tout au fond. Je me rends à Paris dans les premiers jours d’août et, vraiment tout au fond, dans une armoire de récupération dont le libraire a enlevé les portes, je découvre Max et les maximonstres et Les trois brigands que j’achète immédiatement. Mes souvenirs de « premières lectures » de ces deux albums sont flous. Je n’ai finalement conservé que le sentiment d’une sorte d’évidence de la narration. Max et les maximonstres et Les trois brigands : des livres simples. Des années plus tard, autant grâce aux élèves à qui je les lirait chaque année qu’à Isabelle Nières-Chevrel (pour Max), je comprendrais que, derrière l’évidence, se cachent souvent de belles profondeurs. » (André Delobel, formateur, secrétaire du CRILJ).
 « Tomi Ungerer est un des « grands » qui ont accompagné mon chemin d’illustratrice-auteure. Pas facile de trouver les bons mots. J’ai découvert Tomi avec La grosse bête de Monsieur Racine, album hilarant, inoubliable. Et puis j’ai apprécié ses affiches, ses dessins de presse, ses drôles de sculptures. Une grande exposition en 1981, aux Musée des Arts Décoratifs, à Paris, m’avait donné accès à son monde. Son livre Nos années de boucherie, récit de son expérience de vie autonome en Irlande continue de m’impressionner. Je sais ce que je dois à ses dessins et à ses histoires. Ses dessins-collages m’enchantent. Ses audaces, son humour, sa curiosité et sa malice nous accompagnent tous. Tomi Ungerer est, au fil des pages, un puissant exemple de liberté. » (Martine Bourre, auteure, illustratrice)
« Tomi Ungerer est un des « grands » qui ont accompagné mon chemin d’illustratrice-auteure. Pas facile de trouver les bons mots. J’ai découvert Tomi avec La grosse bête de Monsieur Racine, album hilarant, inoubliable. Et puis j’ai apprécié ses affiches, ses dessins de presse, ses drôles de sculptures. Une grande exposition en 1981, aux Musée des Arts Décoratifs, à Paris, m’avait donné accès à son monde. Son livre Nos années de boucherie, récit de son expérience de vie autonome en Irlande continue de m’impressionner. Je sais ce que je dois à ses dessins et à ses histoires. Ses dessins-collages m’enchantent. Ses audaces, son humour, sa curiosité et sa malice nous accompagnent tous. Tomi Ungerer est, au fil des pages, un puissant exemple de liberté. » (Martine Bourre, auteure, illustratrice)
« Partir d’une image pour tirer le fil, révéler un contexte historique et éclairer une œuvre : les six affiches de Tomi Ungerer pour l’Electric Circus (1969). Situé dans cette partie de Manhattan que l’on n’appelait alors pas encore l’East Village, l’Electric Circus était en 1967 la dernière mue de ce qui avait été un restaurant polonais, un club pour immigrés allemands mélomanes, une salle polyvalente de quartier et finalement un club à la mode. « Avec des peintures phosphorescentes, des canapés, des projecteurs, l’endroit représenta, jusqu’à sa fermeture en 1971, l’apogée d’une certaine culture psychédélique new-yorkaise marquée par les premiers concerts-performances du Velvet Underground sous la houlette d’Andy Warhol. C’est au cabinet Chermayeff et Geismar que fut demandé, en 1967 et par le nouveau locataire, de développer une identité visuelle pour le lieu. Le duo de designers, composé d’Ivan Chermayeff (oui, l’ami des Trois Ourses) et Tom Geismar opta pour l’usage intensif d’une de leur polices de caractère intitulée Electus. Radicales, leurs premières annonces pour l’Electric Circus ne comportaient que du texte, composé dans cette vibrante typographie, elle-même inspirée d’une pochette réalisée par leur ex-collaborateur Robert Brownjohn pour l’album Vibrations d’Enoch Light. Une nouvelle série d’affiches fut produite en 1969, six affiches pour être précis, qui cette fois faisaient la part belle aux dessins de Tomi Ungerer, par ailleurs ami d’Ivan Chermayeff. On y retrouve l’esprit du Fornicon (recueil de dessins sur le thème de la sexualité paru à compte d’auteur la même année) adoucis par l’humour absurde et bon enfant dont il savait faire preuve dans ses images publicitaires. Nous savons aujourd’hui que la publication du Fornicon, qui fut accompagné d’une exposition d’originaux sur la Cinquième Avenue, est à l’origine du contentieux entre Tomi Ungerer et les bibliothécaires étasuniennes qui éclata précisément en 1970 lors d’une convention. Questionné sur cette partie plus délicate de son œuvre il déclara publiquement à son interlocutrice: « If people didn’t fuck, you wouldn’t have any children, and without children you would be out of work ». S’en suivirent en quelques années un départ définitif de New York où il vivait depuis 1956 ainsi qu’un arrêt de près d’un quart de siècle de sa carrière d’auteur de livres pour enfants. À l’Electric Circus, ce n’est pas un contentieux mais une bombe qui éclata un soir de mars 1970. Ce geste opéré par un proche du Black Panther Party précipita le déclin du club qui fermerait définitivement ses portes l’année suivante. Fin de l’innocence, fin d’une époque. » (Loic Boyer, graphiste, directeur de collection) « Deux souvenirs. Le premier, lors des journées du patrimoine sur le thème de l’enfance, une journée d’études nationale avait été organisée à Annecy, avec, en invité d’honneur, pour introduire la journée, Tomi Ungerer. Nous étions plutôt intimidés par la présence de ce grand artiste, réputé provocateur. Je me souviens de sa magnifique envolée lyrique autour du terme de patrimoine qu’il refusait au profit de celui de matrimoine ! On était en 2001 et personne ne revendiquait encore ce terme. L’autre souvenir n’est pas daté. L’hôtel dans lequel il résidait souvent à Paris était situé très près de l’Heure Joyeuse. Un après-midi, il a tout simplement poussé la porte et nous avons passé une magnifique après-midi au Fonds patrimonial à rigoler. Il était très en verve et sortait aphorisme sur aphorisme. Un impromptu improbable et inoubliable. » (Viviane Ezratty, conservatrice des bibliothèques, vice-présidente du CRILJ)
« Deux souvenirs. Le premier, lors des journées du patrimoine sur le thème de l’enfance, une journée d’études nationale avait été organisée à Annecy, avec, en invité d’honneur, pour introduire la journée, Tomi Ungerer. Nous étions plutôt intimidés par la présence de ce grand artiste, réputé provocateur. Je me souviens de sa magnifique envolée lyrique autour du terme de patrimoine qu’il refusait au profit de celui de matrimoine ! On était en 2001 et personne ne revendiquait encore ce terme. L’autre souvenir n’est pas daté. L’hôtel dans lequel il résidait souvent à Paris était situé très près de l’Heure Joyeuse. Un après-midi, il a tout simplement poussé la porte et nous avons passé une magnifique après-midi au Fonds patrimonial à rigoler. Il était très en verve et sortait aphorisme sur aphorisme. Un impromptu improbable et inoubliable. » (Viviane Ezratty, conservatrice des bibliothèques, vice-présidente du CRILJ)
« Tomi Ungerer n’est jamais venu à Moulins. Nous l’y espérions, en 2017, pour la Biennale des illustrateurs et pour la rétrospective de son travail que nous avions préparée avec le musée éponyme de Strasbourg. Nos atouts patrimoniaux étaient sûrs. Nous avons ici un retable, celui du Maitre de Moulins. Et nous savions que celui d’Issenheim avait été la plus grande révélation artistique de sa vie. Nous avions aussi des arguments, comme une réception, un discours, une médaille, comme autant d’insignes et d’honneurs rendus au grand homme, illustrations de la reconnaissance par le politique de ce génie qui aura réussi, selon sa définition du bonheur, à éblouir l’éphémère. Mais Tomi se faisait désirer. Il y avait la grande Buchmesse de Francfort au même moment. Et il y avait aussi, ici, en dépit de l’envie réjouissante d’accueillir un talent de la sorte, un brin d’appréhension. L’artiste était redouté pour le mouvement de ses humeurs, voire la mécanique de ses pulsions. Ses dessins acides, ses bons mots, tout le terreau fantasmagorique riche d’absurde et d’obsessions ne manquait pas d’inquiéter. Nous attendions le génie autant que nous redoutions une farce à sa façon. C’est que Tomi avait une réputation à décimer les puritains, à compromettre l’établi, à troubler l’establishment. Certains prétendaient qu’il pouvait disposer sur le pommeau de sa canne une sonnette de vélo et la faire retentir si les officiels trainaient sur les discours. D’autres évoquaient même la possibilité d’un Heidi Heido, chanson à boire grivoise aux troubles associations, qu’il a joliment illustrée, et qu’il entamait alors avec passion pour perturber l’auditoire. Tomi n’est pas venu. Nous n’aurons pas parlé poésie. C’est qu’il connaissait Verlaine, Prévert, Queneau, Desnos. Ni du Larousse illustré dont il aimait, enfant, copier les planches. Tomi n’est pas venu. Je n’ai donc pas vu celui dont un de ses professeurs du lycée Bartoldi soulignait « l’originalité perverse et subversive ». Mais aujourd’hui qu’il n’est plus, je ne me sens pas orpheline pour autant. Pour ma part, j’ai Jean de la lune et Monsieur Racine qui m’accompagnent pour déjouer la comédie d’ici-bas. Ni soumission, ni compromission. Merci Tomi ! » (Emmanuelle Martinat-Dupré, responsable scientifique du mij, musée de l’illustration jeunesse de Moulins)
. Lu dans Les Dernières nouvelles d’Alsace du jeudi 14 février 2019 :
L’Alsace rendra, le vendredi 15 février, un dernier hommage à Tomi Ungerer en la cathédrale de Strasbourg qu’il a si souvent dessinée. La cérémonie religieuse, œcuménique et au caractère international puisqu’elle se déroulera en quatre langues, débutera à 10 heures. Elle sera présidée par l’archevêque de Strasbourg, Mgr Luc Ravel. Un double prêche sera prononcé, d’abord par le pasteur Christian Krieger, en allemand, puis par l’archiprêtre de la cathédrale Michel Wackenheim en trois langues : français, allemand et alsacien. Le maire de Strasbourg Roland Ries prendra lui aussi la parole à l’issue de ce moment de recueillement pour rendre hommage à l’artiste décédé dans la nuit de vendredi à samedi derniers. Cette cérémonie sera aussi musicale. Elle sera ouverte par Mein Ruheplatz, chanté par la cantatrice Astrid Ruff, un chant yiddish qu’aimait beaucoup Tomi. Conformément aux dernières volontés de Tomi Ungerer, Roger Siffer interprétera quant à lui trois chansons devenues emblématiques : Ich hatt’einen Kameraden, O Strassburg et l’incontournable Die Gedanken sind frei. Les obsèques du dessinateur se sont déroulées mardi en Irlande en l’église de Saint Brendan de Bantry. À l’issue de la cérémonie, suivie d’une crémation dans l’intimité familiale, ses cendres devaient être partagées entre l’Irlande et Strasbourg.
Illustrations signées : Tomi Ungerer, Fabienne Legrand, Tomi Ungerer, Olivier Brazao, Joëlle Jolivet.