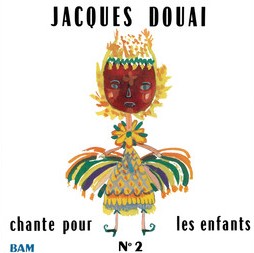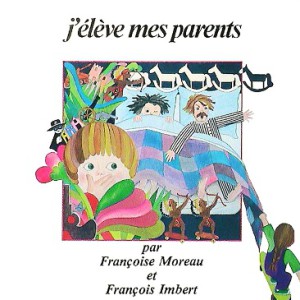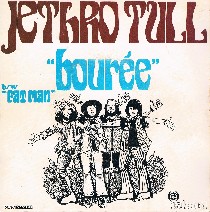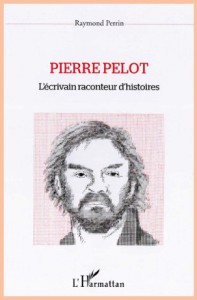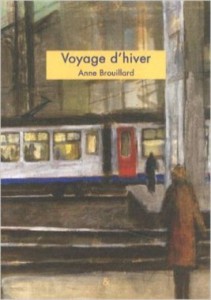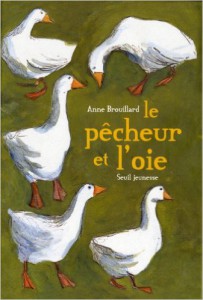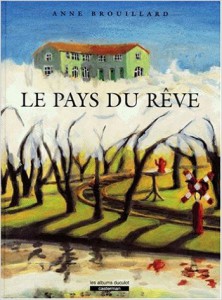Au revoir Bertrand Solet
par André Delobel
Bertrand Solet vient de décéder. Il venait chaque année nous saluer à Montreuil et, cette année, il n’était pas venu. De son vrai nom Bertrand Soletchnik, il était né en 1933, à Paris, dans une famille d’émigrés russes. Durant la Seconde Guerre mondiale, en zone libre avec ses parents, il attrapa – quel mot ! – une maladie que l’on connaissait mal et que l’on soignait difficilement à l’époque, la poliomyélite. C’est durant cette période de maladie qu’il attrapa aussi le virus de la lecture.
Après la guerre, orphelin, élevé et soigné par une tante, il prépare l’IDHEC. L’arrivée massive du cinéma américain qui faillit couler le cinéma français l’incite à changer d’orientation. Il suit les cours du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Un temps journalisme, il entre dans une entreprise de commerce international et devient responsable du service de documentation économique, travail qui le fait beaucoup voyager.
Il écrit pour la jeunesse, à compter des années 1970, des romans le plus souvent historiques (Il était un capitaine, Robert Laffont, 1971, Prix Jean Macé, Les révoltés de la Saint-Domingue, 1980, En Égypte avec Bonaparte, 1988, Compagnons de Mandrin, 1990) ou traitant de sujets liés à l’actualité ou peu souvent traités comme le racisme, l’immigration, la vie des Tsiganes (La flûte tsigane, Flammarion, 1982). Il écrit également des recueils de contes (Contes traditionnels d’Auvergne, Milan, 1994, Contes traditionnels de Russie, Milan, 2002). Ouvrage récent : Le Chambon-sur-Lignon : le silence de la montagne (Oskar jeunesse, 2016).
Ecrivain « pédagogue », auteur de plus de 120 ouvrages à l’écriture efficace, Bertrand Solet aura fait connaitre aux jeunes lecteurs des pans entiers de l’Histoire et, assez souvent, d’une Histoire pas enseignée à l’école. Il les aura aussi, offrant de solides fictions, fait réfléchir à quelques unes des questions qui empoisonnent le monde.
Membre de la Société des Gens de Lettres, de la Maison des Écrivains et fidèle de la Charte des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse qu’il a contribué à mettre sur pied, la première réunion de réflexion s’étant tenu, en 1976, à son initiative et à celle de la conseillère municipale à la culture, à la bibliothèque de Montreuil.
Il avait en 2003, publié au Sorbier un bel essai : Le roman historique : invention ou vérité ?
En 2005, un numéro de la revue Griffon lui est consacré.
« Bertrand Solet désigne quelque injustice à combattre, une nouvelle cause à défendre, des chaînes d’esclaves qu’il faut aller briser. Sa fameuse canne balaie l’horizon : là bas, il y a une terre où les hommes vivent libres et égaux. » (Marcelino Truong).
André Delobel est secrétaire de la section de l’Orléanais du CRILJ depuis plus de trente-cinq ans et secrétaire général au plan national depuis 2009 ; co-auteur avec Emmanuel Virton de Travailler avec des écrivains (Hachette, 1995), au comité de rédaction de la revue Griffon jusqu’à ce que la publication disparaisse fin 2013, il assura, pendant quatorze ans, la continuité de la rubrique hebdomadaire « Lire à belles dents » publiée dans le quotidien La République du Centre ; articles récents : « Promouvoir la littérature de jeunesse : les petits cailloux blancs du bénévolat » dans le numéro 36 des Cahiers Robinson (2014) et « Les cheminements d’Ernesto » dans le numéro 6 des Cahiers du CRILJ consacré au théâtre jeune public (2014) ; contribution au catalogue Dans les coulisses de l’album : 50 ans d’illustration pour la jeunesse, 1965-2015 (CRILJ, 2015).
.
Il fait froid
par Rolande Causse
Ce froid mois de février 2017, Bertrand Solet nous a quitté.
Non. Pour ceux qui l’ont connu demeure sa voix chaleureuse et grave. Ses mots coulaient comme une rivière serpentant à travers un paysage lumineux.
Bertrand Solet est associé aux commencements de la littérature de jeunesse et à la Charte où il vint assez rapidement.
Suffocant d’enfances de tous pays, il représente une vie d’observations, de recherches, d’imagination, de compréhension et d’émotions.
L’ont accompagnées des montagnes de mots et de métaphores dans ses livres éblouis de soleils lointains, d’oiseaux des mers, de songes, et de poésie.
Historien et géographe, derrière ses mots, il y avait l’accent des voyages, un regard révolté mais bienveillant, une douceur profonde et une générosité qu’il semait à tous les vents.
. Ami des jeunes, il leur parlait de rebellions, de résistances, des conflits du monde et du triomphe des plus humbles.
En ethnologue, il savait prendre son temps, tout en ayant une créativité extrême.
N’a-t-il pas écrit cent-vingt livres ?
Pour les siens, pour la mémoire de Bertrand, pour toutes les générations, il faudrait rassembler ses meilleurs romans et créer un Bouquin ou un Quarto (comme les collections du même nom chez Laffont et Gallimard) où figureraient ses titres les plus forts : Les révoltés de Saint Domingue, Il était un capitaine…
Ainsi il demeurerait parmi nous.
Mais je ne peux oublier Monique, son épouse, à qui j’adresse mes pensées les plus affectueuses.
Rolande Causse, écrivaine et formatrice, auteur de poèmes, d’albums, de romans, de livrets d’opéra ; fondatrice en 1975 de La Scribure, association qui se consacre à la pratique des ateliers de lecture-écriture et à la promotion de la littérature pour la jeunesse ; c’est Rolande Causse qui, en 1984, organisa le (premier) Festival Livres Enfants-Jeunes de Montreuil ; parmi ses ouvrages pour les enfants et les jeunes : Mère absente fille tourmente (Gallimard, 1983), Rouge Braise (Gallimard, 1985), Les enfants d’Izieu (Le Seuil, 1989), Le Petit Marcel Proust (Gallimard, 2005), 20 ans pour devenir… Martin Luther King et 20 ans pour devenir… Nelson Mandela (Oskar, 2016) ; pour les médiateurs : La Scribure (Buchet-Chastel, 1983), Le guide des meilleurs livres pour enfants (Calmann-Lévy, 1986), Qui a lu petit, lira grand (Plon, 2000), Qui lit petit lit toute sa vie (Albin Michel, 2005).