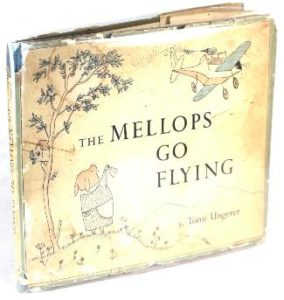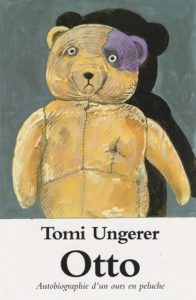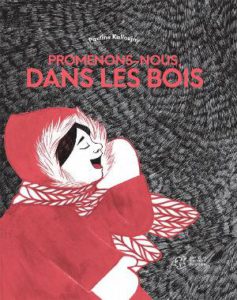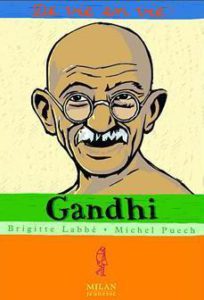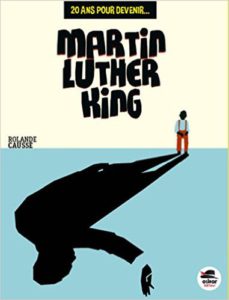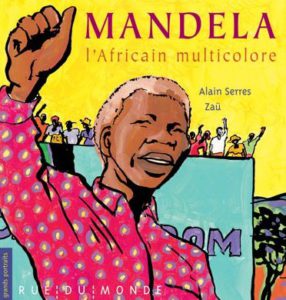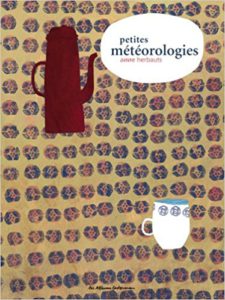Parcours dans l’œuvre de Tomi Ungerer avec Thérèse Willer
par Martine Abadia
Après une introduction d’Anne-Laure Cognet, médiatrice, pour excuser l’absence de Tomi Ungerer, la parole est donnée à Thérèse Willer, auteure d’une thèse sur l’auteur-illustrateur parue aux éditions du Rocher et conservatrice du musée qui lui est consacré à Strasbourg, musée qui a aussi vocation de Centre international de l’illustration.
L’article suivant croise les propos de la conférence de Thérèse Willer lors de la journée professionnelle de la Biennale des Illustrateurs à Moulins (Allier), le vendredi 29 septembre 2017, avec des extraits d’interviews contenus dans le film documentaire Tomi Ungerer, l’esprit frappeur de Brad Bernstein, dans le numéro spécial de la revue ZUT ! ainsi que dans divers articles qui lui ont été consacrés.
Tomi Ungerer, né en 1931, est l’auteur d’une production graphique à la fois très abondante (30 à 40 000 œuvres) et très diversifiée (ouvrages pour la jeunesse, publicité, dessins satiriques, érotiques et d’observation).
Son œuvre s’articule autour de quatre grandes périodes qui sont corrélées très étroitement à ses déménagements : la période alsacienne jusqu’en 1956, la période américaine de 1956 à 1971, la période canadienne de 1971 à 1976, la période irlandaise à partir de 1976.
Dans un de ses entretiens à Philippe Schweyer, Tomi Ungerer dit : « J’ai passé les quatre premières décennies de ma vie à courir de lieu en lieu. Depuis mon retour en Europe, j’exécute un continuel mouvement de balancier entre l’Alsace où j’ai mes racines et l’Irlande où j’ai mon feuillage. » (1)
Nourri par cette âme vagabonde et marqué par les années de guerre de son enfance, Tomi Ungerer refuse les frontières : « Je n’aimerais pas être rangé dans une case, cela vient de mes origines alsaciennes. Suis-je allemand ? Suis-je français ? Non, je suis alsacien. Suis-je New-Yorkais ? Suis-je Irlandais ? Tout doit être relativisé. »
Dès la fin des années 60, Tomi Ungerer a souhaité partager son œuvre avec un large public en la confiant d’abord à Philadelphie et à l’Université de Minneapolis, puis, bien sûr, en 2007, au Musée de Strasbourg , qui dispose aujourd’hui d’un ensemble de près de 10000 dessins très représentatifs de l’évolution de son œuvre et de 6000 jouets provenant de la collection personnelle de l’artiste.
Thérèse Willer articule son intervention autour de trois axes : les divers genres graphiques de l’œuvre de Tomi Ungerer, les différents thèmes qui traversent cette œuvre, les échos graphiques et plastiques, les connexions avec l’histoire de l’art
- Les divers genres graphiques
Ou plutôt les différentes facettes d’un même talent, facettes qui s’imbriquent et sont menées parallèlement tout au long de son évolution créatrice. Il semble important aussi de préciser à quel point la vie personnelle de Tomi Ungerer, les périodes noires qu’il a traversées dans son enfance et sa migration aux USA ont influencé sa création. Dans un interview, Tomi Ungerer dit que « s’il n’avait pas perdu son père très tôt [à l’âge de 4 ans], on ne l’aurait jamais laissé devenir artiste. » (2)
Tomi Ungerer est né en Alsace dans une famille d’horlogers ; son enfance a été marquée par la seconde guerre mondiale, l’occupation puis la libération, la libération dont il dit lui-même qu’elle lui a apporté tant de frustrations et de désillusions qu’elle provoqua en grand partie sa migration vers les USA en 1956. « Le retour des Français reste encore pour moi la plus grande désillusion de ma vie. J’y ai laissé mon innocence et j’y ai trouvé mon arrogance d’alsacien. » (3) Ces expériences ont sans nul doute forgé son caractère, sa singularité et son anticonformisme. (4)
a) Le dessin pour enfants
Cette partie de son œuvre comprend 70 titres, traduits pour la plupart en 30 langues. La grande majorité de ses albums ont été publiés en France, mais parfois 20 ou 30 ans après leur parution initiale aux USA. Le début de sa carrière est corrélée à sa rencontre avec Ursula Nordström des éditions Harper § Row, chez qui paraîtront tous les albums de sa période américaine.
En 1957, parution de Les Mellops font de l’avion, premier volume de la série « Les Mellops », famille de petits cochons à qui il arrive des aventures toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Le succès immédiat du premier titre et les nombreux prix qu’il reçoit aux USA engagent Tomi Ungerer à publier quatre autres titres.
A la suite de ce succès, entre 1958 et 1961, paraissent quatre autres titres : Rufus, Orlando, Crictor et Adelaïde.
En 1961, Tomi Ungerer se fait vraiment connaître lors de la parution de l’album Les trois brigands. Cet album surprend mais aussi séduit le public pour son style caricatural, son trait synthétique, ses formes au style japonisant et son propos.
Entre 1966 et 1971, Tomi Ungerer s’engage dans la voie de la satire et de la lutte contre l’intolérance. Cet engagement s’illustre surtout dans le domaine de la publicité mais aussi dans le domaine du dessin pour la jeunesse. Durant cette période, paraissent plusieurs titres : Jean de la lune et Guillaume, l’apprenti sorcier, en 1966, Le géant de Zéralda, en 1967.
Selon Tomi Ungerer, Jean de la Lune est l’éternelle histoire de l’intrus, différent des autres. Ce conte dénonce l’injustice et l’intolérance. Il est aussi profondément antimilitariste et s’inscrit pleinement dans une critique de la guerre du Vietnam
Pour Guillaume, l’apprenti sorcier et pour Le géant de Zéralda, Tomi Ungerer dit vouloir confronter l’enfant lecteur au sentiment de peur ; il estime que l’enfant doit avoir ressenti cette sensation, fréquemment rencontrée dans la vie réelle, pour grandir et ne doit pas être cantonné, sous prétexte de son statut d’enfant, dans un monde ultra-protecteur et hypocrite. Il faut noter aussi que L’apprenti sorcier est initialement un poème de Goethe, doté d’une morale universelle et compréhensible par tous : ne jamais prendre une place qui ne nous appartient pas, sans formation. Ces deux ouvrages fourmillent de détails, de références culturelles, proposent des fins ouvertes et nous invitent à des relectures multiples ; saisit-on, par exemple, dans Le Géant de Zéralda, lors d’une première lecture, tout le sens de la dernière illustration ?
Au fil des années, alors qu’il arrive au faîte de sa réussite, autant dans l’illustration jeunesse que dans les autres productions graphiques (cartoons, publicité), Tomi Ungerer critique de manière de plus en plus virulente la politique américaine : guerre du Vietnam, ségrégation raciale, hypocrisie et superficialité des rapports humains. Il s’autorise de plus en plus de liberté, y compris dans les ouvrages de jeunesse :
– Le chapeau Volant, en 1970, met en scène un vétéran de guerre mutilé qui, grâce à son chapeau volant, va accéder à la fortune et au bonheur. Dans ce conte, Tomi Ungerer introduit la satire sociale en dénonçant injustice, misère et marginalisation.
– La grosse bête de Monsieur Racine, en 1971, se caractérise aussi par son esprit satirique et caustique. D’un comique grotesque, certains dessins rappellent les scènes de Dubout, parfois aux limites licencieuses.
– Papaski, en 1971, privilégie l’élément de l’absurde sous la forme de fables sans fil conducteur apparent. Elles ont en commun toutefois de constituer une critique virulente de la société de consommation par l’utilisation d’un humour sardonique et l’utilisation du motif du jouet détourné de sa fonction première.
– Dans Pas de baiser pour maman, en 1973, il choisit l’illustration à la mine de plomb et le personnage d’un chaton pour exorciser son enfance. Cet ouvrage a déchaîné les critiques aux USA car Ungerer y avait introduit une scène représentant une table de petit déjeuner avec une bouteille de schnaps.
– Allumette, en 1974, constitue son dernier ouvrage, avant 20 ans de silence, en termes de parution jeunesse. Fortement inspiré du conte d’Andersen, ce livre met en scène une héroïne vivant dans un monde industrialisé. Il constitue une satire de la déshumanisation, liée à ce qu’il qualifie de dérive sociétale.
Son humour corrosif, la parution de ses dessins érotiques et sa vision sans concession de la société américaine vont lui attirer les foudres de la presse et de la société civile. En 1971, il quitte les USA pour la Nouvelle Ecosse, au Canada, puis, quelques années plus tard, s’installe avec sa femme Yvonne en Irlande où il vit toujours.
Après une interruption de plus de 20 ans, paraissent à partir de 1997, plusieurs titres pour la jeunesse : Flix, en 1997. Tremolo, en 1998, Otto, autobiographie d’un ours en peluche, en 1999.
Ces trois ouvrages, d’abord parus chez l’éditeur suisse Diogènes-Verlag, paraîtront ensuite à l’école des Loisirs qui, aujourd’hui, propose l’ensemble de son œuvre pour la jeunesse.
Les albums Le nuage bleu, en 2000, Amis-Amies, en 2007, et Zloty, en 2009, ont en commun de prôner l’amitié et la solidarité comme vecteurs des relations humaines et moyens de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. On y retrouve aussi le goût de Tomi Ungerer pour la musique et les arts.
En 2013, est édité Le Maître des Brumes. Dans cet ouvrage plus apaisé, Tomi Ungerer rend hommage, de merveilleuse façon, à cette belle terre d’Irlande, pays de brume, de brouillard et de mer, où il réside depuis plus de 30 ans.
« Si j’ai conçu des livres d’enfants, dit Tomi Ungerer, c’était d’une part pour amuser l’enfant que je suis, et d’autre part, pour choquer, pour faire sauter à la dynamite les tabous, mettre les normes à l’envers : brigands et ogres convertis, animaux de réputation contestable réhabilités… Ce sont des livres subversifs, néanmoins positifs ».
b) Les dessins publicitaires
Dans un entretien accordé à son éditeur Diogènes Verlag en 1994 (5), à l’occasion d’une rétrospective de son travail d’affichiste, Tomi Ungerer dit : « L’affiche est pour moi la reine des médias. Par son format, elle se laisse voir de loin, elle ne bouge pas, on a le temps de la déguster. Et pourtant, il faut qu’elle accroche, qu’elle mette le grappin sur le regard du passant pressé ou de l’automobiliste stressé. » Plus loin, il ajoute : « A New York, dans les années 60, j’ai vécu l’âge d’or de la publicité. New York, ville libre, où tout alors était concevable… Depuis, les esprits ouverts se sont refermés – ou hélas – nous ont quittés. Certaines [affiches] ont causé des remous ou des protestations, surtout par les féministes et les ligues de vertu ! Mon esprit provocateur est alors comblé, stimulé par les tollés. »
Sa première affiche pour la papeterie Schwindenhammer en 1954, « Il n’avait pas… un cahier Corona », se caractérise par un trait stylisé et une composition structurée par des diagonales ; il joue sur l’effet de surprise provoquée par une situation inattendue : un écolier est mis au coin, un bonnet d’âne en guise de tête, – parce qu’il n’avait pas de cahier Corona…
Dès 1957, Tomi Ungerer démarre véritablement sa carrière de dessinateur publicitaire, profitant du contexte très favorable des années soixante pour la publicité, mais aussi de l’explosion de la société de consommation. Les agences de publicité américaines se sont en effet très vite enthousiasmées pour ce jeune créateur plein de talent dont les affiches alliaient causticité et créativité. Toutefois, beaucoup de ses projets restent inédits car jugés trop subversifs.
C’est la campagne publicitaire qui lui est confiée par Le New York Times en 1960 qui le rend célèbre : une série de 24 immenses affiches sont placardées dans le métro newyorkais et ont pour vocation de créer un choc visuel par l’emploi de couleurs vives en contraste avec le noir, par le jeu entre la typographie et l’image et les situations incongrues qu’elles mettent en scène.
Plus tard, en 1968, il utilisera un slogan frappeur « Expect the unexpected », que l’on peut traduire par « S’attendre à l’inattendu », dans l’affiche publicitaire pour The Village Voice.
Et, parallèlement, en 1967, il est sollicité pour l’ouverture du complexe de boutiques Truc avec un slogan, « Truc est plus étrange que la fiction », qui est une forme de réinterprétation de la mythologique licorne qui ne se laisse approcher que par des vierges. Ici, Tomi Ungerer représente une femme nue, peut-être de petite vertu du fait de ses bas rouges, qui contrairement à la légende, réussit à traire l’animal mythique.
Le support de l’affiche est aussi un moyen pour Tomi Ungerer d’exprimer ses opinions sur la politique américaine des années 60. Dans « Black Power/White Power », en concevant son dessin comme une carte à jouer qu’on peut retourner, il pose la question de la responsabilité des deux camps à propos de la discrimination raciale. Dans « Choice, not chance », il exprime, de manière cruelle et dramatique, son profond antimilitarisme.
A partir des années 70, son style évolue. Il attache de plus en plus de place au jeu de mots et à l’association d’idées. Ainsi, en 1975, il réalise une série d’affiches pour l’imprimerie Siegwerk dans laquelle il décline le thème de l’arc en ciel. Avec le slogan « L’arc en ciel réveille la fantaisie de façon formidable », il joue sur le double sens en allemand du mot « ungeheuer » qui signifie au sens propre « monstrueux » et au sens figuré « formidable » : il l’illustre par le monstre du Loch Ness qui est chevauché d’un personnage en habit et haut de forme.
Depuis les années 1980, l’affiche lui sert de médium pour les causes humanitaires qui lui sont chères : respect des droits de l’homme, lutte contre le sida et aide à la Croix Rouge. Au-delà de ses évolutions, la place de la satire, l’exploitation de l’absurde et le rapport entre le texte et l’image restent des constantes de son œuvre publicitaire.
c) L’œuvre satirique
La satire correspond parfaitement à l’esprit caustique de Tomi Ungerer. Dès son jeune âge, Tomi Ungerer s’adonne au dessin satirique, un moyen sans doute d’exorciser ses peurs et sa colère contre l’occupation allemande. (6)
Mais ses véritables débuts dans le dessin satirique ont lieu à New York lorsqu’il travaille pour plusieurs grands magazines. Il adopte le genre « cartoon » pour croquer avec humour et sans ménagement le monde contemporain : dans un recueil intitulé Horrible, il dénonce la mécanisation du monde moderne ; dans Inside Marriage, il fait une satire du mariage.
Dans le livre The party, vers la fin des années 1960, le style de Tomi Ungerer se durcit vraiment. Il fait une critique très violente de la bonne société newyorkaise en observant son comportement dans des soirées mondaines. Son ton y est mordant, parfois à la limite du supportable pour la « bonne société » de la ville.
Plus tard, durant les années 1970, son œuvre satirique prend une dimension plus dramatique, comme si Tomi Ungerer prenait plus de distance, se plaçait en moraliste, pour mieux se préoccuper de sujets essentiels et mieux juger ses contemporains. Deux œuvres sont à signaler : Babylon, pamphlet de la décadence du monde moderne dans lequel l’auteur dénonce, par exemple, les dangers de la surpopulation en illustrant la vie quotidienne des humains dans des alvéoles d’une ruche, et Symptomatics, où il s’attaque aux conséquences du monde moderne et de la société de consommation sur l’être humain.
A partir des années 1980, il se recentre sur la lutte contre l’intolérance, le fascisme et la guerre. Les évènements auxquels il fait référence, sont plus datés, inscrits dans l’histoire personnelle de Tomi Ungerer. Le fascisme est incarné par le nazisme, l’antimilitarisme par le souvenir de la seconde guerre mondiale.
L’ensemble de cette œuvre satirique se caractérise par un graphisme brutal, sans concessions, la diversité de ses techniques allant du collage au dessin et à la peinture, et par son ancrage dans la société.
d) Le dessin d’observation
En contrepoint de cette œuvre satirique, Tomi Ungerer a ressenti le besoin, comme il le dit, de « trouver un nouveau sens de la mesure » en renouant avec une vision plus classique du dessin. Le jeune Tomi Ungerer aimait déjà aller se promener dans les forêts alsaciennes et faire des croquis des espèces d’oiseaux qui les peuplaient.
C’est à son arrivée en Irlande, qu’il va consacrer du temps au dessin d’observation. Il esquisse des animaux familiers et fait des croquis de ses propres enfants observés dans leur contexte de jeu ou d’activité. On y découvre un Tomi Ungerer qui maîtrise parfaitement le trait, qui réussit à saisir la vivacité du mouvement, tout cela avec une économie de moyens : souvent, encre de Chine et lavis. Mais la satire n’est tout de même jamais très loin, comme dans Slow Agony où il dépeint son univers canadien, la déchéance de la société de consommation et la violence humaine qu’elle engendre.
e) Le dessin érotique
Apparessant toujours en filigrane dans l’ensemble des créations de Tomi Ungerer, y compris dans ses albums pour la jeunesse, il peut être considéré à cet égard comme un thème de son œuvre.
Dans ses dessins érotiques, la satire sociale est souvent présente : en 1969, dans Fornicon, Tomi Ungerer s’inspire de scènes imaginées par lui-même avec des poupées Barbie désarticulées et mises en situation, pour critiquer la mécanisation du sexe. Pour accentuer la froideur, il utilise un trait linéaire à l’encre de Chine. Par contre, dans Totempole, il s’intéresse à l’érotisme en tant que tel et propose des dessins d’une grande précision anatomique, réalisés avec des crayons gras pour donner du volume aux formes. Dans les années 80, il réalise Les Grenouillades où l’on découvre encore une autre technique très colorée et aux formes pleines. Cette série rappelle la verve et la fantaisie rabelaisienne.
- Une approche thématique et iconographique
La plus grande partie de l’œuvre de Tomi Ungerer s’articule autour de la thématique des pulsions de vie et de mort, de la femme et de l’érotisme, sans oublier la satire sociale.
a) Le temps qui passe et la mort
N’oublions pas que Tomi Ungerer a grandi dans une famille d’horlogers et a joué petit au milieu du tic-tac des pendules ou des mouvements de balanciers. Tomi Ungerer a perdu son père très jeune et a connu les horreurs de la guerre. Cette conscience du temps qui passe inexorablement et de la mort qui plane constitue en quelque sorte un thème obsessionnel de son œuvre. Il se représente même, dans un autoportrait, en compagnie de la Mort, non pas comme une intrusion agressive mais plutôt comme une compagne attentive. Dans ses représentations de la Mort, celle-ci est toujours accompagnée de l’image allégorique de la faux. Tomi Ungerer s’arrange aussi très souvent pour faire participer la Mort à des activités humaines. Dans l’Hommage à Posada, ils représentent des squelettes, coiffés de casquettes, sur des bicyclettes.
Il arrive aussi à Tomi Ungerer d’associer le thème de la Femme et de la mort : elle joue par exemple un rôle important de médiatrice avec la mort comme dans le dessin Femme savante dans Babylon, où la femme aux traits anguleux, évoquant déjà la mort proche tient dans sa main un crâne humain.
b) La femme
La femme est omniprésente dans son œuvre. Souvent, dans ses cartoons, il en fait un portrait plutôt humoristique comme dans Pédalo-Pudding où il dissocie le corps de la femme en deux : une partie pédale pour maigrir, l’autre mange un pudding. Dans The Party, il évoque un des défauts majeurs qu’il attribue à la femme, les bavardages médisants et donne une représentation plutôt cruelle de la femme américaine.
Les rapports entre l’homme et la femme sont aussi pour lui une source d’inspiration. La femme est une puissance dangereuse. Séductrice, elle veut dominer l’homme. La critique de Tomi Ungerer est particulièrement virulente quand il évoque la volonté d’émancipation de la femme américaine qu’il juge responsable de l’effondrement familial, privilégiant sa vie professionnelle à son rôle de femme et de mère. Dans Babylon, il représente une femme, à tête de Mickey et chaussée de bottes, qui cravache des enfants manifestant pour réclamer des mères : « We want mothers ! »
c) Le rapport à la mécanisation, les objets
De nombreux dessins dénotent une angoisse de Tomi Ungerer face la mécanisation et à l’industrialisation de la société. L’homme qui a perdu la maîtrise de la machine en devient la victime au risque de perdre son identité. Ainsi, dans Symptomatics, une femme arrache comme une peau son visage laissant apparaître un trou noir.
Paradoxalement, Tomi Ungerer est un grand collectionneur de jouets et plus particulièrement de jouets mécaniques.
Les objets les plus banals de la vie quotidienne font aussi partie de son univers iconographique. Parfois placés de manière apparemment incongrue, ils ne sont jamais pour autant anodins. Tomi Ungerer considère les objets comme des produits de la société de consommation qui envahissent la vie de l’homme. Il n’hésite donc pas à les transformer en monstres fantasmagoriques.
d) Les références à l’histoire de l’art
Tomi Ungerer a effectué ses études à l’Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg mais il se revendique surtout comme un autodidacte. Il a aussi bénéficié d’une bibliothèque paternelle particulièrement riche et très influencée par la situation de l’Alsace pendant l’entre-deux guerres.
On peut par exemple citer le thème des sorcières, présent dans certaines œuvres allemandes et que nous retrouvons dans certains albums. Ou l’influence de Dürer pendant son séjour au Canada, période où Tomi s’est beaucoup consacré aux dessins d’observation, s’inspirant des dessins de ce peintre.
Se sont rajoutées d’autres sources artistiques : le courant romantique et tout particulièrement Gustave Doré pour le traitement de la lumière et la représentation d’une Alsace mythique, le dadaïsme et le surréalisme et l’on pense à Max Ernst pour les collages et les photomontages, les dessinateurs satiriques comme Hansi, Wilhelm Busch, auteur de Max et Moritz, et Saul Steinberg.
- Pour conclure
Tomi Ungerer n’a jamais cessé de nous surprendre, par son esprit curieux, son goût du paradoxe, de l’humour et de l’autodérision. Dans son œuvre, tout est simultané. Aujourd’hui, par les dessins-collages et ses photomontages qu’ils transforment en 3D, Tomi Ungerer a décidé de se consacrer à des formes plus libérées de création que l’illustration.
Un grand merci à Thérèse Willer pour cette déambulation dans l’œuvre d’un des plus grands auteurs-illustrateurs pour la jeunesse contemporains.
(novembre 2017)
(1) hors série de la revue ZUT ! p. 34-35, Chic Médias, 2011 ; graphiques présentant la corrélation entre ces périodes, les thématiques et les techniques d’illustration
(2) Aux petits enfants les grands livres, p. 90, Association Français pour la Lecture, 2007
(3) revue ZUT ! p. 63
(4) Pour comprendre la relation étroite entre cette enfance alsacienne et son œuvre, nous recommandons la lecture de A la guerre comme à la guerre, école des loisirs, 2002
(5) extrait de cet interview dans la revue ZUT ! p.158
(6) cf A la guerre comme à la guerre
Enseignante pendant de longues années, Martine Abadia fut responsable et animatrice de la Salle du Livre du Centre d’animation et de documentation pédagogique (CADP) de Rieux-Volvestre, centre de ressources littérature jeunesse et lieu d’accueil de classes lecture, ouvert en partenariat par le Conseil Général et l’Inspection Académique de la Haute-Garonne. « Je profite de mon nouveau statut de retraitée pour approfondir au CRILJ Midi-Pyrénées ma connaissance de la littérature de jeunesse et pour faire partager ma passion aux médiateurs du livre du département. » Marine Abadia est l’actuelle présidente de la section.
.
.
Photo du haut : André Delobel